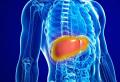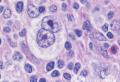Enfants de Catherine la Grande. Conseil d'administration et vie personnelle de Catherine la Grande
Étrangère de naissance, elle aimait sincèrement la Russie et se souciait du bien-être de ses sujets. Après avoir accédé au trône par un coup d'État, l'épouse de Pierre III a tenté de mettre en œuvre les meilleures idées des Lumières européennes dans la vie de la société russe. Dans le même temps, Catherine s'oppose au déclenchement de la Grande Révolution française (1789-1799), outrée par l'exécution du roi de France Louis XVI de Bourbon (21 janvier 1793) et prédéterminant la participation de la Russie à la coalition anti-française États européens au début du XIXème siècle.
Catherine II Alekseevna (née Sophia Augusta Frederika, princesse d'Anhalt-Zerbst) est née le 2 mai 1729 dans la ville allemande de Stettin (actuelle Pologne) et décédée le 17 novembre 1796 à Saint-Pétersbourg.
La fille du prince Christian Auguste d'Anhalt-Zerbst et de la princesse Johannes-Elizabeth (née princesse de Holstein-Gottorp), qui était au service de la Prusse, était apparentée aux maisons royales de Suède, de Prusse et d'Angleterre. Elle a reçu une éducation à domicile, dont le cours, en plus de la danse et des langues étrangères, comprenait également les bases de l'histoire, de la géographie et de la théologie.
En 1744, elle et sa mère furent invitées en Russie par l'impératrice Elizabeth Petrovna, et baptisées selon la tradition orthodoxe sous le nom d'Ekaterina Alekseevna. Bientôt, il a été annoncé ses fiançailles avec le grand-duc Peter Fedorovich (futur empereur Pierre III), et en 1745, ils se sont mariés.
Catherine comprit que la cour aimait Elizabeth, n'acceptait pas beaucoup des bizarreries de l'héritier du trône et, peut-être, après la mort d'Elizabeth, c'était elle, avec le soutien de la cour, pour monter sur le trône russe. Catherine a étudié les travaux des dirigeants des Lumières françaises, ainsi que la jurisprudence, qui ont eu un impact significatif sur sa vision du monde. En outre, elle a fait autant d'efforts que possible pour étudier et éventuellement comprendre l'histoire et les traditions de l'État russe. En raison de son désir d'apprendre tout le russe, Catherine a gagné l'amour non seulement de la cour, mais de tout Pétersbourg.
Après la mort d'Elizaveta Petrovna, la relation entre Catherine et son mari, jamais distinguée par la chaleur et la compréhension, a continué à se détériorer, prenant des formes clairement hostiles. Craignant d'être arrêtée, Catherine, avec le soutien des frères Orlov, N.I. Panine, K.G. Razumovsky, E.R. Dashkova, dans la nuit du 28 juin 1762, alors que l'empereur était à Oranienbaum, fit un coup d'État au palais. Pierre III fut exilé à Ropsha, où il mourut bientôt dans des circonstances mystérieuses.
En commençant son règne, Catherine a tenté de mettre en œuvre les idées des Lumières et d'organiser un État conforme aux idéaux de ce mouvement intellectuel européen le plus puissant. Presque dès les premiers jours de son gouvernement, elle s'est activement impliquée dans les affaires publiques, proposant des réformes importantes pour la société. À son initiative, en 1763, une réforme du Sénat est effectuée, ce qui augmente considérablement l'efficacité de son travail. Souhaitant accroître la dépendance de l'Église vis-à-vis de l'État, et fournir des ressources foncières supplémentaires à la noblesse soutenant la politique de réforme de la société, Catherine procède à la sécularisation des terres ecclésiastiques (1754). L'unification de la gestion des territoires de l'Empire russe a commencé et l'hetmanat en Ukraine a été aboli.
L'avocate des Lumières, Ekaterina, crée un certain nombre de nouveaux établissements d'enseignement, y compris pour les femmes (Institut Smolny, Ekaterininskoe School).
En 1767, l'impératrice a convoqué une commission, qui comprenait des représentants de toutes les couches de la population, y compris les paysans (à l'exception des serfs), pour composer un nouveau code - un code de lois. Afin de diriger les travaux de la Commission législative, Catherine a rédigé l'« Ordre », dont le texte était basé sur les écrits d'auteurs pédagogiques. Ce document, en effet, était le programme libéral de son règne.
Après la fin de la guerre russo-turque de 1768-1774. et la suppression du soulèvement dirigé par Yemelyan Pougatchev, une nouvelle étape des réformes de Catherine a commencé, lorsque l'impératrice a développé indépendamment les actes législatifs les plus importants et, utilisant le pouvoir illimité de son pouvoir, les a mis en œuvre.
En 1775, un manifeste est publié qui autorise la libre ouverture de toute entreprise industrielle. La même année, une réforme provinciale a été réalisée, qui a introduit une nouvelle division administrative-territoriale du pays, qui est restée jusqu'en 1917. En 1785, Catherine a émis des lettres de gratitude à la noblesse et aux villes.
Dans le domaine de la politique étrangère, Catherine II a continué à mener une politique offensive dans toutes les directions - nord, ouest et sud. Les résultats de la politique étrangère peuvent être appelés le renforcement de l'influence de la Russie sur les affaires européennes, les trois sections du Commonwealth, le renforcement des positions dans les États baltes, l'annexion de la Crimée, de la Géorgie, la participation à la lutte contre les forces de la France révolutionnaire.
La contribution de Catherine II à l'histoire russe est si importante que de nombreuses œuvres de notre culture gardent sa mémoire.
Catherine II
née Sophia Augusta Frederica d'Angalt de Zerbst ; Allemand Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg
Impératrice de toute la Russie de 1762 à 1796, fille du prince Anhalt-Zerbst, Catherine est arrivée au pouvoir lors d'un coup d'État qui a renversé son mari impopulaire Pierre III du trône
courte biographie
Le 2 mai (21 avril 1729), dans la ville prussienne de Stettin (aujourd'hui Pologne), naquit Sophia Augusta Frederica d'Anhalt-Zerbst, qui devint célèbre sous le nom de Catherine II la Grande, l'impératrice russe. La période de son règne, qui a amené la Russie sur la scène mondiale en tant que puissance mondiale, est appelée "l'âge d'or de Catherine".
Le père de la future impératrice, le duc de Zerbst, était au service du roi de Prusse, mais sa mère, Johannes Elizabeth, avait un pedigree très riche ; elle était la grand-tante du futur Pierre III. Malgré la noblesse, la famille ne vivait pas très richement, Sophia a grandi comme une fille ordinaire qui était éduquée à la maison, jouait avec ses pairs avec plaisir, était active, mobile, courageuse, aimait être espiègle.
Une nouvelle étape dans sa biographie a été ouverte le 1744 - lorsque l'impératrice russe Elizaveta Petrovna l'a invitée en Russie avec sa mère. Là, Sofia devait épouser le grand-duc Pierre Fedorovich, l'héritier du trône, qui était son cousin germain. À son arrivée dans un pays étranger, qui allait devenir sa deuxième patrie, elle a commencé à apprendre activement la langue, l'histoire et les coutumes. La jeune Sophie le 9 juillet (28 juin) 1744 se convertit à l'orthodoxie et reçut au baptême le nom d'Ekaterina Alekseevna. Le lendemain, elle était fiancée à Peter Fedorovich, et le 1er septembre (21 août, OS) 1745, ils se sont mariés.
Peter, dix-sept ans, s'intéressait peu à sa jeune femme, chacun menait sa propre vie. Catherine aimait non seulement l'équitation, la chasse, les mascarades, mais lisait aussi beaucoup, était activement engagée dans l'auto-éducation. En 1754, son fils Paul (le futur empereur Paul Ier) est né, qu'Elizaveta Petrovna a immédiatement pris à sa mère. Le mari de Catherine est extrêmement malheureux lorsqu'en 1758, elle donne naissance à une fille, Anna, incertaine de sa paternité.
Catherine réfléchissait à la manière d'empêcher son mari de s'asseoir sur le trône de l'empereur depuis 1756, comptant sur le soutien des gardes, du chancelier Bestoujev et du commandant en chef de l'armée Apraksine. Ce n'est qu'avec le temps que la correspondance détruite entre Bestoujev et Catherine a sauvé cette dernière d'être exposée par Elizaveta Petrovna. Le 5 janvier 1762 (25 décembre 1761, OS), l'impératrice de Russie mourut et son fils, devenu Pierre III, prit sa place. Cet événement a encore creusé le fossé entre les époux. L'empereur commença ouvertement à vivre avec sa maîtresse. À son tour, sa femme, expulsée à l'autre bout de l'hiver, tombe enceinte et donne secrètement naissance à un fils du comte Orlov.
Profitant du fait que son mari-empereur a pris des mesures impopulaires, notamment, est allé au rapprochement avec la Prusse, n'a pas eu la meilleure réputation, a reconstruit les officiers contre lui-même, Catherine a fait un coup d'État avec le soutien de ce dernier : le 9 juillet ( 28 juin OS) 1762 À Saint-Pétersbourg, les unités de gardes lui prêtent serment de fidélité. Le lendemain, Pierre III, qui ne voyait pas l'intérêt de résister, abdiqua le trône, puis mourut dans des circonstances qui restaient floues. Le 3 octobre (22 septembre, OS) 1762, le couronnement de Catherine II eut lieu à Moscou.
La période de son règne a été marquée par un grand nombre de réformes, notamment dans le système de gouvernement et la structure de l'empire. Sous sa tutelle, toute une galaxie de célèbres "aigles de Catherine" - Suvorov, Potemkin, Ushakov, Orlov, Kutuzov et d'autres ont avancé. Le Commonwealth polono-lituanien, etc. Une nouvelle ère a commencé dans le domaine culturel, vie scientifique pays. La mise en œuvre des principes d'une monarchie éclairée a contribué à l'ouverture d'un grand nombre de bibliothèques, d'imprimeries, de divers établissements d'enseignement. Catherine II correspond avec Voltaire et les encyclopédistes, collectionne des toiles d'art, laisse derrière elle un riche héritage littéraire, notamment sur le thème de l'histoire, de la philosophie, de l'économie et de la pédagogie.
D'autre part, sa politique intérieure se caractérise par une augmentation de la position privilégiée de la noblesse, une restriction encore plus grande de la liberté et des droits de la paysannerie, la répression sévère de la dissidence, surtout après le soulèvement de Pougatchev (1773-1775) .
Catherine était au Palais d'Hiver lorsqu'elle a subi un accident vasculaire cérébral. Le lendemain, le 17 novembre (le 6 novembre 1796), la Grande Impératrice est décédée. Son dernier refuge était la cathédrale Saint-Pétersbourg Pierre et Paul.
Biographie de Wikipédia
Fille du prince Anhalt-Zerbst, Catherine est arrivée au pouvoir lors d'un coup d'État qui a renversé son mari impopulaire Pierre III du trône.
L'ère Catherine a été marquée par l'asservissement maximal des paysans et l'expansion globale des privilèges de la noblesse.
Sous Catherine la Grande, les frontières de l'Empire russe ont été considérablement étendues à l'ouest (parties du Commonwealth) et au sud (annexion de la Novorossie, de la Crimée, en partie du Caucase).
Le système d'administration publique sous Catherine II a été réformé pour la première fois depuis l'époque de Pierre I.
Culturellement, la Russie est finalement devenue l'une des grandes puissances européennes, ce qui a été grandement facilité par l'impératrice elle-même, qui aimait les activités littéraires, collectionnait les chefs-d'œuvre de la peinture et correspondait avec des éclaireurs français. En général, la politique de Catherine et ses réformes s'inscrivent dans le courant dominant de l'absolutisme éclairé du XVIIIe siècle.
Origine
Sophia Frederica Augusta d'Anhalt-Zerbst est née le 21 avril (2 mai 1729) dans la ville allemande de Stettin - la capitale de la Poméranie (aujourd'hui Szczecin, Pologne).

Le père, Christian August d'Anhalt-Zerbst, venait de la lignée Zerbst-Dornburg de la Maison d'Anhalt et était au service du roi de Prusse, était commandant de régiment, commandant, puis gouverneur de la ville de Stettin, où la future impératrice est né, a couru pour les ducs de Courlande, mais sans succès, a terminé son service en tant que maréchal prussien. Mère - Johanna Elizabeth, de la maison souveraine Gottorp, était la cousine du futur Pierre III. La lignée de Johanna Elizabeth remonte à Christian Ier, roi de Danemark, de Norvège et de Suède, premier duc de Schleswig-Holstein et fondateur de la dynastie Oldenburg.
Son oncle maternel, Adolf-Friedrich, fut élu héritier du trône de Suède en 1743, auquel il entra en 1751 sous le nom d'Adolf-Fredrik. Un autre oncle, Karl Eitinsky, selon le plan de Catherine I, devait devenir le mari de sa fille Elizabeth, mais est décédé à la veille des célébrations du mariage.
Enfance, éducation, éducation

Dans la famille du duc de Zerbst, Catherine a reçu une éducation à domicile. Elle a étudié l'anglais, le français et l'italien, la danse, la musique, les bases de l'histoire, la géographie, la théologie. Elle a grandi comme une fille enjouée, curieuse, enjouée, elle aimait faire étalage de son courage devant les garçons, avec qui elle jouait facilement dans les rues de Stettin. Les parents n'étaient pas satisfaits du comportement « garçon » de leur fille, mais ils étaient satisfaits que Frederica s'en soit occupée. sœur cadette Août. Sa mère l'appelait dans son enfance Fike ou Fikchen (allemand Figchen - vient du nom Frederica, c'est-à-dire "petite Frederica").
En 1743, l'impératrice russe Elizabeth Petrovna, choisissant une épouse pour son héritier, le grand-duc Peter Fedorovich (le futur empereur russe Pierre III), se souvint que sur son lit de mort sa mère l'avait léguée pour devenir l'épouse d'un prince Holstein, le frère de Johann Elizabeth. C'est peut-être cette circonstance qui a fait pencher la balance en faveur de Frederica ; Elizabeth avait auparavant vigoureusement soutenu l'élection de son oncle au trône suédois et avait échangé des portraits avec sa mère. En 1744, la princesse zerbe, avec sa mère, a été invitée en Russie pour épouser Peter Fedorovich, qui était son cousin germain. Elle a vu pour la première fois son futur mari au château d'Eitinsky en 1739.
La princesse de quinze ans avec sa mère, vers le 12 février 1744, se rendit en Russie par Riga, où le lieutenant baron von Munchausen gardait l'honneur près de la maison dans laquelle ils séjournaient. Immédiatement après son arrivée en Russie, elle a commencé à étudier la langue russe, l'histoire, l'orthodoxie, les traditions russes, tout en s'efforçant de connaître le plus possible la Russie, qu'elle considérait comme une nouvelle patrie. Parmi ses professeurs, on distingue le célèbre prédicateur Simon Todorsky (professeur d'orthodoxie), l'auteur de la première grammaire russe Vasily Adadurov (professeur de langue russe) et le chorégraphe Lange (professeur de danse).

Dans un effort pour apprendre le russe le plus rapidement possible, la future impératrice étudiait la nuit, assise devant une fenêtre ouverte dans l'air glacial. Bientôt, elle tomba malade d'une pneumonie et son état était si grave que sa mère lui proposa de faire venir un pasteur luthérien. Sofia, cependant, a refusé et a fait venir Simon Todorsky. Cette circonstance ajouta à sa popularité à la cour russe. 28 juin (9 juillet) 1744 Sophia Frederica Augusta se convertit du luthéranisme à l'orthodoxie et reçut le nom de Catherine Alekseevna (le même nom et patronyme que la mère d'Elizabeth, Catherine I), et le lendemain elle fut fiancée au futur empereur.
L'apparition de Sofia avec sa mère à Saint-Pétersbourg s'est accompagnée d'une intrigue politique, dans laquelle sa mère, la princesse Zerbst, était impliquée. Elle était fan du roi Frédéric II de Prusse, et ce dernier a décidé d'utiliser son séjour à la cour impériale russe pour asseoir son influence sur la politique étrangère russe. Pour cela, il était prévu, par intrigue et influence sur l'impératrice Elizaveta Petrovna, de retirer des affaires du chancelier Bestoujev, qui menait une politique anti-prussienne, et de le remplacer par un autre noble qui sympathisait avec la Prusse. Cependant, Bestoujev a réussi à intercepter les lettres de la princesse de Zerbst à Frédéric II et à les présenter à Elizaveta Petrovna. Après que cette dernière eut appris le « rôle laid d'espionne prussienne » joué par la mère de Sofia à sa cour, elle changea immédiatement d'attitude à son égard et la fit déshonorer. Cependant, cela n'a pas affecté la position de Sophia elle-même, qui n'a pas pris part à cette intrigue.
Mariage avec l'héritier du trône de Russie

Le 21 août (1er septembre 1745), à l'âge de seize ans, Catherine épousa Peter Fedorovich, qui avait 17 ans et qui était son cousin germain. Les premières années de leur vie commune, Peter ne s'intéressait pas du tout à sa femme et il n'y avait aucune relation conjugale entre eux. Catherine écrira à ce sujet plus tard :
J'ai bien vu que le grand-duc ne m'aimait pas du tout ; deux semaines après le mariage, il me dit qu'il était amoureux de la femme de chambre Carr, la demoiselle d'honneur de l'impératrice. Il dit au comte Divier, son chambellan, qu'il n'y avait pas de comparaison entre cette fille et moi. Divière argumenta le contraire, et il se fâcha contre lui ; cette scène se passait presque en ma présence, et je vis cette querelle. A vrai dire, je me disais qu'avec cet homme je serais certainement bien malheureuse si je cédais au sentiment d'amour pour lui, qu'ils payaient si mal, et qu'il y aurait de quoi mourir de jalousie en vain. du tout.
Alors, par orgueil, j'ai essayé de me forcer à ne pas être jaloux d'une personne qui ne m'aime pas, mais pour ne pas être jaloux de lui, il n'y avait pas d'autre choix que de ne pas l'aimer. S'il voulait être aimé, ce ne serait pas difficile pour moi : j'étais naturellement encline et habituée à remplir mes devoirs, mais pour cela il me faudrait un mari de bon sens, et le mien n'en avait pas.

Ekaterina continue de s'instruire. Elle lit des livres d'histoire, de philosophie, de jurisprudence, les ouvrages de Voltaire, Montesquieu, Tacite, Bayle, un grand nombre d'autres littératures. Les principaux divertissements pour elle étaient la chasse, l'équitation, la danse et les mascarades. L'absence de relations conjugales avec le Grand-Duc a contribué à l'apparition d'amants pour Catherine. Pendant ce temps, l'impératrice Elizabeth a exprimé son mécontentement face à l'absence d'enfants des époux.
Enfin, après deux grossesses infructueuses, le 20 septembre (1er octobre 1754), Catherine donne naissance à son fils Paul. La naissance a été difficile, le bébé a été immédiatement enlevé à la mère par la volonté de l'impératrice régnante Elizabeth Petrovna, et Catherine a été privée de la possibilité de s'instruire, lui permettant de ne voir Paul qu'occasionnellement. Ainsi, la Grande-Duchesse a vu son fils pour la première fois seulement 40 jours après l'accouchement. Un certain nombre de sources affirment que le vrai père de Paul était l'amant de Catherine S. V. Saltykov (il n'y a aucune déclaration directe à ce sujet dans les Notes de Catherine II, mais elles sont souvent interprétées de cette façon). D'autres - que de telles rumeurs sont sans fondement et que Peter a subi une opération qui a éliminé le défaut qui rendait la conception impossible. La question de la paternité intéresse également la société.
 Alexey Grigorievich Bobrinsky est le fils illégitime de l'impératrice.
Alexey Grigorievich Bobrinsky est le fils illégitime de l'impératrice.
Après la naissance de Paul, les relations avec Peter et Elizabeth Petrovna se sont finalement détériorées. Peter a appelé sa femme "madame de rechange" et a ouvertement fait des maîtresses, cependant, sans empêcher Catherine de le faire, qui pendant cette période, grâce aux efforts de l'ambassadeur anglais Sir Charles Henbury Williams, a eu une relation avec Stanislav Ponyatovsky, le futur roi de Pologne. Le 9 (20) décembre 1757, Catherine donne naissance à sa fille Anna, ce qui suscite un vif mécontentement auprès de Pierre, qui dit à l'annonce d'une nouvelle grossesse : « Dieu sait pourquoi ma femme est redevenue enceinte ! Je ne sais pas du tout si cet enfant est de moi et dois-je le prendre personnellement. »
Pendant cette période, l'ambassadeur britannique Williams était un ami proche et un confident de Catherine. Il lui a accordé à plusieurs reprises des sommes importantes sous forme de prêts ou de subventions : rien qu'en 1750, 50 000 roubles lui ont été transférés, pour lesquels il existe deux de ses recettes ; et en novembre 1756, 44 000 roubles lui furent transférés. En retour, il a reçu d'elle diverses informations confidentielles - oralement et par des lettres qu'elle lui écrivait assez régulièrement, comme pour le compte d'un homme (à des fins de complot). En particulier, à la fin de 1756, après le début de la guerre de Sept Ans avec la Prusse (dont l'Angleterre était un allié), Williams, ainsi qu'il ressort de ses propres dépêches, reçut de Catherine des informations importantes sur l'état de l'armée russe belligérante. et sur le plan de l'offensive russe, qui lui fut transféré à Londres, ainsi qu'à Berlin, le roi de Prusse Frédéric II. Après le départ de Williams, elle a reçu de l'argent de son successeur, Keith. Les historiens expliquent l'appel fréquent de Catherine aux Britanniques pour de l'argent par son gaspillage, à cause duquel ses dépenses dépassaient de loin les sommes allouées pour son entretien par le trésor. Dans une de ses lettres à Williams, elle promettait, en signe de gratitude, « de conduire la Russie à une alliance amicale avec l'Angleterre, de lui rendre partout l'assistance et la préférence nécessaires pour le bien de toute l'Europe, et en particulier de la Russie, sur leur ennemi commun, la France, dont la grandeur est une honte pour la Russie. J'apprendrai à pratiquer ces sentiments, à fonder ma gloire sur eux et à prouver au roi, votre souverain, la force de mes sentiments. »
Déjà à partir de 1756, et surtout pendant la période de maladie d'Elizabeth Petrovna, Catherine a élaboré un plan pour retirer le futur empereur (son mari) du trône au moyen d'un complot, comme elle l'a écrit à plusieurs reprises à Williams. À cette fin, Catherine, selon l'historien VO Klyuchevsky, «a demandé des cadeaux et des pots-de-vin de 10 000 livres sterling au roi anglais, s'engageant à agir selon sa parole d'honneur dans l'intérêt commun anglo-russe, a commencé à penser à impliquer les gardes dans l'affaire en cas de décès Elizabeth, a conclu un accord secret à ce sujet avec l'hetman K. Razumovsky, le commandant de l'un des régiments de gardes. " Le chancelier Bestoujev a également été initié à ce plan du coup d'État du palais, qui a promis une assistance à Catherine.
Au début de 1758, l'impératrice Elizaveta Petrovna soupçonna de trahison le commandant en chef de l'armée russe Apraksin, avec qui Catherine était en bons termes, ainsi que le chancelier Bestoujev lui-même. Tous deux ont été arrêtés, interrogés et punis ; cependant, Bestoujev a réussi à détruire toute sa correspondance avec Catherine avant son arrestation, ce qui l'a sauvée de la persécution et de la disgrâce. Dans le même temps, Williams est rappelé en Angleterre. Ainsi, ses précédents favoris ont été supprimés, mais un cercle de nouveaux a commencé à se former : Grigory Orlov et Dashkova.
La mort d'Elizabeth Petrovna (25 décembre 1761 (5 janvier 1762)) et l'accession au trône de Pierre Fedorovich sous le nom de Pierre III aliéna davantage les époux. Pierre III a commencé à vivre ouvertement avec sa maîtresse Elizaveta Vorontsova, installant sa femme à l'autre bout du Palais d'Hiver. Lorsque Catherine est tombée enceinte d'Orlov, cela ne pouvait plus s'expliquer par une conception accidentelle de son mari, puisque la communication entre les époux avait complètement cessé à ce moment-là. Catherine a caché sa grossesse et, au moment de l'accouchement, son valet dévoué Vasily Grigorievich Shkurin a mis le feu à sa maison. Amoureux de tels spectacles, Pierre à la cour quitta le palais pour regarder le feu ; à cette époque, Catherine a accouché avec succès. C'est ainsi qu'est né Alexeï Bobrinsky, à qui son frère Pavel Ier attribua plus tard le titre de comte.
Coup d'État du 28 juin 1762

Après être monté sur le trône, Pierre III a mené un certain nombre d'actions qui ont provoqué une attitude négative à son égard dans le corps des officiers. Ainsi, il a conclu un traité non rentable pour la Russie avec la Prusse, tandis que la Russie a remporté un certain nombre de victoires sur elle pendant la guerre de Sept Ans, et lui a rendu les terres capturées par les Russes. En même temps, il entendait, en alliance avec la Prusse, s'opposer au Danemark (allié de la Russie), afin de rendre le Schleswig, qu'elle avait pris au Holstein, et lui-même entendait marcher en tête de la garde. Pierre a annoncé la séquestration des biens de l'Église russe, l'abolition du régime foncier monastique et a partagé avec les environs les plans de réforme des rituels de l'église. Les partisans du coup d'État ont également accusé Pierre III d'ignorance, de démence, d'aversion pour la Russie, d'incapacité totale à gouverner. Dans son contexte, Catherine, 33 ans, avait l'air favorable - une épouse intelligente, cultivée, pieuse et bienveillante qui a été persécutée par son mari.
Après que les relations avec son mari se soient finalement détériorées et que le mécontentement envers l'empereur de la part des gardes ait augmenté, Catherine a décidé de participer au coup d'État. Ses associés, dont les principaux étaient les frères Orlov, le sergent Potemkine et l'adjudant Fiodor Khitrovo, se sont livrés à une agitation dans les unités de gardes et les ont convaincus de leur côté. La raison immédiate du début du coup d'État était les rumeurs concernant l'arrestation de Catherine et la divulgation et l'arrestation de l'un des participants au complot - le lieutenant Passek.
Apparemment, la participation étrangère était également impliquée ici. Comme Henri Troyat et Casimir Walishevsky l'écrivent, planifiant le renversement de Pierre III, Catherine s'est tournée vers les Français et les Britanniques pour de l'argent, faisant allusion à ce qu'elle allait accomplir. Les Français ont réagi avec méfiance à sa demande d'emprunter 60 000 roubles, ne croyant pas au sérieux de son plan, mais elle a reçu 100 000 roubles des Britanniques, ce qui a peut-être influencé par la suite son attitude envers l'Angleterre et la France.
Au petit matin du 28 juin (9 juillet 1762), alors que Pierre III était à Oranienbaum, Catherine, accompagnée d'Alexei et de Grigory Orlov, arriva de Peterhof à Saint-Pétersbourg, où les unités de gardes lui prêtèrent allégeance. Pierre III, voyant le désespoir de la résistance, abdique le lendemain, est placé en garde à vue et meurt dans des circonstances inexpliquées. Dans sa lettre, Catherine a souligné un jour qu'avant sa mort, Peter souffrait de coliques hémorroïdaires. Après la mort (bien que les faits indiquent que même avant la mort - voir ci-dessous), Catherine a ordonné une autopsie afin de dissiper les soupçons d'empoisonnement. Une autopsie a montré (selon Catherine) que l'estomac est absolument propre, ce qui exclut la présence de poison.
Dans le même temps, comme l'écrit l'historien N.I. Pavlenko, "La mort violente de l'empereur est irréfutablement confirmée par des sources absolument fiables" - les lettres d'Orlov à Catherine et un certain nombre d'autres faits. Il existe également des faits indiquant qu'elle était au courant de l'assassinat imminent de Pierre III. Ainsi, déjà le 4 juillet, 2 jours avant la mort de l'empereur dans le palais de Ropsha, Catherine lui a envoyé le docteur Paulsen, et comme l'écrit Pavlenko, "il est indicatif que Paulsen a été envoyé à Ropsha non avec des médicaments, mais avec instruments chirurgicaux pour l'ouverture du corps".
Après l'abdication de son mari, Ekaterina Alekseevna monta sur le trône en tant qu'impératrice régnante sous le nom de Catherine II, publiant un manifeste dans lequel la base de la destitution de Pierre indiquait une tentative de changer la religion d'État et la paix avec la Prusse. Pour justifier ses propres droits sur le trône (et non l'héritier de Paul, 7 ans), Catherine a évoqué "le désir de tous nos loyaux sujets est évident et sans hypocrisie". Le 22 septembre (3 octobre 1762), elle est couronnée à Moscou. Comme V.O. Klyuchevsky a décrit son accession au trône, "Catherine a fait une double saisie : elle a pris le pouvoir de son mari et ne l'a pas transféré à son fils, l'héritier naturel de son père".
Le règne de Catherine II : informations générales

Dans ses mémoires, Catherine décrit ainsi l'état de la Russie au début de son règne :
Les finances étaient épuisées. L'armée n'a pas reçu de salaire pendant 3 mois. Le commerce était en déclin, car nombre de ses branches étaient monopolisées. Il n'y avait pas de système correct dans économie de l'État... Le ministère de la Guerre était endetté ; la mer pouvait à peine tenir, étant dans un dédain total. Le clergé était mécontent de la prise de ses terres. La justice était vendue avec un marché, et les lois n'étaient guidées que dans les cas où elles favorisaient une personne forte.
Selon les historiens, cette caractéristique ne correspondait pas pleinement à la réalité. Les finances de l'État russe, même après la guerre de Sept Ans, n'étaient en aucun cas épuisées ou bouleversées: ainsi, en général, en 1762, le déficit budgétaire ne s'élevait qu'à un peu plus d'un million de roubles. ou 8 % du montant du revenu. De plus, Catherine elle-même a contribué à l'émergence de ce déficit, car ce n'est que dans les six premiers mois de son règne, jusqu'à la fin de 1762, qu'elle a distribué 800 000 roubles sous forme de cadeaux aux favoris et aux participants au coup d'État du 28 juin. en espèces, sans compter les biens, les terres et les paysans. (qui, bien sûr, n'était pas inclus dans le budget). Un désordre extrême et un épuisement des finances se sont produits juste pendant le règne de Catherine II, au même moment où la dette extérieure de la Russie est apparue pour la première fois, et le montant des salaires impayés et des obligations du gouvernement à la fin de son règne était beaucoup plus élevé que celui qui restait. derrière par ses prédécesseurs. Les terres furent en fait prises à l'église non pas avant Catherine, mais juste pendant son règne, en 1764, ce qui provoqua le mécontentement du clergé. Et, selon les historiens, aucun système d'administration publique, de justice et de gestion des finances publiques, qui serait certainement meilleur que le précédent, n'a été créé sous son régime ;;.
L'impératrice a formulé les tâches du monarque russe comme suit :
- Il faut éduquer la nation, qui doit être gouvernée.
- Il est nécessaire d'introduire le bon ordre dans l'État, de soutenir la société et de l'obliger à se conformer aux lois.
- Il est nécessaire d'établir une force de police bonne et précise dans l'État.
- Il faut favoriser l'épanouissement de l'État et le rendre abondant.
- Il faut rendre l'État redoutable en lui-même et inspirer le respect de ses voisins.
La politique de Catherine II se caractérise principalement par la préservation et le développement des tendances tracées par ses prédécesseurs. Au milieu du règne, une réforme administrative (provinciale) est menée, qui détermine la structure territoriale du pays jusqu'à la réforme administrative de 1929, ainsi qu'une réforme judiciaire. Le territoire de l'État russe a considérablement augmenté en raison de l'annexion de terres fertiles du sud - Crimée, région de la mer Noire, ainsi que la partie orientale du Commonwealth, etc. La population est passée de 23,2 millions (en 1763) à 37,4 millions ( en 1796), en termes de population, la Russie est devenue le plus grand pays européen (elle représentait 20% de la population de l'Europe). Catherine II a formé 29 nouvelles provinces et construit environ 144 villes, comme l'a écrit Klyuchevsky :
L'armée de 162 000 personnes a été renforcée à 312 000, la flotte, en 1757, se composait de 21 cuirassés et 6 frégates, en 1790, elle comprenait 67 cuirassés et 40 frégates et 300 bateaux à rames, le montant des revenus de l'État de 16 millions de roubles augmenté à 69 millions, soit plus que quadruplé, le succès du commerce extérieur: la Baltique - en augmentant l'importation et l'exportation, de 9 millions à 44 millions de roubles, la mer Noire, Catherine et créé - de 390 mille en 1776 à 1 millions 900 mille roubles en 1796, la croissance du chiffre d'affaires interne a été indiquée par l'émission de pièces de monnaie au cours des 34 années du règne pour 148 millions de roubles, alors qu'au cours des 62 années précédentes, elle n'a été émise que pour 97 millions ".

Dans le même temps, la croissance démographique était en grande partie le résultat de l'annexion d'États et de territoires étrangers à la Russie (où vivaient près de 7 millions de personnes), qui s'est souvent produite contre la volonté de la population locale, ce qui a conduit à l'émergence de la « polonais », « ukrainien », « juif » et d'autres questions nationales héritées par l'empire russe de l'ère de Catherine II. Des centaines de villages sous Catherine ont reçu le statut de ville, mais en fait ils sont restés des villages en apparence et en occupation de la population, il en va de même pour nombre de villes fondées par elle (certaines n'existaient généralement que sur le papier, comme en témoignent les contemporains) . En plus de l'émission de la pièce, des billets en papier ont été émis pour 156 millions de roubles, ce qui a entraîné une inflation et une dévaluation importante du rouble; donc une vraie croissance recettes budgétaires et d'autres indicateurs économiques pendant son règne étaient nettement inférieurs à la valeur nominale.
L'économie russe est restée agraire. La part de la population urbaine n'a pratiquement pas augmenté, s'élevant à environ 4 %. Dans le même temps, un certain nombre de villes ont été fondées (Tiraspol, Grigoriopol, etc.), la fonte de fonte a été multipliée par plus de 2 (où la Russie a pris la 1ère place mondiale) et le nombre de manufactures de toile à voile a augmenté. Au total, à la fin du XVIIIe siècle. il y avait 1200 grandes entreprises dans le pays (en 1767 il y en avait 663). Les exportations de marchandises russes vers d'autres pays européens ont considérablement augmenté, notamment via les ports créés sur la mer Noire. Cependant, dans la structure de cette exportation, il n'y avait aucun produit fini, seulement des matières premières et des produits semi-finis, et les produits industriels étrangers prédominaient dans les importations. Alors qu'en Occident dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. la révolution industrielle a eu lieu, l'industrie russe est restée « patriarcale » et servage, ce qui l'a fait prendre du retard sur l'Occident. Enfin, dans les années 1770 et 1780. une crise sociale et économique aiguë a éclaté, qui s'est également traduite par une crise financière.
Caractéristiques de la carte
Politique intérieure
L'adhésion de Catherine aux idées des Lumières a largement prédéterminé le fait que le terme « absolutisme éclairé » est souvent utilisé pour caractériser la politique intérieure de l'époque de Catherine. Elle a vraiment donné vie à certaines des idées des Lumières. Ainsi, selon Catherine, à partir des travaux du philosophe français Montesquieu, les vastes espaces russes et la rigueur du climat déterminent la régularité et la nécessité de l'autocratie en Russie. Sur cette base, sous Catherine, l'autocratie a été renforcée, l'appareil bureaucratique a été renforcé, le pays a été centralisé et le système de gouvernement a été unifié. Cependant, les idées exprimées par Diderot et Voltaire, dont elle adhère verbalement, ne correspondent pas à sa politique intérieure. Ils ont défendu l'idée que chaque personne naît libre et ont préconisé l'égalité de tous et l'élimination des formes médiévales d'exploitation et des formes despotiques de gouvernement. Contrairement à ces idées, sous Catherine, la situation des serfs s'est encore dégradée, leur exploitation s'est intensifiée, les inégalités ont augmenté en raison de l'octroi de privilèges encore plus importants à la noblesse. En général, les historiens qualifient sa politique de « pro-noble » et pensent qu'en dépit des déclarations fréquentes de l'impératrice sur son « souci vigilant du bien-être de tous les sujets », le concept de bien commun à l'époque de Catherine était la même fiction que en général en Russie au XVIIIe siècle

Peu de temps après le coup d'État, l'homme d'État N.I. Panin a proposé de créer un Conseil impérial : 6 ou 8 hauts dignitaires règnent avec le monarque (comme c'était la norme de 1730). Ekaterina a rejeté ce projet.
Selon un autre projet de Panin, le Sénat a été transformé - le 15 (26) décembre 1763. Il a été divisé en 6 départements dirigés par des procureurs en chef, et le procureur général est devenu le chef. Chaque département avait des pouvoirs spécifiques. Les pouvoirs généraux du Sénat ont été réduits, en particulier, il a perdu l'initiative législative et est devenu un organe de contrôle des activités de l'appareil d'État et de la plus haute juridiction. Le centre de l'activité législative s'est déplacé directement vers Ekaterina et son bureau avec les secrétaires d'État.
Il était divisé en six départements: le premier (dirigé par le procureur général lui-même) était chargé des affaires d'État et politiques à Saint-Pétersbourg, le second - judiciaire à Saint-Pétersbourg, le troisième - des transports, de la médecine, des sciences, de l'éducation, art, le quatrième - les affaires militaires terrestres et navales, le cinquième - étatique et politique à Moscou et le sixième - le département judiciaire de Moscou.
Commissions cumulées

Une tentative a été faite pour convoquer la Commission Législative, qui systématiserait les lois. L'objectif principal est de clarifier les besoins de la population afin de mener à bien des réformes globales. Le 14 (25 décembre) 1766, Catherine II publie le Manifeste sur la convocation de la commission et les décrets sur la procédure d'élection des députés. Les nobles sont autorisés à élire un député du comté, les citadins - un député de la ville. Plus de 600 députés ont participé à la commission, 33% d'entre eux ont été élus de la noblesse, 36% des citadins, qui comprenaient également des nobles, 20% de la population rurale (paysans de l'Etat). Les intérêts du clergé orthodoxe étaient représentés par un député du Synode. En tant que document directeur de la Commission de 1767, l'Impératrice a préparé "l'Ordre" - un fondement théorique de l'absolutisme éclairé. Selon VA Tomsinov, Catherine II, déjà en tant qu'auteur de "l'Ordre ..." peut être classée parmi la galaxie des juristes russes de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cependant, V.O. Klyuchevsky a appelé "l'Ordre" "une compilation de la littérature éducative de l'époque", et K. Valishevsky - "un travail d'étudiant médiocre", copié à partir d'œuvres bien connues. Il est bien connu qu'il a été presque entièrement réécrit à partir des ouvrages de Montesquieu « Sur l'esprit des lois » et de Beccaria « Sur les crimes et les châtiments », que Catherine elle-même a reconnus. Comme elle l'écrit elle-même dans une lettre à Frédéric II, « dans cet ouvrage, je ne possède que l'arrangement du matériel, et à certains endroits une ligne, un mot ».
La première réunion a eu lieu dans la salle à facettes à Moscou, puis les réunions ont été déplacées à Saint-Pétersbourg. Les réunions et les débats ont duré un an et demi, après quoi la Commission a été dissoute, sous prétexte de la nécessité pour les députés d'entrer en guerre avec l'Empire ottoman, bien qu'il ait été prouvé plus tard par les historiens qu'il n'y avait pas une telle nécessité . Selon un certain nombre de contemporains et d'historiens, le travail de la Commission législative était une action de propagande de Catherine II, visant à glorifier l'Impératrice et à créer son image favorable en Russie et à l'étranger. Comme l'a noté A. Truaya, les premières réunions de la Commission législative ont été consacrées uniquement à la façon de nommer l'impératrice en remerciement de son initiative de convoquer la commission. À la suite d'un long débat, parmi toutes les propositions ("La plus sage", "Mère de la patrie", etc.), le titre a été choisi, qui a survécu dans l'histoire - "Catherine la Grande"
Réforme provinciale

Sous Catherine, le territoire de l'empire a été divisé en provinces, dont beaucoup sont restées pratiquement inchangées jusqu'à la Révolution d'Octobre. Le territoire de l'Estonie et de la Livonie, à la suite de la réforme régionale de 1782-1783, a été divisé en deux provinces - Riga et Revel - avec des institutions qui existaient déjà dans d'autres provinces de Russie. En outre, l'ordre balte spécial a été supprimé, qui prévoyait des droits de travail plus étendus pour les nobles locaux et la personnalité d'un paysan que celle des propriétaires terriens russes. La Sibérie était divisée en trois provinces : Tobolsk, Kolyvan et Irkoutsk.
"L'institution pour l'administration des provinces de l'Empire panrusse" a été adoptée le 7 (18 novembre) 1775. Au lieu d'une division administrative à trois niveaux - une province, une province, un district, une structure à deux niveaux a commencé à fonctionner - une vice-gérance, un district (qui était basé sur le principe d'une population en bonne santé). Des 23 provinces précédentes, 53 gouvernorats ont été formés, dans chacun desquels vivaient 350 à 400 000 âmes masculines. Les gouvernorats étaient divisés en 10-12 comtés, chacun avec 20 à 30 000 âmes masculines.
Comme il n'y avait clairement pas assez de villes - centres de district, Catherine II a renommé de nombreuses grandes agglomérations rurales en villes, en faisant des centres administratifs. Ainsi, 216 nouvelles villes sont apparues. La population des villes a commencé à être appelée bourgeoise et marchande. La principale autorité du district était le tribunal inférieur de Zemstvo, dirigé par un capitaine de police élu par la noblesse locale. Un trésorier de comté et un arpenteur de comté ont été nommés dans les comtés, sur le modèle des provinces.
Le gouverneur général a gouverné plusieurs gouvernorats, dirigés par des gouverneurs (gouverneurs), herald-fiscal et refatgei. Le gouverneur général disposait de pouvoirs administratifs, financiers et judiciaires étendus ; toutes les unités et équipes militaires situées dans les provinces lui étaient subordonnées. Le gouverneur général relevait directement de l'empereur. Les gouverneurs généraux étaient nommés par le Sénat. Les procureurs provinciaux et les tiuns étaient subordonnés aux gouverneurs généraux.
Les finances dans les gouvernorats étaient gérées par la Chambre du Trésor dirigée par le vice-gouverneur avec l'appui de la Chambre des comptes. L'arpenteur provincial à la tête des fouilles s'occupait de la gestion des terres. L'organe exécutif du gouverneur (gouverneur) était le gouvernement provincial, qui exerçait une supervision générale sur les activités des institutions et des fonctionnaires. L'Ordre de la Charité Publique était chargé des écoles, des hôpitaux et des refuges (fonctions sociales), ainsi que des institutions judiciaires immobilières : la Cour supérieure de Zemsky pour la noblesse, le magistrat provincial, qui examinait les litiges entre les habitants, et le Haut-Massacre pour la procès des paysans de l'État. La chambre criminelle et civile jugeait toutes les successions, étaient les plus hautes instances judiciaires des provinces
Le capitaine officier de police - était à la tête du district, le chef de la noblesse, élu par lui pour trois ans. Il était l'organe exécutif du gouvernement provincial. Dans les comtés, comme dans les provinces, il y a des domaines : pour la noblesse (le tribunal du comté), pour les citadins (le magistrat de la ville) et pour les paysans de l'État (moins de représailles). Il y avait un trésorier de comté et un arpenteur de comté. Les représentants des domaines siégeaient dans les tribunaux.
Un tribunal consciencieux est appelé à arrêter les conflits et à réconcilier ceux qui se disputent et se querellent. Ce jugement n'était pas littéral. Le Sénat devient la plus haute instance judiciaire du pays.
La ville a été retirée dans une unité administrative distincte. A la place du gouverneur, un gouverneur était nommé à sa tête, doté de tous les droits et pouvoirs. Un contrôle policier strict a été introduit dans les villes. La ville était divisée en parties (districts), qui étaient sous la surveillance d'un huissier privé, et les parties étaient divisées en quartiers contrôlés par le surveillant de quartier.

Les historiens notent un certain nombre de lacunes de la réforme provinciale menée sous Catherine II. Ainsi, N.I. Pavlenko écrit que la nouvelle division administrative ne tenait pas compte des liens existants de la population avec les centres commerciaux et administratifs, ignorait la composition ethnique de la population (par exemple, le territoire de la Mordovie était divisé entre 4 provinces): sur le corps vivant "". K. Valishevsky estime que les innovations de la cour étaient "très controversées par essence", et les contemporains ont écrit qu'elles avaient entraîné une augmentation du volume de la corruption, car il était désormais nécessaire de verser un pot-de-vin non pas à un, mais à plusieurs juges. , dont le nombre a été multiplié par plusieurs.
Notant que l'importance de la réforme provinciale était « énorme et fructueuse à divers égards », ND Chechulin souligne qu'en même temps elle était très coûteuse, car elle nécessitait des coûts supplémentaires pour de nouvelles institutions. Même selon les calculs préliminaires du Sénat, sa mise en œuvre aurait dû entraîner une augmentation des dépenses totales du budget de l'État de 12 à 15 % ; cependant, ces considérations ont été traitées « avec une étrange frivolité » ; peu après l'achèvement de la réforme, des déficits budgétaires chroniques ont commencé, qui n'ont pu être éliminés qu'à la fin du règne. En général, les coûts de gestion interne sous le règne de Catherine II ont augmenté de 5,6 fois (de 6,5 millions de roubles en 1762 à 36,5 millions de roubles en 1796) - bien plus que, par exemple, les coûts de l'armée (2,6 fois) et plus de sous aucun autre règne au cours des XVIII-XIX siècles.
Parlant des raisons de la réforme provinciale sous Catherine, N.I. Pavlenko écrit qu'il s'agissait d'une réponse à la guerre des paysans de 1773-1775 sous la direction de Pougatchev, qui a révélé la faiblesse des autorités locales et leur incapacité à faire face aux émeutes paysannes. La réforme a été précédée d'une série de notes soumises au gouvernement par la noblesse, dans lesquelles il était recommandé de multiplier le réseau d'institutions et de "surveillants de police" dans le pays.
Liquidation du Zaporizhzhya Sich

Réforme dans la province de Novorossiysk en 1783-1785 conduit à une modification de la structure régimentaire (anciens régiments et centaines) vers une division administrative commune de l'Empire russe en provinces et comtés, l'établissement définitif du servage et l'égalisation des droits du contremaître cosaque avec la noblesse russe. Avec la conclusion du traité Kuchuk-Kainardzhiyskiy (1774), la Russie a obtenu l'accès à la mer Noire et à la Crimée.
Ainsi, il n'était pas nécessaire de préserver les droits spéciaux et le système de contrôle des cosaques de Zaporozhye. Dans le même temps, leur mode de vie traditionnel entraînait souvent des conflits avec les autorités. Après des pogroms répétés de colons serbes, ainsi que dans le cadre du soutien au soulèvement de Pougatchev par les cosaques, Catherine II a ordonné la dissolution du Zaporizhzhya Sich, qui a été faite sur ordre de Grigori Potemkine pour pacifier les cosaques de Zaporizhzhya par le général Peter Tekeli en juin 1775.
Le Sich a été dissous, la plupart des Cosaques ont été dissous et la forteresse elle-même a été détruite. En 1787, Catherine II, accompagnée de Potemkine, se rend en Crimée, où elle est accueillie par la société amazonienne créée pour son arrivée ; la même année, l'armée des fidèles Zaporozhians a été créée, qui est devenue plus tard l'armée des cosaques de la mer Noire, et en 1792, ils ont obtenu le Kouban pour un usage éternel, où les cosaques se sont déplacés, fondant la ville d'Ekaterinodar.
Les réformes sur le Don ont créé un gouvernement civil militaire sur le modèle des administrations provinciales de la Russie centrale. En 1771, le khanat de Kalmouk est finalement annexé à la Russie.
Politique économique

Le règne de Catherine II se caractérise par le développement considérable de l'économie et du commerce, tout en maintenant l'industrie « patriarcale » et Agriculture... Par un décret de 1775, les usines et les installations industrielles ont été reconnues comme propriété, dont la cession ne nécessite pas d'autorisation spéciale des autorités. En 1763, le libre échange de l'argent du cuivre contre de l'argent a été interdit, afin de ne pas provoquer le développement de l'inflation. Le développement et la revitalisation du commerce ont été facilités par l'émergence de nouveaux établissements de crédit et l'expansion des opérations bancaires (en 1770, la Noble Bank a commencé à accepter des dépôts pour la garde). En 1768, des billets de banque d'État ont été créés à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et depuis 1769, pour la première fois, l'émission de papier-monnaie - billets de banque (ces banques ont été fusionnées en une seule banque d'affectation d'État) a été établie.
Une réglementation étatique des prix du sel a été introduite, qui était l'un des biens vitaux du pays. Le Sénat a légiféré le prix du sel à 30 kopecks par poud (au lieu de 50 kopecks) et à 10 kopecks par poud dans les régions de salaison en masse du poisson. Sans introduire un monopole d'État sur le commerce du sel, Catherine compte sur une concurrence accrue et à terme sur une amélioration de la qualité de la marchandise. Cependant, le prix du sel a été bientôt augmenté à nouveau. Au début du règne, certains monopoles sont abolis : le monopole d'État sur le commerce avec la Chine, le monopole privé du marchand Shemyakin sur l'importation de la soie, et d'autres.
Le rôle de la Russie dans l'économie mondiale a augmenté - le linge de voile russe a été exporté en grande quantité vers l'Angleterre, les exportations de fonte et de fer ont augmenté vers d'autres pays européens (la consommation de fonte sur le marché intérieur russe a également considérablement augmenté). Mais l'exportation de matières premières s'est particulièrement développée : bois (5 fois), chanvre, soies, etc., ainsi que le pain. Le volume des exportations du pays est passé de 13,9 millions de roubles. en 1760 à 39,6 millions de roubles. en 1790
Les navires marchands russes ont également commencé à naviguer en Méditerranée. Cependant, leur nombre était insignifiant par rapport aux navires étrangers - seulement 7% du nombre total de navires servant le commerce extérieur russe à la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle; le nombre de navires marchands étrangers qui entraient chaque année dans les ports russes pendant la période de son règne est passé de 1340 à 2430.
Comme l'a souligné l'historien économique NARozhkov, dans la structure des exportations à l'époque de Catherine, il n'y avait aucun produit fini, seulement des matières premières et des produits semi-finis, et 80 à 90 % des importations étaient des produits manufacturés étrangers, le volume dont les importations étaient plusieurs fois supérieures à la production nationale. Ainsi, le volume de la production manufacturière nationale en 1773 était de 2,9 millions de roubles, le même qu'en 1765, et le volume des importations au cours de ces années était d'environ 10 millions de roubles.L'industrie s'est mal développée, il n'y a eu pratiquement aucune amélioration technique et le travail de servage a prévalu. . Ainsi, d'année en année, les fabriques de draps ne pouvaient même plus satisfaire les besoins de l'armée, malgré l'interdiction de vendre du drap "à côté", de plus, le drap était de mauvaise qualité, et devait être acheté à l'étranger. Catherine elle-même ne comprenait pas l'importance de la révolution industrielle en cours en Occident et affirmait que les machines (ou, comme elle les appelait, les "colosses") nuisaient à l'État, car elles réduisent le nombre de travailleurs. Seules deux industries d'exportation se sont développées rapidement. - la production de fer et de lin, mais les deux - sur la base de méthodes « patriarcales », sans l'utilisation de nouvelles technologies qui ont été activement introduites à cette époque en Occident - qui ont prédéterminé une grave crise dans les deux industries, qui a commencé peu après la mort de Catherine II.
Monogramme EII sur une pièce de 1765
Dans le domaine du commerce extérieur, la politique de Catherine a été une transition progressive du protectionnisme, caractéristique d'Elizabeth Petrovna, à la libéralisation complète des exportations et des importations, qui, selon de nombreux historiens de l'économie, était une conséquence de l'influence des idées de physiocrates. Déjà dans les premières années du règne, un certain nombre de monopoles du commerce extérieur et une interdiction d'exporter des céréales, qui commençaient à se développer rapidement, furent abolis. En 1765, la Free Economic Society a été fondée, qui a promu les idées du libre-échange et a publié son propre magazine. En 1766, un nouveau tarif douanier a été introduit, qui a considérablement réduit les barrières tarifaires par rapport au tarif protectionniste de 1757 (qui établissait des droits protecteurs à un taux de 60 à 100 % ou plus) ; ils furent encore réduits dans le tarif douanier de 1782. Ainsi, dans le tarif « modérément protectionniste » de 1766, les droits protecteurs étaient en moyenne de 30 %, et dans le tarif libéral de 1782 - 10 %, uniquement pour certaines marchandises s'élevant à 20 %. trente %.
L'agriculture, comme l'industrie, s'est développée principalement par des méthodes extensives (augmentation de la superficie des terres arables) ; la promotion des méthodes agricoles intensives par la Société Économique créée sous Catherine la Société Économique Libre n'eut pas beaucoup de résultat. Dès les premières années du règne de Catherine, la famine commença périodiquement à surgir dans les campagnes, que certains contemporains attribuaient à des mauvaises récoltes chroniques, mais l'historien M.N. , 3 millions de roubles. dans l'année. Les cas de ruine massive de paysans sont devenus plus fréquents. Les Holodomors sont devenus particulièrement répandus dans les années 1780, lorsqu'ils ont couvert de vastes régions du pays. Les prix du pain ont fortement augmenté : par exemple, dans le centre de la Russie (Moscou, Smolensk, Kaluga), ils sont passés de 86 kopecks. en 1760 jusqu'à 2,19 roubles. en 1773 et jusqu'à 7 roubles. en 1788, soit plus de 8 fois.
Introduit en circulation en 1769, le papier-monnaie - les billets de banque - au cours de la première décennie de son existence ne représentait que quelques pour cent de la masse monétaire en métal (argent et cuivre) et a joué un rôle positif, permettant à l'État de réduire ses coûts de déplacement. l'argent au sein de l'empire. Dans son manifeste du 28 juin 1786, Catherine promet solennellement que « le nombre des billets de banque ne doit jamais et en aucun cas dépasser cent millions de roubles dans notre État ». Cependant, en raison du manque d'argent dans le trésor, qui est devenu un phénomène constant, depuis le début des années 1780, un nombre croissant de billets de banque ont été émis, dont le volume a atteint 156 millions de roubles en 1796, et leur valeur s'était dépréciée. 1,5 fois. En outre, l'État a emprunté de l'argent à l'étranger pour un montant de 33 millions de roubles. et avait diverses obligations internes impayées (factures, salaires, etc.) d'un montant de 15,5 millions de roubles. Cette. le montant total des dettes du gouvernement s'élevait à 205 millions de roubles, le trésor était vide et les dépenses budgétaires dépassaient considérablement les revenus, comme l'a déclaré Paul Ier lors de l'accession au trône. L'émission de billets d'un montant dépassant la limite solennellement établie de 50 millions de roubles a donné à l'historien ND Chechulin la base de ses recherches économiques pour tirer une conclusion sur la "grave crise économique" dans le pays (dans la seconde moitié du règne de Catherine II) et « l'effondrement complet du système financier du règne de Catherine ». La conclusion générale de ND Chechulin était que "le côté financier et en général le côté économique est le côté le plus faible et le plus sombre du règne de Catherine". Les emprunts extérieurs de Catherine II et les intérêts courus sur eux n'ont été entièrement remboursés qu'en 1891.
La corruption. Favoritisme
... Dans les ruelles du village de Sarskoye ...
La vieille dame a vécu
Sympa et un peu prodigue
Voltaire était le premier ami,
Elle a écrit l'ordre, les flottes ont brûlé,
Et elle est morte en montant à bord du navire.
Depuis, la brume.
La Russie, pays pauvre,
Ta gloire étranglée
Elle est décédée avec Catherine.
A. Pouchkine, 1824
Au début du règne de Catherine en Russie, un système de corruption, d'arbitraire et d'autres abus de la part des fonctionnaires était profondément enraciné, comme elle l'a elle-même fortement annoncé peu après son accession au trône. Le 18 (29) juillet 1762, trois semaines seulement après le début du règne, elle publie un Manifeste sur la convoitise, dans lequel elle constate de nombreux abus dans le domaine du gouvernement et de la justice et déclare lutter contre eux. Cependant, comme l'a écrit l'historien VA Bilbasov, « Catherine est vite devenue elle-même convaincue que la « corruption dans les affaires de l'État » n'est pas éradiquée par des décrets et des manifestes, que cela nécessite une réforme radicale de l'ensemble du système étatique - une tâche... la portée de cette époque, pas même plus tard. "
Il existe de nombreux exemples de corruption officielle et d'abus liés à son règne. Un exemple frappant est le procureur général du Sénat Glebov. Par exemple, il ne s'est pas arrêté avant de retirer les baux viticoles délivrés par les autorités locales de province et de les revendre à « ses » clients, qui leur ont offert beaucoup d'argent. Envoyé par lui à Irkoutsk, même sous le règne d'Elizabeth Petrovna, l'enquêteur Krylov avec un détachement de cosaques a saisi des marchands locaux et leur a extorqué de l'argent, a persuadé de force leurs femmes et leurs filles de cohabiter, a arrêté le vice-gouverneur d'Irkoutsk, Wulf, et y a essentiellement établi son propre pouvoir.
Il y a un certain nombre de références à des abus de la part du favori de Catherine, Grigory Potemkin. Par exemple, comme l'a écrit l'ambassadeur d'Angleterre Gunning dans ses rapports, Potemkine « a utilisé son propre pouvoir et malgré le Sénat pour disposer des rançons du vin d'une manière défavorable au trésor ». En 1785-1786. le prochain favori de Catherine, Alexandre Ermolov, plus tôt - l'adjudant de Potemkine, a accusé ce dernier d'avoir détourné des fonds alloués au développement de la Biélorussie. Potemkine lui-même, s'excusant, déclara qu'il n'avait fait qu'« emprunter » cet argent au trésor. Un autre fait est cité par l'historien allemand T. Griesinger, qui souligne que les dons généreux reçus par Potemkine des jésuites ont joué un rôle important en permettant à leur ordre d'ouvrir leur siège en Russie (après l'interdiction des jésuites dans toute l'Europe).
Comme le souligne N.I. Pavlenko, Catherine II a fait preuve d'une douceur excessive par rapport non seulement à ses favoris, mais aussi à d'autres fonctionnaires qui se sont souillés de convoitise ou d'autres méfaits. Ainsi, le procureur général du Sénat, Glebov (que l'impératrice elle-même a appelé « un voyou et un escroc »), n'a été démis de ses fonctions qu'en 1764, bien qu'à cette époque une longue liste de plaintes et d'affaires ouvertes contre lui se soit accumulée. Lors des événements de l'émeute de la peste à Moscou en septembre 1771, le commandant en chef de Moscou, PS Saltykov, fit preuve de lâcheté, effrayé par l'épidémie et le déclenchement des émeutes, écrivit à l'impératrice une lettre de démission et partit aussitôt pour le patrimoine de Moscou, laissant Moscou à la merci d'une foule folle qui organisait des pogroms et des meurtres dans toute la ville. Catherine n'a fait qu'accéder à sa demande de démission et ne l'a en aucun cas puni.
Ainsi, malgré la forte augmentation du coût d'entretien de l'appareil bureaucratique pendant son règne, les abus n'ont pas diminué. Peu de temps avant sa mort, en février 1796, F. I. Rostopchin écrivait : « Jamais les crimes n'ont été aussi fréquents qu'aujourd'hui. Leur impunité et leur audace ont atteint des limites extrêmes. Il y a trois jours, un certain Kovalinsky, ancien secrétaire de la commission militaire et chassé par l'impératrice pour malversations et corruption, est désormais nommé gouverneur de Riazan, car il a un frère, un scélérat comme lui, qui est ami avec Gribovsky, le chef du bureau de Platon Zubov. Ribas à lui seul vole jusqu'à 500 000 roubles par an. »
Un certain nombre d'exemples d'abus et de détournements de fonds sont associés aux favoris de Catherine, ce qui, apparemment, n'est pas accidentel. Comme l'écrit N.I. Pavlenko, ils étaient "pour la plupart des accapareurs, soucieux d'intérêts personnels et non du bien-être de l'État".
Le favoritisme même de cette époque, qui, selon K. Valishevsky, «sous Catherine est devenu presque une institution de l'État», peut servir d'exemple, sinon de corruption, alors de dépenses excessives de fonds publics. Ainsi, les contemporains ont calculé que les cadeaux à seulement 11 des principaux favoris de Catherine et le coût de leur entretien s'élevaient à 92 millions 820 mille roubles, ce qui dépassait le montant des dépenses annuelles du budget de l'État de cette époque et était comparable au montant de la dette extérieure et intérieure de l'Empire russe, formé à la fin de son règne. "Elle semblait acheter l'amour de ses favoris", écrit N. I. Pavlenko, "jouait à l'amour", notant que ce jeu coûtait très cher à l'Etat.
En plus de cadeaux exceptionnellement généreux, les favoris ont également reçu des ordres, des grades militaires et officiels, en règle générale, sans aucun mérite, ce qui a eu un effet démoralisant sur les fonctionnaires et les militaires et n'a pas contribué à augmenter l'efficacité de leur service. Par exemple, étant très jeune et ne brillant d'aucun mérite, Alexander Lanskoy, en 3-4 ans "d'amitié" avec l'impératrice, a réussi à recevoir les ordres d'Alexandre Nevsky et de Sainte-Anne, le grade de lieutenant général et d'adjudant général , Ordres polonais de l'Aigle blanc et de Saint-Stanislav et de l'Ordre suédois L'étoile polaire ; et aussi pour faire fortune d'un montant de 7 millions de roubles.Comme l'a écrit un contemporain du diplomate français de Catherine Masson, son Platon Zubov préféré avait tellement de récompenses qu'il ressemblait à "un vendeur de rubans et de quincaillerie".
Outre les favoris eux-mêmes, la générosité de l'impératrice était véritablement sans bornes vis-à-vis des diverses personnalités proches de la cour ; leurs proches; aristocrates étrangers, etc. Ainsi, pendant son règne, elle a donné un total de plus de 800 000 paysans. Elle versait chaque année environ 100 000 roubles pour l'entretien de la nièce de Grigori Potemkine, et lui donnait ainsi qu'à son fiancé 1 million de roubles pour le mariage. Elle abritait « une foule de courtisans français qui avaient une nomination plus ou moins officielle à la cour de Catherine ». (Baron de Breteuil, prince de Nassau, marquis Bombell, Calonne, comte d'Esterhazy, comte de Saint-Prix et autres), qui ont également reçu des cadeaux inédits dans leur générosité (par exemple, Esterhazy - 2 millions de livres).
Des sommes importantes ont été versées à des représentants de l'aristocratie polonaise, dont le roi Stanislaw Poniatowski (dans le passé - son préféré), "planté" par elle sur le trône polonais. Comme l'écrit VO Klyuchevsky, la nomination même de la candidature de Catherine à Poniatowski comme roi de Pologne « a entraîné une série de tentations » : « Tout d'abord, il a fallu se procurer des centaines de milliers de chervones pour soudoyer les magnats polonais qui faisaient le commerce des patrie..." Depuis ce temps, les sommes du trésor de l'État russe avec la main légère de Catherine II ont coulé dans les poches de l'aristocratie polonaise - en particulier, c'est ainsi que l'assentiment de cette dernière aux divisions du Commonwealth polono-lituanien a été acquis.
Éducation, sciences, santé
En 1768, un réseau d'écoles urbaines basé sur le système de classe a été créé. Les écoles ont commencé à ouvrir activement. Sous Catherine, une attention particulière a été accordée au développement de l'éducation des femmes, en 1764 l'Institut Smolny pour les filles nobles et la Société éducative pour les filles nobles ont été ouverts. L'Académie des sciences est devenue l'une des principales bases scientifiques d'Europe. Un observatoire, une étude de physique, un théâtre anatomique, un jardin botanique, des ateliers instrumentaux, une imprimerie, une bibliothèque et des archives furent fondés. L'Académie russe a été fondée le 11 octobre 1783.
Dans le même temps, les historiens n'apprécient pas les progrès dans le domaine de l'éducation et de la science. L'écrivain A. Truaya souligne que le travail de l'académie était principalement basé non pas sur la culture de son propre personnel, mais sur l'invitation d'éminents scientifiques étrangers (Euler, Pallas, Boehmer, Storch, Kraft, Miller, Wachmeister, Georgi, Klinger, etc.), cependant, « rester tous ces scientifiques à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg n'a pas enrichi le trésor de la connaissance humaine ». V.O. Klyuchevsky écrit à ce sujet, se référant au témoignage d'un contemporain de Manstein. Il en va de même pour l'éducation. Selon V.O. Klyuchevsky, lorsque l'Université de Moscou a été fondée en 1755, elle comptait 100 étudiants et après 30 ans - seulement 82. ont reçu un diplôme scientifique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi les examens. L'étude était mal organisée (l'enseignement était dispensé en français ou en latin), et les nobles étaient très réticents à étudier. La même pénurie d'étudiants était présente dans deux académies maritimes, qui ne pouvaient même pas recruter les 250 étudiants requis par l'État.

Dans les provinces, il y avait des ordres de charité publique. A Moscou et à Saint-Pétersbourg - Orphelinats pour enfants des rues, où ils ont reçu une éducation et une éducation. Le Trésor des veuves a été créé pour aider les veuves.
La vaccination obligatoire contre la variole est instaurée et Catherine décide de donner un exemple personnel à ses sujets : dans la nuit du 12 (23 octobre) 1768, l'impératrice elle-même est vaccinée contre la variole. Parmi les premiers vaccinés figuraient également le Grand-Duc Pavel Petrovitch et la Grande-Duchesse Maria Feodorovna. Sous Catherine II, la lutte contre les épidémies en Russie commença à acquérir le caractère de mesures étatiques qui relevaient directement des compétences du Conseil impérial et du Sénat. Sur ordre de Catherine, des avant-postes ont été créés, situés non seulement aux frontières, mais également sur les routes menant au centre de la Russie. La « Charte des quarantaines frontalières et portuaires » a été créée.
De nouvelles directions de médecine pour la Russie se sont développées : des hôpitaux pour le traitement de la syphilis, des hôpitaux psychiatriques et des orphelinats ont été ouverts. Un certain nombre d'ouvrages fondamentaux sur la médecine ont été publiés.
Politique nationale
Après l'annexion des terres qui faisaient auparavant partie du Commonwealth à l'Empire russe, environ un million de Juifs se sont retrouvés en Russie - un peuple avec une religion, une culture, un mode de vie et un mode de vie différents. Pour empêcher leur réinstallation dans les régions centrales de la Russie et les rattacher à leurs communautés pour la commodité de la perception des impôts de l'État, Catherine II a établi en 1791 le Pale of Settlement, à l'extérieur duquel les Juifs n'avaient pas le droit de vivre. Le Pale of Settlement a été établi au même endroit où les Juifs avaient vécu auparavant - sur les terres annexées à la suite des trois partages de la Pologne, ainsi que dans les régions steppiques près de la mer Noire et les territoires peu peuplés à l'est du Dniepr . La conversion des Juifs à l'Orthodoxie a supprimé toutes les restrictions à la vie. Il est à noter que le Pale of Settlement a contribué à la préservation de l'identité nationale juive, la formation d'une identité juive spéciale au sein de l'Empire russe.
En 1762-1764, Catherine publie deux manifestes. Le premier - "Sur l'autorisation pour tous les étrangers d'entrer en Russie, de s'installer dans les provinces qu'ils souhaitent et sur les droits qui leur sont accordés" a appelé les sujets étrangers à s'installer en Russie, le second a déterminé la liste des avantages et privilèges des migrants. Bientôt, les premières colonies allemandes sont apparues dans la région de la Volga, réservées aux immigrants. L'afflux de colons allemands était si important que déjà en 1766, il était nécessaire de suspendre temporairement l'accueil de nouveaux colons jusqu'à l'installation de ceux qui étaient déjà entrés. La création de colonies sur la Volga ne cesse d'augmenter : en 1765 - 12 colonies, en 1766 - 21, en 1767 - 67. Selon le recensement des colons en 1769, 6,5 mille familles vivaient dans 105 colonies sur la Volga, ce qui s'élevait à 23,2 mille personnes. À l'avenir, la communauté allemande jouera un rôle important dans la vie de la Russie.
Sous le règne de Catherine, le pays comprenait la région nord de la mer Noire, la région d'Azov, la Crimée, la Novorossie, les terres entre le Dniestr et le Bug, la Biélorussie, la Courlande et la Lituanie. Le nombre total de nouveaux sujets ainsi acquis par la Russie a atteint 7 millions. En conséquence, comme l'a écrit V.O. Klyuchevsky, dans l'Empire russe "les conflits d'intérêts" entre les différents peuples ont augmenté. Cela s'exprimait notamment par le fait que, pour presque toutes les nationalités, le gouvernement était contraint d'introduire un régime économique, fiscal et administratif spécial : ainsi, les colons allemands étaient totalement exonérés de l'impôt à l'État et d'autres droits ; le Pale of Settlement a été introduit pour les Juifs; de la population ukrainienne et biélorusse sur le territoire de l'ancienne Rzeczpospolita, la capitation n'a d'abord pas été prélevée du tout, puis elle a été prélevée en deux. La population la plus discriminée dans ces conditions s'est avérée être la population indigène, ce qui a conduit à un tel incident : certains nobles russes de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. en récompense de leurs services, on leur a demandé d'être « enregistrés en tant qu'Allemands » afin de pouvoir bénéficier des privilèges appropriés.
Politique des successions
Noblesse et citadins... Le 21 avril 1785, deux lettres sont délivrées : « Certificat des droits, libertés et avantages de la noblesse noble » et « Certificat d'honneur aux villes ». L'Impératrice les appelait le couronnement de son activité, et les historiens les considèrent comme le couronnement de la « politique pro-noblesse » des rois du XVIIIe siècle. Comme l'écrit N.I. Pavlenko : « Dans l'histoire de la Russie, la noblesse n'a jamais été dotée d'une telle variété de privilèges que sous Catherine II. »
Les deux chartes ont finalement garanti aux états supérieurs les droits, devoirs et privilèges qui avaient déjà été accordés par les prédécesseurs de Catherine au XVIIIe siècle, et en ont fourni un certain nombre de nouveaux. Ainsi, la noblesse en tant que domaine a été constituée par décrets de Pierre Ier et a reçu en même temps un certain nombre de privilèges, notamment l'exemption de la capitation et le droit de disposer des domaines sans restriction; et par le décret de Pierre III, il a finalement été libéré du service obligatoire à l'État.
Certificat d'appréciation à la noblesse:
- Les droits déjà existants ont été confirmés.
- la noblesse s'affranchit du cantonnement des unités et équipes militaires
- des châtiments corporels
- la noblesse reçut la propriété des entrailles de la terre
- le droit d'avoir leurs propres institutions successorales
- le nom du 1er domaine a changé : non pas "noblesse", mais "noble noblesse".
- il était interdit de confisquer les domaines des nobles pour des délits criminels ; les biens devaient être transférés aux héritiers légaux.
- les nobles ont la propriété exclusive de la terre, mais la Lettre ne dit pas un mot du droit de monopole d'avoir des serfs.
- Les contremaîtres ukrainiens étaient égaux en droits avec les nobles russes.
- un noble qui n'avait pas le grade d'officier était privé du droit de vote.
- seuls les nobles, dont les revenus des domaines dépassaient 100 roubles, pouvaient occuper des postes électifs.
Diplôme des droits et avantages des villes de l'Empire russe:
- le droit du haut de la classe marchande de ne pas payer la capitation a été confirmé.
- remplacement du recrutement par une contribution en espèces.
La division de la population urbaine en 6 catégories :
- "Vrais citadins" - propriétaires ("Les vrais citadins sont ceux qui ont une maison ou une autre structure ou un lieu ou un terrain dans cette ville")
- marchands des trois guildes (le capital le plus bas pour les marchands de la 3e guilde est de 1000 roubles)
- artisans inscrits dans les corporations.
- commerçants étrangers et non résidents.
- citoyens éminents - marchands au capital de plus de 50 000 roubles, riches banquiers (au moins 100 000 roubles), ainsi que l'intelligentsia urbaine: architectes, peintres, compositeurs, scientifiques.
- Posad personnes qui « se nourrissent de métiers, d'artisanat et de travail » (qui n'ont pas de biens immobiliers en ville).
Les représentants des 3e et 6e catégories étaient appelés "bourgeois" (le mot venait de la langue polonaise à travers l'Ukraine et la Biélorussie, signifiait à l'origine " citadin " ou " citadin ", du mot " lieu " - une ville et " shtetl " - une ville).
Les marchands des 1re et 2e guildes et les citoyens éminents étaient exemptés des châtiments corporels. Les représentants de la 3ème génération de citoyens éminents ont été autorisés à déposer une requête pour l'appropriation de la noblesse.
L'octroi d'un maximum de droits et privilèges à la noblesse et sa libération totale de ses devoirs vis-à-vis de l'État ont conduit à l'émergence d'un phénomène largement couvert dans la littérature de l'époque (la comédie "Mineure" de Fonvizin, la revue " Truten" de Novikov, etc.) et dans des ouvrages historiques. Comme l'écrivait VO Klyuchevsky, le noble de l'époque de Catherine « était un phénomène très étrange : les manières, les habitudes, les concepts, les sentiments qu'il maîtrisait, la langue même dans laquelle il pensait - tout était étranger, tout était importé, mais il n'avait pas un foyer sans liens organiques vivants avec les autres, sans affaires sérieuses... en Occident, à l'étranger, ils le voyaient comme un Tatar déguisé, et en Russie ils le considéraient comme s'il était un Français né par hasard en Russie ».
Malgré les privilèges, à l'époque de Catherine II, les inégalités de propriété se sont fortement accrues au sein de la noblesse : sur fond de grandes fortunes individuelles, la situation économique d'une partie de la noblesse s'est dégradée. Comme le souligne l'historien D.Blum, nombre de grands nobles possédaient des dizaines et des centaines de milliers de serfs, ce qui n'était pas le cas sous les règnes précédents (lorsque le propriétaire de plus de 500 âmes était considéré comme riche) ; en même temps, près des 2/3 de tous les propriétaires terriens en 1777 avaient moins de 30 âmes serfs mâles, et 1/3 des propriétaires terriens avaient moins de 10 âmes ; de nombreux nobles souhaitant entrer dans la fonction publique n'avaient pas les moyens d'acheter des vêtements et des chaussures appropriés. V.O. Klyuchevsky écrit que de nombreux enfants nobles sous son règne, devenant même des étudiants de l'académie maritime et «recevant un petit salaire (bourses), 1 rouble chacun. par mois, «de pieds nus», ils ne pouvaient même pas fréquenter l'académie et étaient obligés, selon le rapport, de ne pas penser aux sciences, mais à leur propre nourriture, à côté d'acquérir des fonds pour leur entretien ».
Paysannerie... Les paysans à l'époque de Catherine représentaient environ 95% de la population et les serfs représentaient plus de 90% de la population, tandis que les nobles ne représentaient que 1% et le reste des domaines - 9%. D'après la réforme de Catherine, les paysans ne payaient pas de fermage dans les régions de terres noires, mais les terres noires élaboraient la corvée. Selon l'opinion générale des historiens, la position de ce groupe le plus important de la population à l'époque de Catherine était la pire de toute l'histoire de la Russie. De nombreux historiens comparent la situation des serfs de cette époque à celle des esclaves. Comme l'écrit V. O. Klyuchevsky, les propriétaires terriens « ont transformé leurs villages en plantations d'esclaves, difficiles à distinguer des plantations nord-américaines avant la libération des Noirs » ; et D. Blum conclut que « à la fin du XVIIIe siècle. un serf russe n'était pas différent d'un esclave dans une plantation. " Les nobles, y compris Catherine II elle-même, appelaient souvent les serfs « esclaves », ce qui est bien connu de sources écrites.
Le commerce des paysans atteignit une large échelle : ils étaient vendus sur les marchés, dans des annonces sur les pages des journaux ; ils étaient perdus aux cartes, échangés, donnés, forcés de se marier. Les paysans ne pouvaient pas prêter serment, prendre des loyers et des contrats, ne pouvaient pas se déplacer à plus de 30 miles de leur village sans passeport - l'autorisation du propriétaire foncier et des autorités locales. Selon la loi, le serf était entièrement au pouvoir du propriétaire terrien, ce dernier n'avait pas le droit de le tuer, mais pouvait le torturer à mort - et il n'y avait aucune punition officielle pour cela. Il existe de nombreux exemples d'entretien par des propriétaires terriens de « harems » de serfs et de cachots pour paysans avec bourreaux et instruments de torture. Au cours des 34 années de son règne, dans quelques-uns des cas les plus flagrants (dont Daria Saltykova), les propriétaires terriens ont été punis pour des abus contre les paysans.
Sous le règne de Catherine II, un certain nombre de lois ont été adoptées qui ont aggravé la situation des paysans :
- Le décret de 1763 confia aux paysans eux-mêmes le maintien des commandements militaires envoyés pour réprimer les soulèvements paysans.
- Selon le décret de 1765, pour désobéissance ouverte, le propriétaire terrien pouvait envoyer le paysan non seulement en exil, mais aussi aux travaux forcés, et la durée des travaux forcés était fixée par lui-même; les propriétaires terriens avaient également le droit de renvoyer à tout moment les exilés des travaux forcés.
- Le décret de 1767 interdit aux paysans de se plaindre de leur maître ; les désobéissants étaient menacés d'exil à Nerchinsk (mais ils pouvaient aller en justice),
- En 1783, le servage a été introduit dans la Petite Russie (Ukraine de la rive gauche et la région de la Terre noire russe),
- En 1796 le servage fut introduit à Novorossiya (Don, Caucase du Nord),
- Après les partages de la Rzecz Pospolita, le servage s'est renforcé dans les territoires devenus partie intégrante de l'Empire russe (Rive droite Ukraine, Biélorussie, Lituanie, Pologne).
Comme l'écrit N.I. Pavlenko, sous Catherine « le servage s'est développé en profondeur et en largeur », ce qui était « un exemple de contradiction flagrante entre les idées des Lumières et les mesures gouvernementales visant à renforcer le régime de serf ».
Au cours de son règne, Catherine a donné plus de 800 000 paysans aux propriétaires terriens et aux nobles, établissant ainsi une sorte de record. La plupart d'entre eux n'étaient pas des paysans de l'État, mais des paysans des terres acquises lors de la partition de la Pologne, ainsi que des paysans de palais. Mais, par exemple, le nombre de paysans (dépossédés) assignés de 1762 à 1796. est passé de 210 à 312 000 personnes, et il s'agissait de paysans officiellement libres (de l'État), mais convertis à la position de serfs ou d'esclaves. Les paysans possesseurs des usines de l'Oural ont pris une part active à la guerre paysanne de 1773-1775.
Dans le même temps, la position des paysans monastiques a été assouplie et ils ont été transférés à la juridiction du Collège d'économie avec les terres. Tous leurs devoirs furent remplacés par des quittancements monétaires, qui donnèrent aux paysans plus d'indépendance et développèrent leur initiative économique. En conséquence, l'agitation des paysans du monastère s'est arrêtée.
Clergé supérieur(l'épiscopat) a perdu son existence autonome en raison de la sécularisation des terres ecclésiastiques (1764), qui a donné aux maisons épiscopales et aux monastères la possibilité d'exister sans l'aide de l'État et indépendamment de lui. Après la réforme, le clergé monastique est devenu dépendant de l'État qui les finançait.
Politique religieuse
En général, une politique de tolérance religieuse a été déclarée en Russie sous Catherine II. Ainsi, en 1773, une loi sur la tolérance de toutes les religions fut promulguée, interdisant au clergé orthodoxe de s'immiscer dans les affaires des autres confessions ; le gouvernement séculier se réserve le droit de décider de l'établissement de temples de n'importe quelle confession.
Montée sur le trône, Catherine annule le décret de Pierre III sur la sécularisation des terres proches de l'église. Mais déjà en février. 1764 a de nouveau publié un décret privant l'Église de la propriété foncière. Les paysans monastiques sont au nombre d'environ 2 millions. des deux sexes ont été retirés de la juridiction du clergé et transférés à la direction du Collège d'économie. La juridiction de l'État comprenait les domaines des églises, des monastères et des évêques.
Dans la Petite Russie, la sécularisation des possessions monastiques est réalisée en 1786.
Ainsi, le clergé est devenu dépendant des autorités laïques, car ils ne pouvaient pas exercer d'activités économiques indépendantes.
Catherine a obtenu du gouvernement du Commonwealth polono-lituanien une égalisation des droits des minorités religieuses - orthodoxes et protestantes.
Dans les premières années du règne de Catherine II, la persécution cessa Vieux-croyants... Poursuivant la politique de son époux Pierre III, qui fut renversé par elle, l'Impératrice soutint son initiative de retour des Vieux-croyants et de la population active de l'étranger. Une place leur a été spécialement attribuée sur l'Irgiz (régions modernes de Saratov et de Samara). Ils étaient autorisés à avoir des prêtres.
Cependant, déjà en 1765, la persécution a repris. Le Sénat a décrété que les vieux-croyants n'étaient pas autorisés à construire des églises, et Catherine l'a confirmé par son décret ; les temples déjà construits ont été démolis. Au cours de ces années, non seulement les églises ont été détruites, mais aussi toute la ville des vieux-croyants et des schismatiques (Vetka) dans la Petite Russie, qui a ensuite cessé d'exister. Et en 1772, une secte d'eunuques fut persécutée dans la province d'Oryol. K. Valishevsky pense que la raison de la persécution continue des vieux-croyants et des schismatiques, contrairement aux autres religions, était qu'ils étaient considérés non seulement comme un mouvement religieux, mais aussi comme un mouvement socio-politique. Ainsi, selon la doctrine répandue parmi les schismatiques, Catherine II, avec Pierre Ier, était considérée comme le "tsar-antéchrist".
La libre réinstallation des Allemands en Russie a entraîné une augmentation significative du nombre de Protestants(principalement luthériens) en Russie. Ils ont également été autorisés à construire des églises, des écoles et à accomplir librement des services divins. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait plus de 20 000 luthériens rien qu'à Saint-Pétersbourg.
Par juif la religion conservait le droit à l'exercice public de la foi. Les affaires religieuses et les litiges étaient laissés aux tribunaux juifs. Les Juifs, en fonction de leur capitale, étaient affectés à la classe correspondante et pouvaient être élus dans les organes du gouvernement local, devenir juges et autres fonctionnaires.
Par décret de Catherine II en 1787, le texte arabe complet a été imprimé pour la première fois en Russie dans l'imprimerie de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg islamique du livre saint du Coran pour distribution gratuite aux « Kirghiz ». La publication différait considérablement des publications européennes, principalement en ce qu'elle avait un caractère musulman : le texte destiné à la publication a été préparé par le mollah Usman Ibrahim. A Saint-Pétersbourg, de 1789 à 1798, 5 éditions du Coran ont été publiées. En 1788, un manifeste fut publié, dans lequel l'impératrice ordonnait « d'établir à Oufa une assemblée spirituelle de loi mahométane, qui aurait dans son département tous les rangs spirituels de cette loi, ... à l'exclusion de la région de Tauride ». Ainsi, Catherine a commencé à intégrer la communauté musulmane dans le système de structure étatique de l'empire. Les musulmans ont reçu le droit de construire et de restaurer des mosquées.
bouddhisme a également reçu le soutien du gouvernement dans les régions où il a traditionnellement avoué. En 1764, Catherine établit le poste de Hambo Lama - le chef des bouddhistes de Sibérie orientale et de Transbaïkalie. En 1766, les lamas bouriates ont reconnu Catherine comme l'incarnation du Bodhisattva de Tara Blanche pour sa bienveillance envers le bouddhisme et la règle humaine.
Catherine a autorisé Ordre des Jésuites, qui à cette époque était officiellement interdit dans tous les pays européens (par les décisions des États européens et la bulle du pape), de déplacer son siège en Russie. À l'avenir, elle a patronné l'ordre : elle lui a donné l'opportunité d'ouvrir sa nouvelle résidence à Mogilev, a interdit et confisqué tous les exemplaires publiés de l'histoire « calomnieuse » (à son avis) de l'ordre des Jésuites, a visité leurs institutions et a fourni d'autres courtoisies.
Problèmes politiques intérieurs

Le fait que l'impératrice ait été proclamée femme qui n'y avait aucun droit formel a donné lieu à de nombreux prétendants au trône, qui ont éclipsé une partie importante du règne de Catherine II. Donc, seulement de 1764 à 1773. sept faux Pierre III sont apparus dans le pays (affirmant qu'ils n'étaient rien de plus que le "ressuscité" Pierre III) - A. Aslanbekov, I. Evdokimov, G. Kremnev, P. Chernyshov, G. Ryabov, F. Bogomolov, N. Des croix; le huitième était Emelyan Pougatchev. Et en 1774-1775. à cette liste s'est ajouté le « cas de la princesse Tarakanova », se faisant passer pour la fille d'Elizaveta Petrovna.
Au cours de 1762-1764. 3 complots ont été révélés, visant à renverser Catherine, et deux d'entre eux étaient associés au nom d'Ivan Antonovich - l'ancien empereur russe Ivan VI, qui au moment de l'accession au trône de Catherine II a continué à vivre en prison dans le Shlisselburg forteresse. La première a réuni 70 agents. La seconde eut lieu en 1764, lorsque le lieutenant V. Ya. Mirovich, qui montait la garde dans la forteresse de Chlisselbourg, rassembla à ses côtés une partie de la garnison afin de libérer Ivan. Les gardes, cependant, conformément aux instructions qui leur ont été données, ont poignardé le prisonnier et Mirovich lui-même a été arrêté et exécuté.
En 1771, une épidémie de peste majeure a eu lieu à Moscou, compliquée par des troubles populaires à Moscou, appelée l'émeute de la peste. Les rebelles ont détruit le monastère Miracle au Kremlin. Le lendemain, la foule attaqua le monastère de Donskoï, tua l'archevêque Ambroise qui s'y cachait et commença à détruire les avant-postes de quarantaine et les maisons de la noblesse. Des troupes sous le commandement de G.G. Orlov ont été envoyées pour réprimer le soulèvement. Après trois jours de combats, l'émeute a été réprimée.
Guerre paysanne de 1773-1775

En 1773-1775, il y a eu un soulèvement paysan dirigé par Yemelyan Pugachev. Il couvrait les terres de l'armée de Yaitsk, la province d'Orenbourg, l'Oural, la région de Kama, la Bachkirie, une partie de la Sibérie occidentale, les régions de la Moyenne et de la Basse Volga. Au cours du soulèvement, les Bachkirs, les Tatars, les Kazakhs, les ouvriers des usines de l'Oural et de nombreux serfs de toutes les provinces où se déroulaient les hostilités, rejoignirent les Cosaques. Après la répression du soulèvement, certaines réformes libérales ont été réduites et le conservatisme a augmenté.
Principales étapes :
- septembre 1773 - mars 1774
- mars 1774 - juillet 1774
- juillet 1774-1775
Le 17 (28) septembre 1773, un soulèvement commence. Près de la ville de Yaitsky, des détachements gouvernementaux, allant réprimer la rébellion, passent du côté de 200 cosaques. Sans prendre la ville, les rebelles se rendent à Orenbourg.
Mars - juillet 1774 - les rebelles s'emparent des usines de l'Oural et de la Bachkirie. Les rebelles sont vaincus à la forteresse de la Trinité. Le 12 juillet, Kazan est capturé. Le 17 juillet, ils subissent à nouveau une défaite et se replient sur la rive droite de la Volga.
Les historiens pensent que la guerre paysanne de 1773-1775. a été l'une des manifestations d'une crise sociale aiguë qui a éclaté au milieu du règne de Catherine, qui a été marqué par de nombreux soulèvements dans Différents composants(le soulèvement de Kiji à Zaonezhie en 1769-1770, l'émeute de la peste de 1771 à Moscou, le soulèvement des cosaques Yaik en 1769-1772, etc.). Un certain nombre d'historiens soulignent un changement dans la nature des protestations sociales, leur acquisition d'un caractère de classe, anti-noble. Ainsi, D. Blum note que les participants au soulèvement de Pougatchev ont tué environ 1600 nobles, dont près de la moitié étaient des femmes et des enfants, cite d'autres cas de meurtre de nobles lors des soulèvements paysans de cette époque. Comme l'écrit V. O. Klyuchevsky, les soulèvements paysans pendant le règne du règne de Catherine « prirent une couleur sociale, ce n'étaient pas des soulèvements des gouvernés contre l'administration, mais des classes inférieures contre les plus hautes, au pouvoir, contre la noblesse ».
Franc-maçonnerie
1762-1778 - caractérisé par la conception organisationnelle de la franc-maçonnerie et de la domination russes système anglais(Franc-maçonnerie Elagine).
Dans les années 60 et surtout dans les années 70. XVIIIe siècle La franc-maçonnerie gagne en popularité dans les cercles de la noblesse instruite. Le nombre de loges maçonniques est multiplié par plusieurs. Au total, environ 80 loges maçonniques sont connues pour avoir été établies sous le règne de Catherine II, alors qu'auparavant elles n'étaient que quelques-unes. Les chercheurs de la franc-maçonnerie associent cela, d'une part, à la mode de tout ce qui est nouveau et étranger (l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie russe IP Elagin l'a appelé "un jouet pour les esprits oisifs"), et d'autre part, aux nouvelles tendances des intérêts de la noblesse.
La politique de Catherine envers la franc-maçonnerie était assez controversée. D'une part, elle n'avait rien à reprocher aux francs-maçons, si ce n'est les étranges rituels qu'elle ridiculisait dans ses comédies. Mais il n'y avait aucune interdiction sur les activités des francs-maçons pendant son règne, à l'exception de cas isolés. D'autre part, comme l'écrit l'historien V. I. Kurbatov, « Catherine était très méfiante à l'égard de la franc-maçonnerie », dans laquelle elle « voyait une menace pour son règne ». Ces soupçons portaient sur deux points. D'abord, elle craignait une augmentation excessive de l'influence étrangère à travers les loges maçonniques. Ainsi, lorsqu'en 1784 les loges Elagin, pour des raisons inconnues, mais de leur plein gré, suspendirent leurs travaux, ne reprenant leurs sessions que 2 ans plus tard, Catherine relations, a un grand respect pour eux."
Deuxièmement, les soupçons de l'impératrice concernaient les activités éditoriales et journalistiques des loges maçonniques de Moscou des martinistes et des rosicruciens, dirigées par N.I. Novikov, I.G. Schwartz et d'autres, dans les livres et articles desquels elle a vu des allusions adressées à son propre règne. En 1786, toutes ces loges furent fermées, ce qui était le seul cas de ce genre sous Catherine, et certains membres de ces loges, principalement Novikov lui-même, ainsi que MI Nevzorov et V. Ya. Kolokolnikov, furent réprimés. De plus, en 1786, 6 livres publiés par les rosicruciens de Moscou ont été interdits. Ces faits indiquent le désir de Catherine II de contrôler la franc-maçonnerie et de n'autoriser que de telles activités qui ne contredisent pas ses intérêts.
Développement de la littérature. L'affaire Novikov et l'affaire Radichtchev
La littérature nationale à l'époque de Catherine, ainsi qu'au XVIIIe siècle dans son ensemble, selon un certain nombre d'historiens, en était à ses balbutiements, étant, selon K. Valishevsky, principalement « traitant des éléments étrangers ». La même opinion est exprimée par A. Truaya, qui écrit que Sumarokov, Kheraskov, Bogdanovich et d'autres écrivains russes de cette époque avaient de nombreux emprunts directs aux écrivains français. Comme indiqué au XIXe siècle. Pour l'historien français A. Leroy-Beaulieu, la tendance de la Russie au XVIIIe siècle à imiter tout ce qui est étranger pendant tout un siècle a freiné la naissance d'une littérature nationale originale.
La littérature « officielle » de l'époque de Catherine est représentée par plusieurs noms célèbres: Fonvizin, Sumarokov, Derzhavin - et un très petit nombre et volume d'œuvres écrites par eux, et ne peut être comparé à la littérature russe de la première moitié du 19ème siècle. Certes, il y avait aussi de la littérature « non officielle » : Radichtchev, Novikov, Krechetov, qui a été interdite, et les auteurs ont été sévèrement réprimés. Un certain nombre d'autres auteurs moins connus, par exemple Knyajnin, dont le drame historique ("Vadim Novgorodsky") a également été interdit et dont le tirage complet a été brûlé, ont subi le même sort. Selon les historiens, la politique de l'impératrice, qui consistait d'une part en une sorte de « leadership » personnel de la créativité littéraire, et d'autre part en une censure sévère et une répression contre les écrivains indésirables, n'a pas contribué au développement de la langue russe. Littérature.
Cela s'appliquait à la fois aux œuvres individuelles et aux magazines littéraires. Pendant son règne, plusieurs magazines sont apparus, mais aucun d'entre eux, à l'exception du magazine "Tout et n'importe quoi", publié par Catherine elle-même, n'a pu durer longtemps. La raison en était, comme l'écrivait G. V. Plekhanov, et avec laquelle l'historien N. I. Pavlenko est d'accord, que les éditeurs des magazines « se considéraient en droit de critiquer, tandis que Felitsa [Catherine II] les considérait obligés d'admirer ».
Ainsi, le journal de Novikov "Truten" a été fermé par les autorités en 1770, comme le pensent les historiens, en raison du fait qu'il soulevait des sujets sociaux aigus - la tyrannie des propriétaires terriens contre les paysans, la corruption généralisée parmi les fonctionnaires, etc. Après cela, Novikov a réussi à lancer la sortie du nouveau journal "Painting", dans lequel il a déjà essayé d'éviter les sujets sociaux aigus. Cependant, ce magazine a également été fermé après quelques années. Le Bulletin de Saint-Pétersbourg, qui n'a existé qu'un peu plus de deux ans, et d'autres magazines ont subi le même sort.
La même politique a été poursuivie en ce qui concerne les livres publiés - et pas seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger, concernant la Russie et la politique impériale. Ainsi, un livre sur son voyage en Russie, publié en 1768 par l'astronome français Chappe d'Auteroche, dans lequel il écrivait sur la corruption et la traite des êtres humains qui régnaient parmi les fonctionnaires, et également publié en 1782, a été vivement critiqué par Catherine. France "Histoire de la Russie" Levek (L'Evesque), dans laquelle, à son avis, il y avait trop peu d'éloges pour l'impératrice.
Ainsi, selon nombre d'historiens, non seulement les œuvres « nuisibles » étaient ostracisées, mais aussi « pas assez utiles », consacrées non pas à la glorification de la Russie et de son impératrice, mais à quelque autre, « étrangère » et donc « inutile » des choses. En particulier, on pense que non seulement le contenu des livres et des articles individuels, mais aussi l'activité d'édition de Novikov elle-même, qui a été menée à grande échelle (sur 2685 livres publiés en 1781-1790 en Russie, 748 livres, c'est-à-dire 28%, ont été publiés Novikov), irrité l'impératrice.
Ainsi, en 1785, Catherine II chargea l'archevêque Platon de découvrir s'il y avait quelque chose de « nuisible » dans les livres publiés par Novikov. Il étudia les livres qu'il publia, le plus souvent à des fins d'instruction publique, et finalement il n'y trouva « rien de répréhensible du point de vue de la foi et des intérêts de l'État ». Néanmoins, un an plus tard, les loges maçonniques de Novikov ont été fermées, un certain nombre de ses livres ont été interdits et quelques années plus tard, il a lui-même été réprimé. Comme l'écrit N.I. Pavlenko : « Il n'a pas été possible de formuler de manière convaincante le corpus delicti, et Novikov a été emprisonné dans la forteresse de Shlisselburg pendant 15 ans sans procès, par un décret personnel de Catherine II du 1er mai 1792. Le décret le déclarait criminel d'État, un charlatan qui profitait de tromper les crédules. »
Le sort de Radichtchev est très similaire. Comme le soulignent les historiens, dans son livre "Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou", il n'y a aucun appel au renversement du système existant et à l'élimination du servage. Néanmoins, l'auteur a été condamné à mort par cantonnement (après une grâce, remplacée par un exil de 10 ans à Tobolsk) - pour le fait que son livre "est rempli de spéculations nuisibles qui détruisent la paix publique, dépréciant le respect dû aux autorités ...".
Comme le pensent les historiens, tant dans l'affaire Novikov que dans l'affaire Radichtchev, un certain rôle a été joué par l'orgueil blessé de Catherine, habituée à la flatterie et ne tolérant pas les gens qui osaient exprimer leurs jugements critiques contraires aux siens. .
Police étrangère
La politique étrangère de l'État russe sous Catherine visait à renforcer le rôle de la Russie dans le monde et à étendre son territoire. La devise de sa diplomatie était la suivante : « il faut être en amitié avec tous les pouvoirs afin de toujours conserver la possibilité de prendre le parti du plus faible... pour garder les mains libres... pour ne pas traîner la queue. ." Cependant, cette devise a été souvent négligée, préférant joindre les faibles aux forts malgré leur opinion et leur désir.
Elargir les frontières de l'empire russe
La nouvelle croissance territoriale de la Russie commence avec l'avènement de Catherine II.Après la première guerre turque, la Russie acquiert en 1774 des points importants aux embouchures du Dniepr, du Don et dans le détroit de Kertch (Kinburn, Azov, Kerch, Yenikale). Puis, en 1783, Balta, la Crimée et la région du Kouban se rejoignent. La seconde guerre turque se termine par l'acquisition de la bande côtière entre le Bug et le Dniestr (1791). Grâce à toutes ces acquisitions, la Russie s'impose comme un pied ferme sur la mer Noire, tandis que les divisions polonaises cèdent la Russie occidentale à la Russie. Selon le premier d'entre eux, en 1773, la Russie reçoit une partie de la Biélorussie (les provinces de Vitebsk et de Moguilev) ; selon le deuxième partage de la Pologne (1793), la Russie a reçu les régions suivantes : Minsk, Volyn et Podolsk ; dans le troisième (1795-1797) - les provinces lituaniennes (Vilenskaya, Kovno et Grodno), la Russie noire, le cours supérieur de Pripyat et la partie occidentale de Volyn. Simultanément à la troisième partition, le duché de Courlande est annexé à la Russie.
Divisions du Commonwealth
L'État fédéral polono-lituanien Rzeczpospolita comprenait le Royaume de Pologne et le Grand-Duché de Lituanie.
La raison de l'ingérence dans les affaires de la Communauté polono-lituanienne était la question de la position des dissidents (c'est-à-dire la minorité non catholique - orthodoxes et protestants), de sorte qu'ils étaient égaux aux droits des catholiques. Catherine a exercé une forte pression sur la gentry afin d'élire son protégé Stanislav August Poniatowski au trône polonais, qui a été élu. Une partie de la noblesse polonaise s'est opposée à ces décisions et a organisé un soulèvement au sein de la Confédération des barreaux. Il a été supprimé par les troupes russes en alliance avec le roi polonais. En 1772, la Prusse et l'Autriche, craignant le renforcement de l'influence russe en Pologne et ses succès dans la guerre avec l'Empire ottoman (Turquie), ont proposé à Catherine de partager le Commonwealth polono-lituanien en échange de la fin de la guerre, menaçant autrement une guerre contre Russie. La Russie, l'Autriche et la Prusse ont fait venir leurs troupes.

En 1772 eut lieu la première partition du Commonwealth polono-lituanien. L'Autriche a reçu toute la Galicie avec ses districts, la Prusse - la Prusse occidentale (Pomorie), la Russie - la partie orientale de la Biélorussie à Minsk (provinces de Vitebsk et Mogilev) et une partie des terres lettones qui faisaient auparavant partie de la Livonie. Le Sejm polonais a été contraint d'accepter la partition et d'abandonner les revendications pour les territoires perdus : la Pologne a perdu 380 000 km² avec une population de 4 millions d'habitants.
Les nobles et les industriels polonais contribuèrent à l'adoption de la Constitution de 1791 ; la partie conservatrice de la population de la Confédération de Targovitsa s'est tournée vers la Russie pour obtenir de l'aide.
En 1793 eut lieu la deuxième partition de la Rzecz Pospolita, approuvée au Grodno Sejm. La Prusse a reçu Gdansk, Torun, Poznan (une partie du territoire le long des rivières Warta et Vistula), la Russie - la Biélorussie centrale avec Minsk et Novorossia (une partie du territoire de l'Ukraine moderne).
En mars 1794, un soulèvement a commencé sous la direction de Tadeusz Kosciuszko, dont les objectifs étaient de restaurer l'intégrité territoriale, la souveraineté et la Constitution le 3 mai, mais au printemps de la même année, il a été réprimé par l'armée russe sous le commandement d'AV Souvorov. Lors du soulèvement de Kosciuszko, les Polonais insurgés, qui se sont emparés de l'ambassade de Russie à Varsovie, ont découvert des documents qui ont eu un grand écho public, selon lesquels le roi Stanislav Ponyatovsky et un certain nombre de membres du Grodno Seim ont reçu de l'argent du gouvernement russe de l'époque. de l'approbation de la 2e section du Commonwealth polono-lituanien, notamment, Poniatowski a reçu plusieurs milliers de ducats.
En 1795, la troisième partition du Commonwealth polono-lituanien a eu lieu. L'Autriche a reçu la Pologne du Sud avec Luban et Cracovie, la Prusse - Pologne centrale avec Varsovie, la Russie - Lituanie, Courlande, Volhynie et Biélorussie occidentale.
13 (24) octobre 1795 - une conférence des trois puissances sur la chute de l'État polonais, elle a perdu son statut d'État et sa souveraineté.
Guerres russo-turques. L'annexion de la Crimée à la Russie

Un domaine important de la politique étrangère de Catherine II était également le territoire de la Crimée, la région de la mer Noire et Caucase du Nord sous la domination turque.
Lorsque le soulèvement de la Confédération du Barreau éclate, le sultan turc déclare la guerre à la Russie (guerre russo-turque de 1768-1774), prétextant qu'un des détachements russes, à la poursuite des Polonais, est entré sur le territoire de l'Empire ottoman. . Les troupes russes ont vaincu les confédérés et ont commencé à remporter des victoires les unes après les autres dans le sud. Après avoir remporté le succès dans un certain nombre de batailles terrestres et navales (la bataille de Kozludzhi, la bataille du tombeau grêlé, la bataille de Kagul, la bataille de Larga, la bataille de Chesme, etc.), la Russie a forcé la Turquie à signer le Kuchuk - Traité de Kainardzhi, à la suite duquel le Khanat de Crimée a officiellement obtenu son indépendance, mais est devenu de facto dépendant de la Russie. La Turquie a payé à la Russie des indemnités militaires de l'ordre de 4,5 millions de roubles et a également cédé la côte nord de la mer Noire ainsi que deux ports importants.
Après la fin de la guerre russo-turque de 1768-1774, la politique de la Russie envers le khanat de Crimée visait à y établir un dirigeant pro-russe et à rejoindre la Russie. Sous la pression de la diplomatie russe, Shahin Girey a été élu khan. Le précédent khan, un protégé de la Turquie, Devlet IV Girey, au début de 1777, tenta de résister, mais il fut réprimé par A. V. Suvorov, Devlet IV s'enfuit en Turquie. Dans le même temps, le débarquement turc en Crimée a été empêché, et ainsi une tentative de déclencher une nouvelle guerre a été empêchée, après quoi la Turquie a reconnu Shahin Giray comme un khan. En 1782, un soulèvement éclata contre lui, qui fut réprimé par les troupes russes introduites dans la péninsule, et en 1783 par le manifeste de Catherine II le khanat de Crimée fut annexé à la Russie.
Après la victoire, l'impératrice, avec l'empereur autrichien Joseph II, a fait un voyage triomphal à travers la Crimée.
La guerre suivante avec la Turquie a eu lieu en 1787-1792 et a été une tentative infructueuse de l'Empire ottoman pour récupérer les terres qui avaient été cédées à la Russie lors de la guerre russo-turque de 1768-1774, y compris la Crimée. Ici, les Russes ont également remporté un certain nombre de victoires importantes, à la fois par voie terrestre - la bataille de Kinburn, la bataille de Rymnik, la capture d'Ochakov, la capture d'Izmail, la bataille de Fokshany, les campagnes des Turcs contre Bendery et Akkerman ont été repoussées, et d'autres, et la mer - la bataille de Fidonisi (1788), la bataille de Kertch (1790), la bataille du cap Tendra (1790) et la bataille de Kaliakria (1791). En conséquence, l'Empire ottoman en 1791 a été contraint de signer le traité de paix de Yassy, sécurisant la Crimée et Ochakov à la Russie, ainsi que de repousser la frontière entre les deux empires jusqu'au Dniestr.
Les guerres avec la Turquie ont été marquées par les grandes victoires militaires de Roumiantsev, Orlov-Chesmensky, Souvorov, Potemkine, Ouchakov et l'établissement de la Russie dans la mer Noire. En conséquence, ils ont cédé à la Russie la région nord de la mer Noire, la Crimée, la région du Kouban, renforcé ses positions politiques dans le Caucase et les Balkans, renforcé le prestige de la Russie sur la scène mondiale.
Selon de nombreux historiens, ces conquêtes sont la principale réalisation du règne de Catherine II. Dans le même temps, nombre d'historiens (K. Valishevsky, VO Klyuchevsky, etc.) et contemporains (Frédéric II, ministres français, etc.) expliquaient les victoires "étonnantes" de la Russie sur la Turquie non pas tant par la force du Armée russe et encore assez faible et mal organisée, du fait de l'extrême décomposition durant cette période de l'armée et de l'Etat turcs.
Relations avec la Géorgie et la Perse
Sous le roi de Kartli et de Kakhétie, Irakli II (1762-1798), l'État uni Kartli-Kakhétie fut considérablement renforcé et son influence en Transcaucasie grandit. Les Turcs sont chassés du pays. La culture géorgienne renaît, l'impression de livres fait son apparition. Les Lumières sont en train de devenir l'une des directions principales de la pensée sociale. Irakli s'est tourné vers la Russie pour se protéger de la Perse et de la Turquie. Catherine II, qui a combattu avec la Turquie, d'une part, était intéressée par un allié, d'autre part, elle ne voulait pas envoyer de forces militaires importantes en Géorgie. En 1769-1772, un détachement russe insignifiant sous le commandement du général Totleben combat contre la Turquie aux côtés de la Géorgie. En 1783, la Russie et la Géorgie ont signé le traité de Georgievsk établissant un protectorat russe sur le royaume de Kartli-Kakheti en échange de la protection militaire de la Russie. En 1795, le Shah Aga Mohammed Khan Qajar a envahi la Géorgie et après la bataille de Krtsanisi, il a ravagé Tbilissi. La Russie, remplissant les termes du traité, a commencé les hostilités contre elle, et en avril 1796, les troupes russes ont pris d'assaut Derbent et ont réprimé la résistance des Perses sur le territoire de l'Azerbaïdjan moderne, y compris grandes villes(Bakou, Shemakha, Gandja).
Relations avec la Suède
Profitant du fait que la Russie est entrée en guerre avec la Turquie, la Suède, soutenue par la Prusse, l'Angleterre et la Hollande, a déclenché une guerre avec elle pour le retour de territoires précédemment perdus. Les troupes qui sont entrées sur le territoire de la Russie ont été arrêtées par le général en chef V.P. Musin-Pushkin. Après une série de batailles navales qui n'ont pas eu de résultat décisif, la Russie a vaincu la flotte de ligne suédoise lors de la bataille de Vyborg, mais en raison de la tempête qui s'annonçait, elle a subi une lourde défaite lors de la bataille des flottes d'aviron à Rochensalm. Les parties ont signé le traité de paix de Verela en 1790, selon lequel la frontière entre les pays n'a pas changé.
Relations avec les autres pays
En 1764, les relations entre la Russie et la Prusse ont été normalisées et un accord d'alliance a été conclu entre les pays. Ce traité a servi de base à la formation du système du Nord - l'alliance de la Russie, de la Prusse, de l'Angleterre, de la Suède, du Danemark et du Commonwealth contre la France et l'Autriche. La coopération russo-prussienne-britannique s'est poursuivie. En octobre 1782, le traité d'amitié et de commerce avec le Danemark est signé.
Dans le troisième quart du XVIIIe siècle. il y avait une lutte des colonies nord-américaines pour l'indépendance de l'Angleterre - la révolution bourgeoise a conduit à la création des États-Unis. En 1780, le gouvernement russe adopte la « Déclaration de neutralité armée », soutenue par la plupart des pays européens (les navires des pays neutres ont le droit de se défendre armée lorsque la flotte d'un pays belligérant les attaque).
Dans les affaires européennes, le rôle de la Russie s'est accru pendant la guerre austro-prussienne de 1778-1779, lorsqu'elle a servi de médiateur entre les belligérants au congrès de Teshen, où Catherine a essentiellement dicté ses termes de réconciliation, ce qui a rétabli l'équilibre en Europe. Après cela, la Russie a souvent agi comme arbitre dans les différends entre les États allemands, qui ont fait appel directement à Catherine pour une médiation.
L'un des plans grandioses de Catherine dans l'arène de la politique étrangère était le soi-disant projet grec - des plans conjoints de la Russie et de l'Autriche pour diviser les terres turques, expulser les Turcs d'Europe, faire revivre l'empire byzantin et proclamer le petit-fils de Catherine, le grand-duc Konstantin Pavlovich, comme empereur. Selon les plans, sur le site de la Bessarabie, de la Moldavie et de la Valachie, l'État tampon de Dacie est créé et la partie occidentale de la péninsule balkanique est transférée à l'Autriche. Le projet a été développé au début des années 1780, mais n'a pas été mis en œuvre en raison des contradictions des alliés et de la conquête d'importants territoires turcs par la Russie seule.
Après la Révolution française, Catherine est l'une des initiatrices de la coalition anti-française et de l'instauration du principe de légitimisme. Elle a déclaré : « L'affaiblissement du pouvoir monarchique en France met en danger toutes les autres monarchies. Pour ma part, je suis prêt à résister de toutes mes forces. Il est temps d'agir et de prendre les armes." Cependant, en réalité, elle s'est retirée de la participation aux hostilités contre la France. Selon la croyance populaire, l'une des vraies raisons de la création de la coalition anti-française était de détourner l'attention de la Prusse et de l'Autriche des affaires polonaises. Dans le même temps, Catherine refusa tous les accords conclus avec la France, ordonna d'expulser de Russie tous les sympathisants présumés de la Révolution française et, en 1790, promulgua un décret sur le retour de tous les Russes de France.
Peu de temps avant sa mort, en 1796, Catherine commença la campagne de Perse : il était prévu que le commandant en chef Valerian Zoubov (qui avait été promu commandant militaire grâce au patronage de son frère Platon Zoubov, le favori de l'impératrice) avec 20 mille soldats s'emparerait de tout ou d'une partie importante du territoire de la Perse. D'autres plans grandioses de conquête, qui auraient été élaborés par Platon Zoubov lui-même, comprenaient une campagne contre Constantinople : de l'ouest à l'Asie Mineure (Zubov) et simultanément du nord des Balkans (Suvorov) - pour la mise en œuvre de la Projet grec chéri par Catherine. Ces plans n'étaient pas destinés à se réaliser en raison de sa mort, bien que Zubov ait réussi à remporter plusieurs victoires et à capturer une partie du territoire perse, dont Derbent et Bakou.
Résultats et évaluations de la politique étrangère
Sous le règne de Catherine, l'Empire russe acquit le statut de grande puissance. À la suite des deux guerres russo-turques réussies de 1768-1774 et 1787-1791 pour la Russie. la péninsule de Crimée et l'ensemble du territoire de la région nord de la mer Noire ont été annexés à la Russie. En 1772-1795. La Russie a participé à trois sections du Commonwealth polono-lituanien, à la suite de quoi elle a annexé les territoires de l'actuelle Biélorussie et de l'Ukraine occidentale, de la Lituanie et de la Courlande. Sous le règne de Catherine, la colonisation russe des îles Aléoutiennes et de l'Alaska a commencé.
Dans le même temps, de nombreux historiens considèrent certains éléments de la politique étrangère de Catherine II (la liquidation du Commonwealth en tant qu'État indépendant, la volonté de s'emparer de Constantinople) comme ayant des résultats plutôt négatifs que positifs. Ainsi, N. I. Pavlenko appelle la liquidation de la Pologne en tant qu'État souverain "un vol par les voisins". Comme l'écrit K. Erickson, « Les historiens actuels de l'empiètement de Catherine sur l'indépendance de la Pologne sont perçus comme une barbarie qui va à l'encontre des idéaux d'humanisme et d'illumination qu'elle prêchait. Comme l'ont noté K. Valishevsky et V. O. Klyuchevsky, lors des divisions du Commonwealth, 8 millions de Slaves se sont retrouvés sous le « joug » de la Prusse et de l'Autriche ; de plus, ces sections renforcèrent grandement cette dernière, bien plus que la Russie. En conséquence, la Russie de ses propres mains a créé de redoutables adversaires potentiels sur sa frontière occidentale représentée par les États allemands renforcés, avec lesquels elle devra se battre à l'avenir.
Les successeurs de Catherine critiquent les principes de sa politique étrangère. Son fils Paul Ier les traita négativement et s'empressa de les réviser complètement immédiatement après l'accession au trône. Sous le règne de son petit-fils Nicolas Ier, le baron Brunnov rédigea un rapport qui disait : la règle invariable de notre politique...". « Et notre vraie force », attribua de sa propre main l'empereur Nicolas Ier.
Catherine II comme figure du siècle des Lumières
 Catherine II - Législatrice dans le Temple de la Justice(Levitsky D.G., 1783, Musée russe, Saint-Pétersbourg)
Catherine II - Législatrice dans le Temple de la Justice(Levitsky D.G., 1783, Musée russe, Saint-Pétersbourg)
Le long règne de Catherine II, 1762-1796, a été rempli d'événements et de processus significatifs et très contradictoires. L'âge d'or de la noblesse russe était à la fois le siècle du Pougachevisme, l'« Ordre » et la Commission législative coexistaient avec les persécutions. Néanmoins, Catherine a essayé de prêcher parmi la noblesse russe la philosophie des Lumières européennes, que l'Impératrice connaissait bien. En ce sens, son règne est souvent appelé l'ère de l'absolutisme éclairé. Les historiens discutent de ce qu'était l'absolutisme éclairé - l'enseignement utopique des éclaireurs (Voltaire, Diderot, etc.) sur l'union idéale des rois et des philosophes ou un phénomène politique qui a trouvé sa véritable incarnation en Prusse (Frédéric II le Grand), en Autriche ( Joseph II), la Russie (Catherine II) et d'autres.Ces différends ne sont pas sans fondement. Ils reflètent la contradiction clé entre la théorie et la pratique de l'absolutisme éclairé : entre la nécessité de changer radicalement l'ordre des choses existant (système de classe, despotisme, anarchie, etc.) et l'inadmissibilité des bouleversements, le besoin de stabilité, l'incapacité de empiéter sur la force sociale sur laquelle cet ordre est détenu - la noblesse ... Catherine II, comme peut-être personne d'autre, a compris l'insurmontabilité tragique de cette contradiction : « Vous », a-t-elle reproché au philosophe français D. Diderot, sensible et douloureux. Sa position sur la question de la paysannerie serf est hautement indicative. Aucun doute sur attitude négative impératrice au servage. Elle a réfléchi plus d'une fois aux moyens de l'annuler. Mais l'affaire n'allait pas au-delà de réflexions prudentes. Catherine II comprit clairement que l'élimination du servage serait accueillie avec indignation par les nobles. La législation sur le servage a été élargie : les propriétaires terriens ont été autorisés à exiler les paysans aux travaux forcés pour une durée indéterminée, et les paysans ont été interdits de porter plainte contre les propriétaires terriens.
- convocation et activité de la Commission législative (1767-1768);
- réforme de la division administrative-territoriale de l'Empire russe;
- acceptation de la Charte de la Charte aux villes, qui formalisait les droits et privilèges du « tiers état » - les citadins. Le domaine urbain a été divisé en six catégories, a reçu des droits limités d'autonomie, a élu le maire et les membres de la Douma de la ville ;
- l'adoption en 1775 d'un manifeste sur la liberté d'entreprendre, selon lequel l'autorisation des organismes gouvernementaux n'était pas requise pour ouvrir une entreprise ;
- réformes de 1782-1786 dans le domaine de l'enseignement scolaire.
Bien sûr, ces transformations étaient limitées. Le principe autocratique du gouvernement, du servage et du système successoral restait inébranlable. La guerre paysanne de Pougatchev (1773-1775), la prise de la Bastille (1789) et l'exécution du roi Louis XVI (1793) n'ont pas contribué à l'approfondissement des réformes. Ils marchaient par intermittence, dans les années 90. et s'arrêta complètement. La persécution d'A.N. Radishchev (1790), l'arrestation de N.I. Novikov (1792) n'étaient pas des épisodes accidentels. Ils témoignent des contradictions profondes de l'absolutisme éclairé, de l'impossibilité d'évaluer sans ambiguïté « l'âge d'or de Catherine II ».
Ce sont peut-être ces contradictions qui ont donné lieu à l'opinion qui prévalait chez certains historiens sur le cynisme et l'hypocrisie extrêmes de Catherine II ; bien qu'elle ait elle-même contribué à l'émergence de cette opinion par ses paroles et ses actes. Tout d'abord, à la suite de ses actions, la majeure partie de la population de la Russie est devenue encore plus impuissante, privée des droits de l'homme normaux, alors qu'elle était en son pouvoir d'obtenir le contraire - et pour cela il n'était pas nécessaire d'abolir le servage . Ses autres actions, telles que l'élimination de la Pologne souveraine, ne correspondaient guère non plus aux idées des Lumières, auxquelles elle adhère en paroles. De plus, les historiens donnent des exemples de ses paroles et actions spécifiques qui soutiennent cette opinion :
- Comme le soulignent V.O. Klyuchevsky et D. Blum, en 1771, Catherine trouva « indécent » que les paysans soient vendus aux enchères publiques « sous le marteau », et elle promulgua une loi interdisant les enchères publiques. Mais comme cette loi était ignorée, Catherine n'en demanda pas l'application et, en 1792, elle autorisa à nouveau la vente de serfs aux enchères, interdisant l'utilisation du marteau du commissaire-priseur, qui, apparemment, lui paraissait particulièrement "indécent".
- Un autre exemple cité par eux concerne le décret de Catherine, interdisant aux paysans de porter plainte contre les propriétaires terriens (pour cela, ils étaient maintenant menacés de coups de fouet et de travaux forcés à perpétuité). Catherine promulgua ce décret le 22 août 1767, « en même temps que les députés des Commissions écoutaient les articles de l'« Ordre » sur la liberté et l'égalité » ;
- D. Blum donne également l'exemple suivant : les propriétaires terriens chassaient souvent dans la rue (leur laissant carte blanche) des paysans âgés ou malades qui, de ce fait, étaient voués à la mort. Catherine, par son décret, obligea les propriétaires fonciers à prendre un reçu des paysans qu'ils acceptaient.
- Comme l'indique A. Truaya, Catherine n'a de cesse dans sa correspondance d'appeler les serfs des « esclaves ». Mais dès que l'éducateur français Diderot a utilisé ce mot lors d'une rencontre avec elle, elle a été terriblement indignée. « Il n'y a pas d'esclaves en Russie », dit-elle. "Les serfs en Russie sont spirituellement indépendants, bien qu'ils soient soumis à la coercition dans leur corps."
- N.I. Pavlenko cite un certain nombre de lettres de Catherine à Voltaire. Dans l'un d'eux (1769) elle écrit : "... nos impôts sont si faciles qu'en Russie il n'y a pas d'homme qui n'ait pas de poulet quand il le veut, et depuis quelque temps ils préfèrent les dindes aux poulets." Dans une autre lettre (1770), écrite au milieu de l'Holodomor et des émeutes qui ont englouti diverses parties du pays : « En Russie, tout se passe comme d'habitude : il y a des provinces où l'on sait à peine que nous sommes en guerre depuis deux années. Nulle part rien ne manque : ils chantent des prières d'action de grâce, dansent et s'amusent. »
Un sujet particulier est la relation entre Catherine et les éducateurs français (Diderot, Voltaire). Il est bien connu qu'elle était en correspondance constante avec eux, et ils ont exprimé une haute opinion d'elle. Cependant, de nombreux historiens écrivent que ces relations étaient de la nature évidente d'un "parrainage", d'une part, et de la flatterie, d'autre part. Comme l'écrit NI Pavlenko, en apprenant que Diderot avait besoin d'argent, Catherine acheta sa bibliothèque pour 15 000 livres, mais ne la prit pas, mais la lui laissa, le « nommant » gardien à vie de sa propre bibliothèque avec un « salaire » du trésor russe pour un montant de 1000 livres par an. Voltaire a comblé une variété de faveurs et d'argent, et après sa mort a acquis sa bibliothèque, en versant des sommes généreuses aux héritiers. De leur côté, ils ne sont pas restés endettés. Diderot a prodigué éloges et flatteries dans son discours et « a mis ses notes critiques sous le tapis » (ainsi, ce n'est qu'après sa mort que ses « Notes sur le mandat » de Catherine ont été découvertes). Comme le fait remarquer K. Valishevsky, Voltaire l'appelait « Sémiramis du Nord » et soutenait que le soleil, illuminant le monde des idées, passait de l'Ouest au Nord ; Il a écrit l'histoire de Pierre Ier, « préparée » pour lui par ordre de Catherine, ce qui a ridiculisé les autres savants européens. A. Truaya note que Voltaire et Diderot rivalisaient de louanges exagérées de Catherine, citant des exemples avec elle en Russie, son âme, autrefois « l'âme d'un esclave », est devenue une « âme libre », etc.), et en étaient même jalouses. l'un à l'autre pour ses faveurs et son attention. Par conséquent, AS Pouchkine a écrit sur la « bouffonnerie dégoûtante » de l'impératrice « dans ses relations avec les philosophes de son siècle », et selon Friedrich Engels, « la cour de Catherine II est devenue la capitale du peuple alors éclairé, en particulier des Français. ; ... elle a tellement réussi à tromper l'opinion publique que Voltaire et bien d'autres ont chanté « Semiramis du Nord » et proclamé la Russie le pays le plus progressiste du monde, la patrie des principes libéraux, un champion de la tolérance religieuse »
Et néanmoins, c'est à cette époque qu'est apparue la Société économique libre (1765), que les imprimeries libres fonctionnaient, qu'il y avait une vive controverse journalistique, à laquelle l'impératrice participa personnellement, l'Ermitage (1764) et la Bibliothèque publique de Saint-Pétersbourg (1795), l'Institut Smolny ont été fondés de jeunes filles nobles (1764) et des écoles pédagogiques dans les deux capitales.
Ekaterina et les établissements d'enseignement
En mai 1764, le premier établissement d'enseignement pour filles en Russie, l'Institut Smolny pour les filles nobles, a été fondé, suivi de l'Institut de Novodievitchi pour l'éducation des filles bourgeoises. Bientôt, Catherine II attira l'attention sur le Land Gentry Corps, et sa nouvelle charte fut adoptée en 1766. Tout en élaborant le décret "Institutions pour l'administration des provinces de l'empire de toute la Russie" en 1775, Catherine II commença activement à résoudre les problèmes dans l'éducation. Le devoir d'ouvrir des écoles au niveau de la province et du district lui a été confié par les ordres de la charité publique.En 1780, Catherine a fait un voyage d'inspection dans les régions du nord-ouest de la Russie. Ce voyage a montré les succès obtenus et ce qu'il restait à faire à l'avenir. Par exemple, à Pskov, elle fut informée qu'une école pour enfants bourgeois, contrairement aux enfants nobles, n'avait jamais été ouverte. Catherine a immédiatement accordé 1000 roubles. pour un établissement scolaire de la ville, 500 roubles. - pour un séminaire théologique, 300 pour un orphelinat et 400 pour un hospice. En 1777, l'école commerciale d'État pour les marchands a été ouverte.À Saint-Pétersbourg, Catherine II, à ses propres frais en 1781, a fondé un établissement d'enseignement à la cathédrale Saint-Isaac. La même année, six autres écoles ont été organisées dans les temples. En 1781, 486 personnes y étudient.
Dans le même temps, comme l'écrit l'historien Kazimir Valishevsky, "Le début de l'éducation publique sous la forme qu'il existe actuellement en Russie a été posé par les établissements d'enseignement ouverts à Saint-Pétersbourg par Novikov, que Catherine considérait comme un ennemi et récompensé par la prison et des chaînes pour son travail pour le bien de la Russie. ".
Ekaterina - écrivain et éditeur

Catherine appartenait à un petit nombre de monarques qui communiquaient si intensément et directement avec leurs sujets en rédigeant des manifestes, des instructions, des lois, des articles polémiques et indirectement sous forme d'œuvres satiriques, de drames historiques et d'opus pédagogiques. Dans ses mémoires, elle a avoué : "Je ne peux pas voir un stylo vierge sans ressentir l'envie de le tremper immédiatement dans l'encre."
Ekaterina était engagée dans une activité littéraire, laissant derrière elle une grande collection d'œuvres - notes, traductions, fables, contes de fées, comédies "Oh, le temps!" "(1771-1772), essais, livret pour cinq opéras (" Fevey ", " Héros de Novgorod Boeslavich "," Chevalier courageux et courageux Akhrideich "," Grebogatyr Kosometovich "," Fedul avec enfants "; les premières ont eu lieu à Saint-Pétersbourg en 1786-1791). Ekaterina a été l'initiatrice, l'organisatrice et l'auteur du livret du pompeux projet national-patriotique - "l'action historique" "L'administration initiale d'Oleg", pour laquelle elle a attiré les meilleurs compositeurs, chanteurs et chorégraphes (la première a eu lieu à Saint-Pétersbourg le 22 octobre (2 novembre 1790). Toutes les représentations de Saint-Pétersbourg basées sur les œuvres de Catherine étaient extrêmement richement fournies. Les opéras "Fevey" et "Gorebogatyr", ainsi que l'oratorio "Initial Administration" ont été publiés en clavier et partition (ce qui était une rareté extraordinaire en Russie à cette époque).
Ekaterina a participé au magazine satirique hebdomadaire "Tout et n'importe quoi", publié depuis 1769. L'impératrice s'est tournée vers le journalisme dans le but d'influencer l'opinion publique. L'idée principale du magazine était donc de critiquer les vices et les faiblesses de l'homme. D'autres sujets d'ironie étaient les superstitions de la population. Catherine elle-même a appelé le magazine "Satire dans un esprit souriant".
Cependant, certains historiens pensent qu'un certain nombre de ses œuvres et même de ses lettres n'ont pas été écrites par elle-même, mais par des auteurs anonymes, soulignant des différences trop marquées de style, d'orthographe, etc. entre ses différentes œuvres. K. Valishevsky pense que certaines de ses lettres auraient pu être écrites par Andrei Shuvalov et des œuvres littéraires - par NI Novikov pendant la période de leur "réconciliation" après 1770. Ainsi, toutes ses comédies qui ont eu du succès n'ont été écrites que pendant son " Amitié "avec Novikov, à la même époque, la comédie" Woe-Bogatyr "(1789), écrite plus tard, est critiquée pour sa grossièreté et sa vulgarité, inhabituelles pour les comédies des années 70.
Elle était jalouse des évaluations négatives de son travail (le cas échéant). Ainsi, ayant appris après la mort de Diderot sa note critique à son "Instruction", dans une lettre à Grimm du 23 novembre (4 décembre 1785), elle fit des remarques grossières sur l'éclaireur français.
Développement de la culture et de l'art
Catherine se considérait comme une "philosophe sur le trône" et privilégiait le siècle des Lumières, était en correspondance avec Voltaire, Diderot, d "Alambert. Sous elle, l'Ermitage et la Bibliothèque publique sont apparus à Saint-Pétersbourg. Elle a fréquenté divers domaines de l'art - architecture, musique, peinture… Il est impossible de ne pas mentionner l'installation massive de familles allemandes dans diverses régions de la Russie moderne, de l'Ukraine et des pays baltes, initiée par Catherine, dans le but de moderniser la science et la culture russes.
Dans le même temps, de nombreux historiens soulignent le caractère unilatéral d'un tel mécénat de la part de Catherine. L'argent et les récompenses ont été généreusement dotés principalement par des scientifiques étrangers et des personnalités culturelles qui ont répandu la gloire de Catherine II à l'étranger. Le contraste est particulièrement frappant par rapport aux artistes, sculpteurs et écrivains russes. « Catherine ne les soutient pas, écrit A. Troyat, et manifeste pour eux un sentiment qui se situe entre la condescendance et le mépris. Vivant en Russie, Falcone s'indignait de la grossièreté de la tsarine envers l'excellent artiste Losenko. « Le pauvre homme, humilié, sans un morceau de pain, a voulu quitter Saint-Pétersbourg et est venu me déverser sa douleur », écrit-il. Fortia de Piles, qui a voyagé à travers la Russie, s'étonne que Sa Majesté permette au talentueux sculpteur Shubin de se blottir dans un placard exigu, sans modèles, sans élèves, sans commandes officielles. Pendant tout son règne, Catherine passe commande ou donne des subventions à très peu d'artistes russes, mais elle ne lésine pas sur l'achat d'œuvres d'auteurs étrangers. »

Comme le note N.I. Pavlenko, "le poète GR Derjavin n'a reçu que 300 âmes de paysans, deux tabatières en or et 500 roubles dans toute sa vie à la cour". (bien qu'il ne soit pas seulement un écrivain, mais aussi un fonctionnaire qui a effectué diverses missions), tandis que les écrivains étrangers, sans rien faire de spécial, ont reçu d'elle des fortunes entières. Dans le même temps, il est bien connu quel genre de "récompense" un certain nombre d'écrivains russes Radishchev, Novikov, Krechetov, Knyazhnine ont reçu d'elle, qui ont été réprimés et leurs œuvres ont été interdites et brûlées.
Comme l'écrit K. Valishevsky, Catherine s'entoure d'« artistes étrangers médiocres » (Brompton, Koenig, etc.), laissant à eux-mêmes les talentueux artistes et sculpteurs russes. Le graveur Gabriel Skorodumov, qui étudia son art en France et en fut congédié par Catherine en 1782, ne trouva pas de travail à la cour de Sa Majesté, et il fut contraint de travailler comme menuisier ou apprenti. Le sculpteur Shubin et l'artiste Losenko ne recevaient pas d'ordres de l'impératrice et de ses courtisans et étaient dans la pauvreté ; Losenko, désespéré, se livra à l'ivresse. Mais lorsqu'il mourut, et qu'il s'avéra qu'il était un grand artiste, écrit l'historien, Catherine "ajouta volontiers son apothéose à sa grandeur". « En général, l'art national, conclut Valishevsky, ne doit à Catherine que quelques modèles de l'Ermitage, qui ont servi à être étudiés et imités par les artistes russes. Mais à part ces modèles, elle ne lui a rien donné : même pas un morceau de pain. »
On connaît aussi un épisode avec Mikhaïl Lomonossov, survenu au tout début du règne de Catherine II : en 1763, Lomonossov, incapable de résister à une seule lutte dans une querelle entre normands et anti-normanistes, présente sa démission avec le grade de conseiller d'Etat (il était alors conseiller collégial) ; Catherine a d'abord accédé à sa demande, mais a ensuite annulé sa décision, ne voulant manifestement pas se quereller avec l'un des scientifiques russes les plus éminents. En 1764, Catherine II visita personnellement la maison de Lomonosov, lui faisant cet honneur, mais en janvier 1765, elle permit au jeune historien allemand Schlözer d'accéder aux archives historiques, ce à quoi s'opposa Lomonosov, qui supposa que Schlötser les emmenait à l'étranger afin de publier et enrichir (ici, peut-être, il y a aussi une insulte personnelle à Lomonossov, qui n'a pas été autorisé à visiter ces archives); mais ses reproches restèrent sans réponse, d'autant plus qu'en janvier 1765 il tomba malade d'une pneumonie et mourut en avril.
Catherine II et la propagande
De nombreux historiens soulignent que la propagande a joué un rôle exceptionnellement important dans les activités de Catherine, et certains pensent même que la propagande était le sens principal de tout son règne. Parmi les exemples évidents des actions de propagande de Catherine II indiquent :
1. Un concours pour la meilleure solution du problème paysan, annoncé en 1765 sous les auspices de la Free Economic Society. En 2 ans, 162 candidatures ont été envoyées, dont 155 de l'étranger. Le prix a été décerné à Béardé de Labeu, membre de l'Académie de Dijon, qui a présenté un essai "équilibré" qui suggérait de ne pas se précipiter pour abolir le servage ou attribuer des terres aux paysans, mais d'abord préparer les paysans à la perception de la liberté. Comme l'écrit N. I. Pavlenko, malgré la large résonance que le concours a eue en Russie et à l'étranger, « les compositions du concours étaient tenues secrètes, leur contenu était la propriété des personnes qui étaient membres de la commission du concours ».
2. "Ordre" de Catherine (1766) et les travaux de la Commission législative (1767-1768), dont les débats durèrent un an et demi avec la participation de plus de 600 députés et se terminèrent par la dissolution de la commission. Sous le règne de Catherine, "l'Ordre" a été publié 7 fois seulement en Russie, et "est devenu largement connu non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger, car il a été traduit dans les principales langues européennes".

3. Un voyage de Catherine et de sa suite en 1787 avec un grand groupe d'étrangers (environ 3000 personnes au total) de Saint-Pétersbourg au sud de la Russie pour glorifier les victoires de la Russie sur l'Empire ottoman et le succès dans le développement des terres conquises . Le trésor a coûté de 7 à 10 millions de roubles. Pour organiser le voyage : dans certaines villes, le long du parcours, des bâtiments ont été spécialement construits dans lesquels le cortège s'est arrêté ; effectué en urgence (selon le témoignage du comte de Langeron) des réparations et peinture des façades des bâtiments le long du mouvement du cortège, et la population était obligée de porter les plus beaux vêtements le jour de son passage ; tous les mendiants ont été enlevés de Moscou (selon le témoignage de M. M. Shcherbatov); une reconstitution de la bataille de Poltava a été organisée, à laquelle 50 000 personnes ont participé; certaines villes (Bakhchisaraï) étaient illuminées de nombreuses lumières, de sorte qu'elles brillaient comme la lumière du jour la nuit. A Kherson, les invités ont été accueillis par l'inscription : "Le chemin de Constantinople". Comme le note N. I. Pavlenko, à cette époque, il y avait une sécheresse en Russie et la famine était imminente, qui a ensuite balayé tout le pays; et la Turquie a considéré tout l'événement comme une provocation et a immédiatement commencé avec la Russie une nouvelle guerre... En Europe, après ce voyage, un mythe est apparu sur les "villages Potemkine", construits par Potemkine spécifiquement pour "jeter de la poussière dans les yeux" de l'impératrice.
4. Parmi les réalisations du règne de Catherine figurent 3161 usines et usines construites en 1796, alors qu'avant le règne de Catherine II, le nombre d'usines et d'usines sur le territoire de l'Empire russe n'était que de quelques centaines. Cependant, comme l'a établi l'académicien S. G. Strumilin, ce chiffre surestimait considérablement le nombre réel d'usines et d'usines, puisque même les « usines » kumis et les « usines » bergeries y étaient incluses, « juste pour accroître la glorification de cette reine ».
5. Les lettres de Catherine aux étrangers (Grimm, Voltaire, etc.), comme le croient les historiens, faisaient également partie de sa propagande. Ainsi, K. Waliszewski compare ses lettres aux étrangers avec le travail d'une agence de presse moderne, et écrit plus loin : « ses lettres à ses correspondants préférés, comme Voltaire et Grimm en France et Zimmermann et en partie Mme Belke en Allemagne, ne peuvent pas être appelées autrement que des articles purement journalistiques. Avant même d'être publiées, ses lettres à Voltaire sont devenues la propriété de tous ceux qui ont suivi le moindre acte et la moindre parole du patriarche de Ferney, et littéralement tout le monde instruit les a suivies. Grimm, bien qu'il ne lui montrait pas d'habitude les lettres, mais en racontait le contenu partout où il était, et il était dans toutes les maisons de Paris. On peut en dire autant du reste de la correspondance de Catherine : elle était son journal, et les lettres individuelles étaient des articles. »
6. Ainsi, dans une de ses lettres à Grimm, elle l'a assuré très sérieusement qu'il n'y a pas de gens maigres en Russie, seulement bien nourris. Dans une lettre à Belke à la fin de 1774, elle écrit : « Autrefois, en traversant le village, on voyait des petits enfants en chemise, courir pieds nus dans la neige ; maintenant, il n'y a personne qui n'ait une robe extérieure, un manteau en peau de mouton et des bottes. Les maisons sont encore en bois, mais elles se sont agrandies et la plupart ont déjà deux étages. » Dans une lettre à Grimm en 1781, elle lui présente le "résultat" de son règne, où, avec le nombre de provinces et de villes qu'elle établit et de victoires remportées, elle indique, entre autres, qu'elle a émis 123 "décrets pour alléger le sort des gens. »
7. Dans une lettre à Belke le 18 (29) mai 1771, après le début d'une épidémie à Moscou et l'instauration de la quarantaine officielle, elle écrit : « A celui qui vous dit qu'il y a une peste à Moscou, dites-lui qu'il menti..."...
Vie privée

Contrairement à son prédécesseur, Catherine n'a pas mené de vastes constructions de palais pour ses propres besoins. Pour se déplacer confortablement à travers le pays, elle a équipé un réseau de petits palais itinérants le long de la route de Saint-Pétersbourg à Moscou (de Chesmensky à Petrovsky) et ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'elle a commencé à construire une nouvelle résidence de campagne à Pella (non conservée). ). De plus, elle s'inquiétait du manque de résidence spacieuse et moderne à Moscou et ses environs. Bien qu'elle ne se rende pas souvent dans l'ancienne capitale, Catherine a nourri au fil des ans des projets de restructuration du Kremlin de Moscou, ainsi que la construction de palais de banlieue à Lefortovo, Kolomenskoïe et Tsaritsyne. Pour diverses raisons, aucun de ces projets n'a été achevé.
Ekaterina était une brune de taille moyenne. Elle était connue pour ses relations avec de nombreux amants, dont le nombre (selon la liste de l'érudit Catherine Piotr Bartenev) atteint 23. Les plus célèbres d'entre eux étaient Sergei Saltykov, Grigory Orlov, le lieutenant de garde à cheval Vasilchikov, Grigory Potemkin, le hussard Semyon Zorich, Alexandre Lanskoï ; le dernier favori était le cornet Platon Zubov, devenu général. Avec Potemkine, selon certaines sources, Catherine s'est mariée en secret (1775, voir Mariage de Catherine II et Potemkine). Après 1762, elle envisage d'épouser Orlov, cependant, sur les conseils de ses proches, elle abandonne cette idée.
Les amours de Catherine ont été marquées par une série de scandales. Ainsi, Grigory Orlov, étant son préféré, cohabitait en même temps (selon le témoignage de Mikhail Shcherbatov) avec toutes ses demoiselles d'honneur et même avec son cousin de 13 ans. Le favori de l'impératrice Lanskoy utilisait un aphrodisiaque pour augmenter la "force masculine" (contarid) à des doses toujours croissantes, ce qui, apparemment, selon la conclusion du médecin de la cour Weikart, était la raison de sa mort inattendue à un jeune âge. Son dernier favori, Platon Zubov, avait un peu plus de 20 ans, alors que l'âge de Catherine à cette époque dépassait déjà les 60 ans.
La perplexité des contemporains, y compris des diplomates étrangers, l'empereur autrichien Joseph II, etc., a été suscitée par les critiques élogieuses et les caractéristiques que Catherine a données à ses jeunes favoris, pour la plupart dépourvus de tout talent exceptionnel. Comme l'écrit N.I. Pavlenko, « ni avant Catherine, ni après elle, la débauche n'a pas atteint une si large échelle et ne s'est pas manifestée sous une forme aussi ouvertement provocante »
 Catherine II pour une promenade dans le parc Tsarskoïe Selo. Peinture de l'artiste Vladimir Borovikovsky, 1794
Catherine II pour une promenade dans le parc Tsarskoïe Selo. Peinture de l'artiste Vladimir Borovikovsky, 1794
A noter qu'en Europe, la « débauche » de Catherine n'est pas un phénomène si rare sur fond de libertinage général du XVIIIe siècle. La plupart des rois (à l'exception peut-être de Frédéric le Grand, Louis XVI et Charles XII) avaient de nombreuses maîtresses. Cependant, cela ne s'applique pas aux reines et impératrices régnantes. Ainsi, l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse a écrit sur le "dégoût et l'horreur" que lui inculquent des personnes comme Catherine II, et cette attitude envers cette dernière était partagée par sa fille Marie-Antoinette. Comme l'écrit à ce propos K. Valishevsky, comparant Catherine II à Louis XV, « la différence des sexes jusqu'à la fin des siècles, pensons-nous, donnera un caractère profondément différent aux mêmes actes, selon qu'ils sont commis par un homme ou femme... les maîtresses de Louis XV n'ont jamais influencé le destin de la France."
Les exemples sont nombreux de l'influence exceptionnelle (tant négative que positive) exercée par les favoris de Catherine (Orlov, Potemkine, Platon Zoubov, etc.) sur le sort du pays, à partir du 28 juin (9 juillet 1762 et jusqu'à son mort l'impératrice, ainsi que sur sa politique intérieure, étrangère et même sur l'action militaire. Comme l'écrit NI Pavlenko, pour plaire au favori Grigori Potemkine, qui enviait la renommée du feld-maréchal Rumyantsev, ce commandant exceptionnel et héros des guerres russo-turques a été destitué par Catherine du commandement de l'armée et contraint de se retirer dans son domaine. . Un autre commandant très médiocre, Mousin-Pouchkine, au contraire, a continué à diriger l'armée, malgré ses bévues dans les campagnes militaires (pour lesquelles l'impératrice elle-même l'a qualifié de "vrai idiot") - du fait qu'il était un " favori le 28 juin", l'un de ceux qui ont aidé Catherine à s'emparer du trône.
De plus, l'institution du favoritisme a eu un effet négatif sur les mœurs de la haute noblesse, qui recherchait des avantages par la flatterie envers le nouveau favori, essayait de conduire "leur homme" dans les amants de l'impératrice, etc. Un contemporain MM Shcherbatov a écrit que le favoritisme et la débauche de Catherine II ont contribué au déclin des mœurs de la noblesse de cette époque, et les historiens sont d'accord avec cela.
Catherine avait deux fils : Pavel Petrovich (1754) et Alexei Bobrinsky (1762 - le fils de Grigory Orlov), ainsi que sa fille Anna Petrovna (1757-1759, peut-être du futur roi de Pologne Stanislav Ponyatovsky) décédée en bas âge. Moins probable est la maternité de Catherine par rapport à l'élève de Potemkine Elizabeth, qui est née lorsque l'impératrice avait plus de 45 ans.
Le traducteur du Collège des Affaires étrangères, Ivan Pakarin, s'est fait passer pour un fils (ou, selon une autre version, en gendre de Catherine II).
Récompenses
- Ordre de Sainte Catherine (10 (21) février 1744)
- Ordre de Saint André le Premier Appelé (28 juin (9 juillet 1762)
- Ordre de Saint-Alexandre Nevski (28 juin (9 juillet 1762)
- Ordre de Sainte Anne (28 juin (9 juillet 1762)
- Ordre de Saint-Georges 1 er. (26 novembre (7 décembre) 1769)
- Ordre de Saint Vladimir 1 er. (22 septembre / 3 octobre 1782)
- Ordre prussien de l'Aigle noir (1762)
- Ordre suédois des Séraphins (27 février (10 mars) 1763)
- Ordre polonais de l'Aigle blanc (1787)
Images artistiques de Catherine
Au cinéma
- Paradis interdit, 1924. Paul Negri comme Catherine
- "Caprice de Catherine II", 1927, RSS d'Ukraine. Vera Argutinskaya dans le rôle de Catherine
- "L'impératrice salope", 1934 - Marlene Dietrich
- Munchausen, 1943 - Brigitte Horney.
- Un scandale royal, 1945 - Tallulah Bankhead.
- "Amiral Ouchakov", 1953. Olga Zhizneva dans le rôle de Catherine.
- John Paul Jones 1959 - Bette Davis
- "Soirées dans une ferme près de Dikanka", 1961 - Zoya Vasilkova.
- "La lettre manquante", 1972 - Lydia Vakula
- "J'ai une idée!", 1977 - Alla Larionova
- Emelyan Pougatchev, 1978; "L'âge d'or", 2003 - Via Artmane
- "La chasse au tsar", 1990 - Svetlana Kryuchkova.
- "Jeune Catherine", 1991. Julia Ormond comme Catherine
- "Rêves de Russie", 1992 - Marina Vlady
- "Anecdote", 1993 - Irina Muravyova
- "L'émeute russe", 2000 - Olga Antonova
- "Arche russe", 2002 - Maria Kuznetsova
- "Comme des cosaques", 2009 - Nonna Grishaeva.
- "L'Impératrice et le Voleur", 2009. Alena Ivchenko dans le rôle de Catherine.
Films de télévision
- "Grande Catherine", 1968. Jeanne Moreau comme Catherine
- Réunion des esprits, 1977. Jane Meadows comme Catherine.
- "La fille du capitaine", 1978. Natalia Gundareva comme Catherine
- "Mikhailo Lomonosov", 1986. Katrin Kokhv comme Catherine
- "Russie", Angleterre, 1986. Dans le rôle - Valentina Azovskaya.
- "Comtesse Sheremeteva", 1988. Lydia Fedoseeva-Shukshina comme Catherine.
- "Vivat, aspirants!", 1991; "Aspirants-3", (1992). Kristina Orbakaite dans le rôle de la princesse Fike (future Catherine)
- Catherine la Grande, 1995. Catherine Zeta-Jones comme Catherine
- "Soirées dans une ferme près de Dikanka", (2002). Lydia Fedoseeva-Shukshina dans le rôle de Catherine.
- "Favori", 2005. Dans le rôle de Catherine - Natalia Surkova
- "Catherine la Grande", 2005. Emily Bruni dans le rôle de Catherine
- "Avec la plume et l'épée", 2007. Dans le rôle de Catherine - Alexander Kulikov
- "Le Mystère du Maestro", 2007. Olesya Zhurakovskaya comme Catherine
- "Les Mousquetaires de Catherine", 2007. Dans le rôle de Catherine - Alla Oding
- "Samouraï d'argent", 2007. Tatiana Polonskaya dans le rôle de Catherine
- « Les Romanov. Le cinquième film, 2013. Vasilisa Elpatievskaya dans le rôle de la jeune Catherine ; à maturité - Anna Yashina.
- Ekaterina, 2014. Marina Aleksandrova dans le rôle d'Ekaterina.
- "Le Grand", 2015. Yulia Snigir dans le rôle de Catherine.
- "Catherine. Décollage ", 2016. Dans le rôle de Catherine - Marina Alexandrova.
Dans la fiction
- Nikolaï Gogol. "Soirées à la ferme près de Dikanka" (1832)
- Alexandre Pouchkine. "La fille du capitaine" (1836)
- Grigori Danilevski. "Princesse Tarakanova" (1883)
- Evgeny Salias. Action de Saint-Pétersbourg (1884), Dans le Vieux Moscou (1885), Secrétaire du Sénat (1896), Peter's Days (1903)
- Natalia Manaseina. La Princesse Zerbst (1912)
- Bernard Show. " Grande Catherine" (1913)
- Lev Jdanov. Le dernier favori (1914)
- Peter Krasnov. Catherine la Grande (1935)
- Nikolaï Ravitch. "Deux capitales" (1964)
- Vsevolod Ivanov. Impératrice Fike (1968)
- Valentin Pikul. "Avec une plume et une épée" (1963-72), "Favori" (1976-82)
- Maurice Simachko. "Sémiramis" (1988)
- Nina Sorotokina. "Date à Saint-Pétersbourg" (1992), "Chancellor" (1994), "The Law of Pairing" (1994)
- Boris Akounine. "Lecture parascolaire" (2002)
- Vasily Aksyonov. "Voltairiens et Voltairiens" (2004)
Monuments à Catherine II
Simferopol (perdu, restauré en 2016) Simferopol (restauré)
Simferopol (restauré)
- En 1846, un monument à l'impératrice a été solennellement inauguré dans la ville nommée en son honneur - Yekaterinoslav. Pendant la guerre civile, le directeur du musée historique local a sauvé le monument de la noyade dans le Dniepr par les makhnovistes. Pendant l'occupation de Dnepropetrovsk par les nazis, le monument a été retiré de la ville dans une direction inconnue. Introuvable jusqu'à aujourd'hui.
- A Veliky Novgorod sur le monument "1000e anniversaire de la Russie" parmi 129 figures des personnalités les plus éminentes de histoire russe(pour 1862) il y a une figure de Catherine II.
- En 1873, un monument à Catherine II a été inauguré sur la place Alexandrinskaya à Saint-Pétersbourg.
- En 1890, un monument à Catherine II est érigé à Simferopol. Détruit par le gouvernement soviétique en 1921.
- En 1904, un monument à Catherine II est inauguré à Vilna. Démantelé et évacué au plus profond de la Russie en 1915.
- En 1907, un monument à Catherine II a été inauguré à Ekaterinodar (a résisté jusqu'en 1920, a été restauré le 8 septembre 2006).
- A Moscou, devant le bâtiment de l'Atelier des artistes militaires du nom de M. B. Grekov (rue Armée soviétique, 4), un monument à Catherine II a été inauguré, qui est une statue en bronze de l'Impératrice sur un piédestal.
- En 2002, à Novorzhev, fondée par Catherine II, un monument a été inauguré en son honneur.
- Le 19 septembre 2007, un monument à Catherine II a été inauguré dans la ville de Vyshny Volochyok ; sculpteur Yu. V. Zlotya.
- Le 27 octobre 2007, des monuments à Catherine II ont été inaugurés à Odessa et Tiraspol.
- En 2007, un monument à Catherine II a été inauguré dans la ville de Marks (région de Saratov).
- Le 15 mai 2008, un monument à Catherine II a été inauguré à Sébastopol.
- Le 14 septembre 2008, un monument à Catherine II la Grande a été inauguré à Podolsk. Le monument représente l'impératrice au moment de la signature du décret du 5 octobre 1781, où figure l'inscription : "... avec toute la miséricorde que nous commandons de renommer le village économique de Podol une ville...". L'auteur est Alexander Rozhnikov, membre correspondant de l'Académie russe des arts.
- Le 7 juillet 2010, un monument à Catherine la Grande a été érigé en Allemagne de l'Est dans la ville de Zerbst.
- Le 23 août 2013, dans le cadre de la Foire d'Irbit, un monument à Irbit, démoli en 1917, a été rouvert.
- En juin 2016, un monument à Catherine II a été restauré dans la capitale de la Crimée, Simferopol.
- Le 13 août 2017, un monument à Catherine II a été inauguré dans la ville de Luga, qui est une statue en bronze de l'Impératrice sur un piédestal. L'auteur de la figure est le sculpteur V.M. Rychkov.
Catherine sur les pièces et les billets
 Moitié d'or à usage de palais avec le profil de Catherine II. 1777
Moitié d'or à usage de palais avec le profil de Catherine II. 1777
Enterré ici  Or 2 roubles à usage de palais avec le profil de Catherine II, 1785
Or 2 roubles à usage de palais avec le profil de Catherine II, 1785
Catherine II, née à Stettin
21 avril 1729.
Elle a passé 34 ans en Russie et est sortie
Là, mariée à Pierre III.
Quatorze ans
Elle a fait un triple projet - faire plaisir
Épouse, Elizabeth I et le peuple.
Elle a tout utilisé pour réussir.
Dix-huit années d'ennui et de solitude lui ont fait lire de nombreux livres.
Montée sur le trône de Russie, elle a lutté pour de bon,
Elle voulait apporter bonheur, liberté et propriété à ses sujets.
Elle pardonnait facilement et ne détestait personne.
Facilité de vie indulgente et amoureuse, de nature gaie, avec l'âme d'un républicain
Et avec un cœur bon - elle avait des amis.
Le travail était facile pour elle
En société et en sciences verbales, elle
J'ai trouvé du plaisir.

À y regarder de plus près, la biographie de Catherine II la Grande regorge d'un grand nombre d'événements qui ont considérablement influencé l'impératrice de l'empire russe.
Origine
Arbre généalogique des Romanov
 Relation entre Pierre III et Catherine II
Relation entre Pierre III et Catherine II
La ville natale de Catherine la Grande est Stettin (aujourd'hui Szczecin en Pologne), puis la capitale de la Poméranie. Le 2 mai 1729, une fille est née dans le château de la ville susmentionnée, nommée à la naissance Sophia Frederick August d'Anhalt-Zerbst.
La mère était la tante de Pierre III (qui était à l'époque tout un garçon) Johann Elizabeth, princesse de Holstein-Gottorp. Le père était le prince d'Anhalt-Zerbst - Christian August, l'ancien gouverneur de Stettin. Ainsi, la future impératrice était de sang très noble, bien qu'elle ne soit pas issue d'une famille monarchiquement riche.
Enfance et jeunesse
 Francis Boucher - Jeune Catherine la Grande
Francis Boucher - Jeune Catherine la Grande
Ayant fait ses études à la maison, Frederica, en plus de son allemand natif, a étudié l'italien, l'anglais et le français. Les bases de la géographie et de la théologie, de la musique et de la danse - l'éducation noble correspondante coexistaient avec des jeux d'enfants très mobiles. La fille s'intéressait à tout ce qui se passait autour et malgré un certain mécontentement de ses parents, elle participait à des jeux avec les garçons dans les rues de sa ville natale.
Ayant vu son futur mari pour la première fois en 1739, au château d'Eitin, Frederica n'était pas encore au courant de l'invitation à venir en Russie. En 1744, à l'âge de quinze ans, elle voyagea avec sa mère à travers Riga jusqu'en Russie à l'invitation de l'impératrice Elisabeth. Immédiatement après son arrivée, elle a commencé à étudier activement la langue, les traditions, l'histoire et la religion de sa nouvelle patrie. Les professeurs les plus éminents de la princesse étaient Vasily Adadurov, qui enseignait la langue, Simon Todorsky, qui étudiait l'orthodoxie avec Frederica, et le chorégraphe Lange.
Le 9 juillet, Sofia Federica Augusta a été officiellement baptisée et convertie à l'orthodoxie, nommée Ekaterina Alekseevna - c'est le nom qu'elle glorifiera plus tard.
Mariage
Malgré les intrigues de sa mère, à travers lesquelles le roi de Prusse Frédéric II tenta d'évincer le chancelier Bestoujev et d'accroître son influence sur la politique étrangère de l'Empire russe, Catherine ne tomba pas en disgrâce et le 1er septembre 1745, elle épousa Pierre Fedorovich, qui était son cousin germain.
 Cérémonie de mariage pour le règne de Catherine II. 22 septembre 1762. Confirmation. Gravure par A.Ya. Kolpachnikov. Dernier quart du XVIIIe siècle
Cérémonie de mariage pour le règne de Catherine II. 22 septembre 1762. Confirmation. Gravure par A.Ya. Kolpachnikov. Dernier quart du XVIIIe siècle
Devant l'inattention catégorique de la jeune épouse, qui s'intéressait exclusivement à l'art de la guerre et de l'exercice, la future impératrice se consacra à l'étude des lettres, des arts et des sciences. Parallèlement à l'étude des œuvres de Voltaire, Montesquieu et autres éclaireurs, la biographie de ses jeunes années est remplie de chasse, de bals divers et de mascarades.
Le manque d'intimité avec le conjoint légal ne pouvait qu'affecter l'apparence des amants, tandis que l'impératrice Elizabeth n'était pas satisfaite de l'absence d'héritiers et de petits-enfants.
Transférer deux grossesses infructueuses, Catherine a donné naissance à Paul, qui, selon le décret personnel d'Elisabeth, a été excommunié de sa mère et élevé séparément. Selon une théorie non confirmée, le père de Pavel était S.V. Saltykov, qui a été expulsé de la capitale immédiatement après la naissance de l'enfant. En faveur de cette déclaration peut être attribué le fait qu'après la naissance de son fils, Pierre III a finalement cessé de s'intéresser à sa femme et n'a pas hésité à faire des favoris.
 S. Saltykov
S. Saltykov
 Stanislav August Ponyatovsky
Stanislav August Ponyatovsky
Cependant, Catherine elle-même n'était pas inférieure à son mari et, grâce aux efforts de l'ambassadeur britannique Williams, elle a noué une relation avec Stanislav Poniatovsky, le futur roi de Pologne (grâce au patronage de Catherine II elle-même). Selon certains historiens, c'est de Poniatovsky qu'Anna est née, dont la propre paternité a été mise en doute par Peter.
Williams, pendant un certain temps un ami et un confident de Catherine, lui a accordé des prêts, manipulé et reçu des informations confidentielles concernant les plans de politique étrangère de la Russie et les actions de ses unités militaires pendant la guerre de sept ans avec la Prusse.
Les premiers plans visant à renverser son mari, la future Catherine la Grande, ont commencé à être nourris et exprimés en 1756, dans des lettres à Williams. Voyant l'état douloureux de l'impératrice Elizabeth, et sans aucun doute sur la propre incompétence de Pierre, le chancelier Bestoujev a promis de soutenir Catherine. De plus, Catherine a attiré Prêts anglais pour soudoyer des partisans.
En 1758, Elizabeth commença à soupçonner un complot entre le commandant en chef de l'empire russe Apraksin et le chancelier Bestoujev. Ce dernier a réussi à éviter la disgrâce à temps en détruisant toute correspondance avec Catherine. D'anciens favoris, dont Williams, rappelés en Angleterre, ont été retirés de Catherine et elle a été forcée de chercher de nouveaux supporters - il s'agissait de Dashkova et des frères Orlov.
 Ambassadeur britannique Ch, Williams
Ambassadeur britannique Ch, Williams
 Frères Alexey et Grigory Orlov
Frères Alexey et Grigory Orlov
Le 5 janvier 1761, l'impératrice Elisabeth mourut et Pierre III monta sur le trône par droit de succession. Le prochain tour dans la biographie de Catherine a commencé. Le nouvel empereur envoya sa femme à l'autre bout du Palais d'Hiver, la remplaçant par sa maîtresse Elizaveta Vorontsova. En 1762, la grossesse soigneusement cachée de Catherine au comte Grigory Orlov, avec qui elle a commencé une relation en 1760, ne pouvait en aucun cas s'expliquer par une relation avec son conjoint légal.
Pour cette raison, pour détourner l'attention, le 22 avril 1762, l'un des serviteurs dévoués de Catherine a mis le feu à sa propre maison - Pierre III, qui aime de tels spectacles, a quitté le palais et Catherine a calmement donné naissance à Alexei Grigorievich Bobrinsky.
Organisation du coup d'Etat
Dès le début de son règne, Pierre III a provoqué le mécontentement de ses subordonnés - une alliance avec la Prusse, qui a été vaincue lors de la guerre de Sept Ans, une aggravation des relations avec le Danemark. sécularisation des terres de l'église et plans pour changer les pratiques religieuses.
Profitant de l'impopularité de son mari parmi les militaires, les partisans de Catherine ont commencé à agiter activement les unités de gardes pour se ranger du côté de la future impératrice en cas de coup d'État.
Le petit matin du 9 juillet 1762 marqua le début du renversement de Pierre III. Ekaterina Alekseevna est arrivée à Pétersbourg en provenance de Peterhof, accompagnée des frères Orlov et profitant de l'absence de son mari, elle a prêté serment d'allégeance d'abord aux unités de gardes, puis aux autres régiments.
 Le serment du régiment Izmailovsky à Catherine II. Artiste inconnu. Fin XVIIIe - premier tiers du XIXe siècle
Le serment du régiment Izmailovsky à Catherine II. Artiste inconnu. Fin XVIIIe - premier tiers du XIXe siècle
Se déplaçant avec les troupes qui ont rejoint l'impératrice, l'impératrice a d'abord reçu de Pierre une offre de négocier, et pourquoi abdiquer le trône.
Après la conclusion, la biographie de l'ex-empereur était aussi triste que vague. Le mari arrêté est décédé alors qu'il était en état d'arrestation à Ropsha, et les circonstances de sa mort sont restées floues. Selon un certain nombre de sources, il a été soit empoisonné, soit décédé subitement d'une maladie inconnue.
Après être montée sur le trône, Catherine la Grande a publié un manifeste accusant Pierre III d'avoir tenté de changer de religion et de conclure la paix avec la Prusse hostile.

Le début du règne
En politique étrangère, les bases ont été jetées pour la création du système dit du Nord, qui consistait dans le fait que les États non catholiques du Nord : Russie, Prusse, Angleterre, Suède, Danemark et Saxe, plus la Pologne catholique, se sont unis contre Autriche et France. La première étape vers la mise en œuvre du projet a été considérée comme la conclusion d'un accord avec la Prusse. Des articles secrets étaient joints au traité, selon lesquels les deux alliés s'engageaient à agir en même temps en Suède et en Pologne afin d'empêcher leur renforcement.
 Roi de Prusse - Frédéric II le Grand
Roi de Prusse - Frédéric II le Grand
La situation en Pologne préoccupait particulièrement Catherine et Friedrich. Ils ont convenu d'empêcher les changements dans la constitution polonaise, d'empêcher et de détruire toutes les intentions qui pourraient conduire à cela, même le recours aux armes. Dans un article séparé, les Alliés ont accepté de patronner les dissidents polonais (c'est-à-dire la minorité non catholique - orthodoxes et protestants) et de persuader le roi polonais de les égaliser en droits avec les catholiques.
L'ancien roi Auguste III est décédé en 1763. Frédéric et Catherine se sont donné la difficile tâche de placer leur protégé sur le trône de Pologne. L'impératrice voulait que ce soit son ancien amant, le comte Poniatovsky. Pour y parvenir, elle ne s'est arrêtée ni à soudoyer les députés de la Diète, ni à l'introduction de troupes russes en Pologne.
Toute la première moitié de l'année a été consacrée à la propagande active du protégé russe. Le 26 août, Poniatowski est élu roi de Pologne. Catherine se réjouit beaucoup de ce succès et, sans tarder, ordonna à Poniatowski de soulever la question des droits des dissidents, malgré le fait que tous ceux qui connaissaient la situation en Pologne soulignaient la grande difficulté et la quasi-impossibilité d'atteindre cet objectif. Poniatovsky a écrit à son ambassadeur à Saint-Pétersbourg, Rzhevsky :
« Les ordres donnés à Repnine (l'ambassadeur de Russie à Varsovie) d'introduire des dissidents dans l'activité législative de la république sont des coups tonitruants tant pour le pays que pour moi personnellement. S'il y a une possibilité humaine, convainc l'Impératrice que la couronne qu'elle m'a apportée deviendra pour moi le vêtement de Ness : j'y brûlerai et ma fin sera terrible. Je prévois clairement un choix terrible qui m'attend si l'Impératrice insiste sur ses ordres : soit je devrai abandonner son amitié, si chère à mon cœur et si nécessaire à mon règne et à mon état, soit je devrai devenir un traître. à ma patrie.
 Diplomate russe N.V. Repnin
Diplomate russe N.V. Repnin
Même Repnin était horrifié par les intentions de Catherine :
"Les ordres donnés" sur l'affaire dissidente sont terribles, - écrit-il à Panin, - vraiment mes cheveux se dressent quand je pense à lui, n'ayant presque aucun espoir, à part la seule force, d'accomplir la volonté du plus gracieux impératrice concernant les avantages de la dissidence civile " ...
Mais Catherine n'a pas été horrifiée et a ordonné de répondre à Ponyatovsky qu'elle ne comprend décidément pas comment les dissidents, admis à l'activité législative, seraient donc plus hostiles à l'État et au gouvernement polonais qu'ils ne le sont actuellement ; ne comprend pas comment le roi se considère comme un traître à la patrie pour ce que demande la justice, qui fera sa gloire et le bien de l'État.
« Si le roi considère cette affaire de cette manière, conclut Catherine, alors il me reste un regret éternel et sensible d'avoir pu me tromper dans l'amitié du roi, dans ses pensées et ses sentiments.
L'impératrice exprimant si clairement son désir, Repnine à Varsovie fut obligée d'agir avec toute la fermeté possible. Par des intrigues, des pots-de-vin et des menaces, l'introduction de troupes russes dans les faubourgs de Varsovie et l'arrestation des opposants les plus tenaces, Repnine atteint son objectif le 9 février 1768. La Diète était d'accord avec la liberté de religion pour les dissidents et leur égalisation politique avec la gentry catholique.
Il semblait que l'objectif était atteint, mais en réalité ce n'était que le début d'une grande guerre. L'équation dissidente a mis le feu à toute la Pologne. La Diète, qui a approuvé l'accord le 13 février, s'était à peine dispersée, que l'avocat Pulawski a soulevé une confédération contre lui à Bar. Avec sa main légère, des confédérations anti-dissidentes ont commencé à éclater dans toute la Pologne.
La réponse des orthodoxes à la confédération de Barsk fut la révolte de Haidamak de 1768, au cours de laquelle, avec les Haidamaks (fugitifs russes qui fuyaient dans la steppe), les cosaques zaporojies, dirigés par Zheleznyak, et les serfs avec le centurion Gonta se soulevèrent. . Au plus fort du soulèvement, l'un des détachements de Haidamak a traversé la rivière frontière Kolyma et a pillé la ville tatare de Galtu. Dès qu'il fut connu à Istanbul, un corps turc de 20 000 hommes fut déplacé vers les frontières. Le 25 septembre, l'ambassadeur de Russie Obrezkov a été arrêté, les relations diplomatiques ont été rompues - ont commencé Guerre russo-turque... L'affaire dissidente a donné une tournure si inattendue.
Les premières guerres
Ayant subitement reçu deux guerres dans ses bras, Catherine n'était pas du tout embarrassée. Au contraire, les menaces de l'ouest et du sud ne faisaient que lui donner de la ferveur. Elle écrivit au comte Tchernychev :
« Les Turcs et les Français se sont ravis de réveiller le chat qui dormait ; Je suis ce chat, qui promet de se faire connaître d'eux, pour que le souvenir ne disparaisse pas de sitôt. Je trouve qu'on s'est libéré d'un grand poids qui opprime l'imagination quand on a délié le traité de paix... Maintenant je suis délié, je peux faire tout ce que mes moyens me permettent, et la Russie, tu sais, n'a pas de petits moyens.. Je ne m'y attendais pas, et maintenant les Turcs seront battus. "
L'enthousiasme de l'impératrice se transmet à son entourage. Déjà lors de la première réunion du Conseil le 4 novembre, il avait été décidé de mener une guerre non pas défensive, mais offensive, et surtout d'essayer de relever les chrétiens opprimés par la Turquie. A cet effet, le 12 novembre, Grigori Orlov propose d'envoyer une expédition en Méditerranée afin de contribuer au soulèvement des Grecs.
Catherine a aimé ce plan, et elle s'est mise avec énergie à le mettre en œuvre. Le 16 novembre, elle écrit à Chernyshev :
"J'ai tellement chatouillé nos marins par leur métier qu'ils sont devenus fougueux."
Et quelques jours plus tard :
"J'ai la flotte en excellent soin aujourd'hui, et je vais vraiment l'utiliser de cette façon, si Dieu l'ordonne, comme cela ne l'a pas encore été..."
 Prince A.M. Golitsyne
Prince A.M. Golitsyne
Les hostilités commencent en 1769. L'armée du général Golitsyne franchit le Dniepr et s'empare de Khotine. Mais Catherine était mécontente de sa lenteur et a remis le haut commandement à Rumyantsev, qui s'est rapidement emparé de la Moldavie et de la Valachie, ainsi que de la côte de la mer d'Azov avec Azov et Taganrog. Catherine ordonna de renforcer ces villes et de commencer l'organisation de la flottille.
Elle a développé cette année une énergie incroyable, a travaillé comme un vrai chef d'état-major, a entré les détails des préparatifs militaires, fait des plans et des instructions. En avril, Catherine écrit à Chernyshev :
« Je brûle l'empire turc des quatre coins ; Je ne sais pas s'il va s'enflammer ou brûler, mais je sais que depuis le début ils n'ont pas encore été utilisés contre leurs grands ennuis et soucis... Nous avons fait beaucoup de bouillie, ce sera savoureux pour quelqu'un. J'ai une armée dans le Kouban, des armées contre les Polonais stupides, prêtes à combattre les Suédois, et trois autres troubles inpetto, que je n'ose pas montrer ... "
En effet, il y avait beaucoup de problèmes et de soucis. En juillet 1769, une escadre commandée par Spiridov quitte enfin Kronstadt. Sur les 15 grands et petits navires de l'escadre, seuls huit ont atteint la mer Méditerranée.
Avec ces forces, Alexey Orlov, qui était soigné en Italie et a demandé à être le chef du soulèvement des chrétiens turcs, a soulevé la Morée, mais n'a pas pu donner aux rebelles un dispositif de combat solide et, ayant échoué face à l'armée turque qui approchait, laissa les Grecs se débrouiller seuls, irrité de ne pas trouver en eux Thémistocle. Catherine a approuvé toutes ses actions.




Rejoignant l'autre escadre d'Elfingston, qui s'était approchée entre-temps, Orlov poursuivit la flotte turque et dans le détroit de Chios près de la forteresse Chesme rattrapa l'armada en nombre de navires plus de deux plus forts que la flotte russe. Après une bataille de quatre heures, les Turcs se réfugièrent dans la baie de Chesme (24 juin 1770). Un jour plus tard, par une nuit au clair de lune, les Russes ont lancé des brûlots et au matin, la flotte turque entassée dans la baie a été incendiée (26 juin).
D'étonnantes victoires navales dans l'archipel ont été suivies de victoires terrestres similaires en Bessarabie. Ekaterina a écrit à Roumiantsev :
"J'espère que l'aide divine et votre art dans les affaires militaires, que vous ne quitterez pas cela de la meilleure façon pour satisfaire et accomplir de telles actions qui vous gagneront la gloire et prouveront à quel point votre zèle pour votre patrie et moi est grand. Les Romains ne demandaient pas quand, où étaient leurs deux ou trois légions, en nombre contre eux l'ennemi, mais où est-il ; ils l'attaquèrent et le frappèrent, et non par la multitude de leurs troupes vainquirent les divers contre leur foule..."
Inspiré par cette lettre, Roumiantsev en juillet 1770 a vaincu à deux reprises les armées turques plusieurs fois supérieures à Larga et Cahul. Dans le même temps, une importante forteresse sur le Dniestr de Bender a été prise. En 1771, le général Dolgorukov perce Perekop en Crimée et s'empare des forteresses de Kafu, Kertch et Yenikale. Khan Selim-Girey s'enfuit en Turquie. Le nouveau khan Sahib-Girey s'empressa de conclure la paix avec les Russes. Sur ce, les actions actives ont pris fin et de longues négociations sur la paix ont commencé, ce qui a de nouveau renvoyé Catherine aux affaires polonaises.


 Bender d'assaut
Bender d'assaut
Les succès militaires de la Russie ont suscité l'envie et les craintes dans les pays voisins, principalement en Autriche et en Prusse. Les malentendus avec l'Autriche ont atteint un point tel qu'ils ont parlé haut et fort de la possibilité d'une guerre avec elle. Frédéric a fortement inspiré l'impératrice russe que le désir de la Russie d'annexer la Crimée et la Moldavie pourrait conduire à une nouvelle guerre européenne, puisque l'Autriche n'accepterait jamais cela. Il est beaucoup plus raisonnable de prendre une partie des possessions polonaises en compensation. Il a directement écrit à son ambassadeur, Solms, que pour la Russie, peu importe où elle recevra la récompense à laquelle elle a droit pour les pertes de guerre, et puisque la guerre a commencé uniquement à cause de la Pologne, la Russie a le droit de recevoir une récompense. des régions frontalières de cette république. Dans le même temps, l'Autriche aurait dû recevoir sa part - cela modérera son hostilité. Le roi, lui non plus, ne peut se passer d'acquérir une partie de la Pologne pour lui-même. Cela servira de récompense pour les subventions et autres coûts qu'il a encourus pendant la guerre.
Petersburg aimait l'idée de diviser la Pologne. Le 25 juillet 1772, un accord des trois partageurs de pouvoirs a suivi, selon lequel l'Autriche a reçu toute la Galicie, la Prusse - Prusse occidentale et la Russie - Biélorussie. Après avoir réglé les contradictions avec ses voisins européens aux dépens de la Pologne, Catherine pourrait entamer des négociations turques.
Rupture avec Orlov
Au début de 1772, avec l'aide des Autrichiens, il fut convenu de commencer en juin un congrès de paix avec les Turcs à Focsani. Le comte Grigori Orlov et l'ancien ambassadeur de Russie à Istanbul Obrezkov ont été nommés plénipotentiaires du côté russe.
Il semblait que rien ne laissait présager la fin de la relation de 11 ans de l'impératrice avec le favori, mais entre-temps, la star d'Orlov avait déjà sombré. Certes, avant de se séparer de lui, Catherine a enduré de son amant autant qu'une femme rare peut supporter de son mari légal.
Déjà en 1765, sept ans avant la rupture définitive entre eux, Béranger rapportait de Pétersbourg :
»Ce Russe viole ouvertement les lois de l'amour vis-à-vis de l'impératrice. Il a des maîtresses dans la ville qui non seulement n'encourent pas la colère de l'impératrice pour leur souplesse envers Orlov, mais, au contraire, jouissent de son patronage. Le sénateur Muravyov, qui a trouvé sa femme avec lui, a failli faire un scandale en demandant le divorce ; mais la reine le pacifia en faisant don de terres en Livonie. »
« Je ne peux plus me retenir et ne pas informer Votre Majesté de événement intéressant cela vient de se passer dans cette cour. L'absence du comte Orlov révéla une circonstance très naturelle, mais néanmoins inattendue : Sa Majesté trouva la possibilité de se passer de lui, de changer ses sentiments pour lui et de porter son humeur sur un autre sujet.
 A. S. Vasilchakov
A. S. Vasilchakov
Le cornet de garde à cheval Vasilchikov, envoyé accidentellement avec un petit détachement à Tsarskoïe Selo pour porter la garde, a attiré l'attention de son impératrice, complètement inattendue pour tout le monde, car il n'y avait rien de spécial dans son apparence, et lui-même n'a jamais essayé d'avancer et est très peu connu dans la société... Lorsque la cour royale déménagea de Tsarskoïe Selo à Peterhof, Sa Majesté lui montra pour la première fois un signe de sa faveur, lui offrant une tabatière en or pour l'entretien des gardes.
Ils n'attachaient cependant aucune importance à cette affaire, les fréquentes visites de Vasilchikov à Peterhof, la sollicitude avec laquelle elle s'empressait de le distinguer des autres, la disposition plus calme et plus gaie de son esprit depuis le départ d'Orlov, le mécontentement de la famille et des amis de ce dernier, enfin, bien d'autres petites circonstances ont ouvert les yeux des courtisans...
Bien que tout soit encore gardé secret, aucun de ses proches ne doute que Vasilchikov soit déjà en pleine faveur auprès de l'impératrice ; ils s'en sont convaincus surtout à partir du jour où il a été accordé par le junker de chambre.. "
Pendant ce temps, Orlov a rencontré à Focsani des obstacles insurmontables à la conclusion de la paix. Les Turcs ne voulaient pas reconnaître l'indépendance des Tatars. Le 18 août, Orlov a rompu les négociations et est parti pour Yassy, au quartier général de l'armée russe. Ici, je lui ai trouvé la nouvelle d'un changement brutal qui a suivi dans sa vie. Orlov a tout laissé tomber et sur des chevaux de poste s'est précipité à Pétersbourg, espérant retrouver ses anciens droits. A cent milles de la capitale, il fut arrêté par ordre de l'impératrice : Orlov reçut l'ordre de se rendre dans ses domaines et de n'en repartir qu'à l'expiration de la quarantaine (il conduisait depuis le territoire où sévissait la peste). Bien que pas immédiatement le favori ait dû se réconcilier, au début de 1773, il est néanmoins arrivé à Saint-Pétersbourg et a été favorablement accueilli par l'impératrice, mais il ne pouvait être question de la relation précédente.
« Je dois beaucoup à la famille Orlov », a déclaré Ekaterina, « je les ai comblées de richesses et d'honneurs ; et je les garderai toujours avec condescendance, et ils peuvent m'être utiles ; mais ma décision est invariable : j'ai tenu pendant onze ans ; maintenant je veux vivre comme il me plaît, et tout à fait indépendamment. Quant au prince, il peut faire ce qu'il veut : il est libre de voyager ou de rester dans l'empire, de boire, de chasser, d'avoir des maîtresses... Il se comportera bien, honneur et gloire à lui, ils conduiront mal - il est honteux ... "
***
Les années 1773 et 1774 s'avèrent agitées pour Catherine : les Polonais continuent de résister, les Turcs ne veulent pas faire la paix. La guerre, épuisant le budget de l'État, s'est poursuivie et, entre-temps, une nouvelle menace est apparue dans l'Oural. En septembre, Emelyan Pougatchev a soulevé le soulèvement. En octobre, les insurgés accumulèrent des forces pour le siège d'Orenbourg et les nobles autour de l'impératrice paniquèrent ouvertement.
Les affaires de cœur de Catherine n'allaient pas bien non plus. Plus tard, elle a avoué à Potemkine, se référant à sa relation avec Vasilchikov :
« J'étais plus triste que je ne peux le dire, et jamais plus que lorsque les autres sont satisfaits, et toutes sortes de caresses en moi forçaient des larmes, alors je pense que depuis ma naissance je n'ai pas autant pleuré que cette année et demie ; au début je pensais que je m'y habituerais, mais plus loin, pire, parce que de l'autre côté (c'est-à-dire du côté de Vasilchikov) ils ont commencé à bouder pendant trois mois, et je dois avouer que je n'ai jamais été plus heureux que quand je m'énerve et que je pars seule, mais sa caresse m'a fait pleurer."
On sait que dans ses favoris, Catherine recherchait non seulement des amants, mais aussi des assistants en matière de gouvernement. En fin de compte, elle a réussi à faire des Orlov de ne pas être de mauvais hommes d'État. Vasilchikov a eu moins de chance. Cependant, un autre concurrent est resté dans la réserve, que Catherine aimait depuis longtemps - Grigory Potemkin. Catherine l'a connu et célébré pendant 12 ans. En 1762, Potemkine servit comme sergent dans le régiment des Horse Guards et prit une part active au coup d'État. Dans la liste des récompenses après les événements du 28 juin, il s'est vu attribuer le grade de cornet. Catherine barra cette ligne et écrivit de sa propre main « capitaine-lieutenant ».
En 1773, il est promu lieutenant général. En juin de cette année, Potemkine était dans une bataille sous les murs de Silistrie. Mais quelques mois plus tard, il a soudainement demandé un congé et a rapidement quitté l'armée. La raison en est l'événement qui décide de sa vie : il reçoit de Catherine la lettre suivante :
« Monsieur le lieutenant-général ! Vous, j'imagine, êtes si préoccupé par la vue de Silistria que vous n'avez pas le temps de lire les lettres. Je ne sais pas si le bombardement a été un succès jusqu'à présent, mais malgré cela, je suis sûr que - quoi que vous entrepreniez personnellement - aucun autre objectif ne peut être prescrit que votre ardent zèle pour le bien de moi-même et de mon cher patrie, que vous servez avec amour. Mais, d'un autre côté, puisque je veux garder les gens diligents, courageux, intelligents et efficaces, je vous demande de ne pas être inutilement mis en danger. Après avoir lu cette lettre, vous pouvez demander pourquoi elle a été écrite ; à cela je peux te répondre : pour que tu aies confiance en ce que je pense de toi, tout comme je te souhaite bonne chance. »
En janvier 1774, Potemkine était à Saint-Pétersbourg, attendit encore six semaines, sondant le terrain, renforçant ses chances, et le 27 février il écrivit à l'impératrice une lettre dans laquelle il demandait à être gracieusement nommé adjudant général, « si elle considérait son services dignes." Trois jours plus tard, il reçut une réponse favorable et, le 20 mars, Vasilchikov reçut l'ordre le plus élevé de se rendre à Moscou. Il se retira, laissant la place à Potemkine, qui était destiné à devenir le favori le plus célèbre et le plus puissant de Catherine. En quelques mois, il a fait une carrière vertigineuse.
En mai, il a été nommé membre du Conseil, en juin, il a été accordé aux comtes, en octobre, il a été promu général en chef et en novembre, il a reçu l'Ordre de Saint-André le premier appelé. Tous les amis de Catherine étaient perplexes et trouvaient le choix de l'impératrice étrange, extravagant, voire insipide, car Potemkine était laid, tordu d'un œil, les jambes arquées, dur et même grossier. Grimm ne pouvait cacher son étonnement.
"Pourquoi? - Catherine lui a répondu. "Je parie, parce que je me suis éloigné d'un gentleman excellent, mais trop ennuyeux, que j'ai immédiatement remplacé, je ne sais vraiment pas comment, l'un des plus grands amusements, des plus intéressants excentriques que l'on puisse trouver dans notre âge du fer."
Elle était très contente de son nouvel achat.
« Oh, quelle tête a cet homme, dit-elle, et cette bonne tête est aussi drôle que le diable.
Plusieurs mois passèrent, et Potemkine devint un véritable souverain, un homme tout-puissant, devant lequel tous les rivaux s'effaçaient et toutes les têtes s'inclinaient, à commencer par celle de Catherine. Son entrée au Conseil équivalait à devenir le premier ministre. Il dirige la politique intérieure et étrangère et oblige Tchernychev à lui confier le poste de président du collège militaire.



Le 10 juillet 1774, les négociations avec la Turquie se terminent par la signature du traité de paix Kuchuk-Kainardzhi, selon lequel :
- l'indépendance des Tatars et du Khanat de Crimée vis-à-vis de l'Empire ottoman a été reconnue ;
- Kertch et Yenikale en Crimée quittent la Russie ;
- La Russie quitte le château de Kinburn et la steppe entre le Dniepr et le Bug, Azov, Bolshaya et Malaya Kabarda ;
- libre navigation des navires marchands de l'Empire russe à travers le Bosphore et les Dardanelles ;
- la Moldavie et la Valachie ont reçu le droit à l'autonomie et sont passées sous le patronage russe ;
- L'Empire russe a reçu le droit de construire à Constantinople église chrétienne, et les autorités turques se sont engagées à lui assurer une protection
- Interdiction de l'oppression des orthodoxes en Transcaucase, de la collecte d'hommages par les peuples de Géorgie et de Mingrélie.
- 4,5 millions de roubles d'indemnité.
La joie de l'impératrice était grande - personne ne comptait sur une paix aussi profitable. Mais en même temps, des nouvelles de plus en plus inquiétantes arrivaient de l'est. Pougatchev a déjà été vaincu deux fois. Il s'enfuit, mais sa fuite ressemblait à une invasion. Jamais le succès de l'insurrection ne fut plus grand qu'à l'été 1774, jamais la révolte ne fit rage avec tant de puissance et de cruauté.
L'indignation s'est transmise comme une traînée de poudre d'un village à l'autre, de province en province. Cette triste nouvelle fit une profonde impression à Saint-Pétersbourg et assombrit l'ambiance victorieuse après la fin de la guerre de Turquie. Ce n'est qu'en août que Pougatchev a finalement été vaincu et capturé. Le 10 janvier 1775, il est exécuté à Moscou.
Quant aux affaires polonaises, le 16 février 1775, la Sejm adopta enfin une loi sur l'égalisation des dissidents en droits politiques avec les catholiques. Ainsi, malgré tous les obstacles, Catherine a mis fin à cette affaire difficile et a mis fin avec succès à trois guerres sanglantes - deux externes et une interne.
 Exécution d'Emelyan Pougatchev
Exécution d'Emelyan Pougatchev
***
Le soulèvement de Pougatchev a révélé de graves lacunes de l'administration régionale existante : premièrement, les anciennes provinces représentaient des districts administratifs trop étendus, deuxièmement, ces districts étaient dotés d'un nombre trop insuffisant d'institutions avec un personnel maigre, et troisièmement, divers départements étaient mélangés dans cette administration : un seul et même service était chargé des affaires administratives, et financières, et des juridictions pénales et civiles. Afin d'éliminer ces lacunes, en 1775, Catherine entreprend une réforme provinciale.
Tout d'abord, elle a introduit une nouvelle division régionale : au lieu de 20 vastes provinces en lesquelles la Russie était alors divisée, maintenant tout l'empire était divisé en 50 provinces. La base de la division provinciale a été prise exclusivement par le nombre de la population. Les provinces de Catherine sont des districts de 300 à 400 000 habitants. Ils ont été subdivisés en comtés avec une population de 20 à 30 mille habitants. Chaque province a reçu une structure monotone, administrative et judiciaire.
À l'été 1775, Catherine séjourna à Moscou, où lui fut donnée la maison des princes Golitsyne à la porte Prechistensky. Début juillet, le vainqueur des Turcs, le feld-maréchal comte Rumyantsev, est arrivé à Moscou. La nouvelle a survécu que Catherine, vêtue d'un sarafan russe, a rencontré Rumyantsev. sur le porche de la maison Golitsyn et, l'embrassant, l'embrassa. Puis elle a attiré l'attention sur Zavadovsky, un homme puissant, majestueux et exceptionnellement beau qui accompagnait le maréchal. Remarquant le regard affectueux et intéressé de l'impératrice, jeté par elle sur Zavadovsky, le feld-maréchal a immédiatement présenté le beau à Catherine, le flattant comme un homme bien éduqué, travailleur, honnête et courageux.
Catherine a offert à Zavadovsky une bague en diamant à son nom et a nommé son secrétaire de cabinet. Bientôt, il obtint le grade de major général et d'adjudant général, devint responsable du bureau personnel de l'impératrice et devint l'une des personnes les plus proches d'elle. En même temps, Potemkine s'aperçut que son charme pour l'Impératrice s'était affaibli. En avril 1776, il partit en permission pour réviser la province de Novgorod. Quelques jours après son départ, Zavadovsky s'installe à sa place.
 P.V. Zavadovski
P.V. Zavadovski
Mais, ayant cessé d'être un amant, Potemkine, accordé en 1776 aux princes, conserva toute son influence et la sincère amitié de l'impératrice. Presque jusqu'à sa mort, il est resté la deuxième personne de l'État, déterminé la politique intérieure et étrangère, et aucun des nombreux favoris suivants, jusqu'à Platon Zubov, n'a même essayé de jouer le rôle d'un homme d'État. Tous étaient proches de Catherine par Potemkine lui-même, qui tenta ainsi d'influencer la position de l'impératrice.
Tout d'abord, il a essayé de supprimer Zavadovsky. Potemkine a dû passer près d'un an là-dessus, et la chance n'est pas venue avant qu'il ne découvre Semyon Zorich. C'était un héros-cavalier et un bel homme, serbe de naissance. Potemkine a emmené Zorich à son adjudant et l'a presque immédiatement présenté pour être nommé commandant de l'escadron Life Hussar. Étant donné que les Life Hussars étaient la garde personnelle de l'impératrice, la nomination de Zorich à ce poste a été précédée de sa présentation à Catherine.
 S. G. Zorich
S. G. Zorich
En mai 1777, Potemkine a organisé une audience pour l'impératrice avec un favori potentiel - et il ne s'est pas trompé dans le calcul. Zavadovsky a soudainement reçu six mois de vacances et Zorich a obtenu le grade de colonel, d'escadre de camp et de chef de l'escadron Life Hussar. Zorich avait déjà moins de quarante ans, et il était plein de beauté courageuse, cependant, contrairement à Zavadovsky, il était peu instruit (plus tard il a lui-même admis qu'à l'âge de 15 ans il est allé à la guerre et que jusqu'à près de l'impératrice il est resté un ignorant complet ). Catherine a essayé de lui inculquer des goûts littéraires et scientifiques, mais il semble qu'elle ait eu peu de succès dans ce domaine.
Zorich était têtu et réticent à céder à l'éducation. En septembre 1777, il devint major général et, à l'automne 1778, comte. Mais ayant reçu ce titre, il s'en offusqua soudain, car il attendait un titre princier. Peu de temps après, il a eu une querelle avec Potemkine, qui a presque abouti à un duel. Pour en savoir plus, Catherine a dit à Zorich d'aller dans son domaine Shklov.
Même avant que Potemkine ne commence à chercher un nouveau favori pour sa petite amie. Plusieurs candidats ont été considérés, parmi lesquels, disent-ils, il y avait même des Persans, distingués par des données physiques extraordinaires. Enfin, Potemkine a choisi trois officiers - Bergman, Rontsov et Ivan Korsakov. Gelbich dit que Catherine s'est rendue dans la salle de réception, alors que les trois candidats désignés pour l'audience étaient là. Chacun d'eux se tenait avec un bouquet de fleurs, et elle a gracieusement parlé d'abord avec Bergman, puis avec Rontsov, et enfin avec Korsakov. La beauté et la grâce extraordinaires de ce dernier la conquirent. Catherine a souri gracieusement à tout le monde, mais avec un bouquet de fleurs a envoyé Korsakov à Potemkine, qui est devenu le prochain favori. On sait par d'autres sources que Korsakov n'a pas immédiatement atteint la position souhaitée.
En général, en 1778, Catherine connut une sorte de dépression morale et fut emportée par plusieurs jeunes à la fois. En juin, l'Anglais Harris célèbre l'ascension de Korsakov, et en août, il parle de ses rivaux qui tentent de lui ravir l'Impératrice ; ils sont soutenus d'une part par Potemkine, d'autre part par Panine avec Orlov ; en septembre Strakhov, un « bouffon de la plus basse espèce », l'emporta sur tout le monde ; quatre mois plus tard, il fut remplacé par le major Levashev du régiment Semionovsky, un jeune homme patronné par la comtesse Bruce. Puis Korsakov revient à nouveau à sa position précédente, mais maintenant il est aux prises avec le favori de Potemkine de Stoyanov. En 1779, il remporte enfin une victoire complète sur ses concurrents, devient chambellan et adjudant général.
À Grimm, qui considérait l'engouement de son ami comme un caprice ordinaire, Catherine écrivit :
"Caprice? Savez-vous ce que c'est : l'expression est tout à fait inappropriée dans ce cas lorsqu'ils parlent de Pyrrhus, le roi d'Épire (comme Catherine appelait Korsakova), et de ce sujet de la tentation de tous les artistes et du désespoir de tous les sculpteurs. Admiration, enthousiasme, pas caprice, excitent de telles créations exemplaires de la nature... Pyrrhus n'a jamais fait un seul geste ou mouvement ignoble ou ignorant... ce que tu aimerais qu'il soit..."
En plus de son apparence étonnante, Korsakov a charmé l'impératrice avec sa voix merveilleuse. Le règne du nouveau favori constitue une ère dans l'histoire de la musique russe. Catherine a invité les premiers artistes italiens à Pétersbourg pour que Korsakov puisse chanter avec eux. Elle écrit à Grimm :
"Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi capable d'apprécier les sons harmoniques que Pyrrha, le roi d'Épire."
 Rimski-Korsakov I.N.
Rimski-Korsakov I.N.
Malheureusement pour lui-même, Korsakov n'a pas pu maintenir la hauteur atteinte. Un jour du début de 1780, Catherine trouva le favori dans les bras de son amie et confidente, la comtesse Bruce. Cela a grandement refroidi son ardeur et bientôt la place de Korsakov a été prise par le garde à cheval de 22 ans Alexander Lanskoy.
Lanskoï a été présenté à Catherine par le chef de la police Tolstoï, il a aimé l'impératrice à première vue: elle lui a accordé l'aile des adjudants et a donné 10 000 roubles pour l'établissement. Mais il n'est pas devenu un favori. En tout cas, Lanskoï a fait preuve de beaucoup de bon sens dès le début et s'est tourné vers Potemkine, qui l'a nommé l'un de ses adjudants et a supervisé son éducation à la cour pendant environ six mois.
Il découvrit beaucoup de qualités merveilleuses chez son élève et au printemps 1780, le cœur léger, il le recommanda à l'Impératrice comme un ami cordial. Catherine fit de Lansky colonel, puis adjudant-général et chambellan, et bientôt il s'installa au palais dans les appartements vides de l'ancien favori.
De tous les amants de Catherine, celui-ci était sans aucun doute le plus doux et le plus doux. Selon ses contemporains, Lanskoy n'est entré dans aucune intrigue, a essayé de ne nuire à personne et a complètement renoncé aux affaires de l'État, croyant à juste titre que la politique le ferait se faire des ennemis. La seule passion dévorante de Lanskoy était Catherine, Il voulait régner seul dans son cœur et a tout fait pour y parvenir. Il y avait quelque chose de maternel dans la passion de l'impératrice de 54 ans pour lui. Elle le caressait et l'éduquait comme son enfant bien-aimé. Catherine écrit à Grimm :
"Pour que vous puissiez vous faire une idée de ce jeune homme, vous devez transmettre ce que le prince Orlov a dit de lui à l'un de ses amis:" Voyez quel genre de personne elle fera de lui! .. "Il dévore tout avec avidité! Il commença par avaler tous les poètes et leurs poèmes en un hiver ; et dans l'autre - plusieurs historiens... Sans rien étudier, nous aurons d'innombrables connaissances et trouverons plaisir à communiquer avec tout ce qu'il y a de meilleur et de plus dévoué. De plus, nous construisons et plantons ; en plus, nous sommes charitables, joyeux, honnêtes et pleins de simplicité."
Sous la direction de son mentor, Lanskoy a étudié le français, s'est familiarisé avec la philosophie et, enfin, s'est intéressé aux œuvres d'art dont l'impératrice aimait s'entourer. Les quatre années passées dans la société de Lanskoï furent peut-être les plus calmes et les plus heureuses de la vie de Catherine, comme en témoignent de nombreux contemporains. Cependant, elle a toujours mené une vie très modérée et mesurée.
***
La routine quotidienne de l'impératrice
Catherine se réveillait généralement à six heures du matin. Au début de son règne, elle s'habille et allume la cheminée. Plus tard, elle était habillée le matin par le cameraman Perekusikhina. Catherine s'est rincé la bouche à l'eau tiède, s'est frotté les joues avec de la glace et s'est rendue à son bureau. Ici, un café matinal très fort l'attendait, généralement accompagné de crème épaisse et de biscuits. L'Impératrice elle-même mangeait peu, mais la demi-douzaine de lévriers italiens, qui partageaient toujours le petit déjeuner avec Catherine, vidaient le sucrier et le panier de biscuits. Quand elle eut fini de manger, l'Impératrice laissa les chiens se promener, et elle-même s'assit pour travailler et écrivit jusqu'à neuf heures.
A neuf heures, elle retourna dans sa chambre et reçut les haut-parleurs. Le chef de la police a été le premier à entrer. Pour lire les papiers soumis à signature, l'impératrice portait des lunettes. Puis le secrétaire est venu et le travail a commencé avec les documents.
Comme vous le savez, l'impératrice lisait et écrivait en trois langues, mais en même temps faisait de nombreuses erreurs syntaxiques et grammaticales, non seulement en russe et en français, mais aussi dans son allemand natal. Les erreurs en russe, bien sûr, étaient les plus ennuyeuses de toutes. Catherine le savait et avoua un jour à l'une de ses secrétaires :
« Ne vous moquez pas de mon orthographe russe ; Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas eu le temps de bien l'étudier. Dès mon arrivée ici, j'ai commencé à étudier le russe avec une grande diligence. Tante Elizaveta Petrovna, apprenant cela, a dit à mon gofmeysteyrsha: pour lui apprendre complètement, elle est déjà intelligente. Ainsi, je n'ai pu apprendre le russe qu'à partir de livres sans professeur, et c'est la raison même pour laquelle je ne connais pas bien l'orthographe ».
Les secrétaires durent réécrire tous les brouillons de l'impératrice. Mais les cours avec le secrétaire étaient interrompus de temps à autre par des visites de généraux, de ministres et de dignitaires. Cela a duré jusqu'au déjeuner, qui était généralement un ou deux.
Après avoir congédié la secrétaire, Catherine se rendit dans la petite loge, où le vieux coiffeur Kolov se coiffait. Catherine ôta sa capuche et sa casquette, enfila une robe extrêmement simple, ouverte et ample à doubles manches et des chaussures larges à talons bas. En semaine, l'impératrice ne portait aucun bijou. Lors des cérémonies, Catherine portait une robe de velours chère, le soi-disant "style russe", et décorait ses cheveux d'une couronne. Elle ne suivait pas les modes parisiennes et n'encourageait pas ce plaisir coûteux chez ses dames de cour.
Ayant terminé la toilette, Catherine se rendit aux toilettes officielles, où ils finirent de l'habiller. C'était l'heure de la petite sortie. Les petits-enfants, le favori et plusieurs amis proches comme Lev Narychkine se sont réunis ici. Des morceaux de glace ont été servis à l'impératrice, et elle les a frottés ouvertement sur ses joues. Ensuite, les cheveux étaient recouverts d'un petit bonnet de tulle, et les toilettes s'arrêtaient là. Toute la cérémonie a duré environ 10 minutes. Après cela, tout le monde s'est mis à table.
En semaine, une douzaine de personnes étaient invitées à dîner. A droite était assis le favori. Le déjeuner a duré environ une heure et était très simple. Catherine ne s'est jamais souciée de la sophistication de sa table. Son plat préféré était le bœuf bouilli avec des cornichons. Elle utilisait du jus de groseille comme boisson. Dans les dernières années de sa vie, sur les conseils des médecins, Catherine buvait un verre de Madère ou de vin du Rhin. Pour le dessert, des fruits étaient servis, principalement des pommes et des cerises.
Parmi les cuisiniers de Catherine, on cuisinait très mal. Mais elle ne s'en aperçut pas, et lorsque, bien des années plus tard, son attention fut finalement attirée sur cela, elle ne se laissa pas calculer, disant qu'il avait trop longtemps servi dans sa maison. Elle ne se débrouillait que lorsqu'il était de service et, s'asseyant à table, disait aux convives :
"Nous sommes maintenant au régime, nous devons être patients, mais après cela, nous mangerons bien."
Après le dîner, Catherine a discuté quelques minutes avec les invités, puis tout le monde est parti. Catherine s'assit au cerceau - elle brodait très habilement - et Betsky lui lut à haute voix. Lorsque Betsky, ayant vieilli, a commencé à perdre de vue, elle n'a voulu le remplacer par personne et a commencé à lire elle-même en mettant des lunettes.
En analysant les nombreuses références aux livres qu'elle avait lus, éparpillées dans sa correspondance, on peut affirmer sans risque de se tromper que Catherine était au courant de toutes les nouveautés littéraires de son temps, et qu'elle lisait tout indifféremment : des traités philosophiques aux écrits historiques en passant par les romans. Elle, bien sûr, ne pouvait pas assimiler profondément tout ce matériel énorme, et son érudition restait largement superficielle, et ses connaissances étaient superficielles, mais en général elle pouvait juger de nombreux problèmes différents.
Le reste a duré environ une heure. L'impératrice est alors prévenue de l'arrivée du secrétaire : deux fois par semaine, elle trie avec lui le courrier étranger et prend des notes en marge des dépêches. D'autres jours fixes, des fonctionnaires venaient la voir avec des rapports ou pour des ordres.
Lors d'une pause dans les affaires, Catherine s'amuse sans souci avec les enfants.
En 1776, elle écrit à son amie Madame Belke :
« Il faut être drôle. Seulement cela nous aide à tout surmonter et à tout endurer. Je vous le dis par expérience, car j'ai surmonté et enduré beaucoup de choses dans ma vie. Mais j'ai quand même ri quand j'ai pu, et je vous jure que même à l'heure actuelle, où je supporte le poids de ma situation, je joue de bon coeur aux aveugles avec mon fils chaque fois que l'occasion se présente, et très souvent sans lui. On trouve un prétexte à cela, on se dit : "C'est bon pour la santé", mais, entre nous on dira, on le fait juste pour rigoler.»
A quatre heures, la journée de travail de l'impératrice se terminait, et c'était l'heure du repos et du divertissement. Par la longue galerie, Catherine passe du Palais d'Hiver à l'Ermitage. C'était son endroit préféré pour rester. Elle était accompagnée d'un favori. Elle examinait et hébergeait de nouvelles collections, jouait au billard et se livrait parfois à des sculptures sur ivoire. A six heures, l'Impératrice retourna dans les salons de l'Hermitage, déjà remplis de personnes admises à la cour.
Le comte Hord a décrit l'Ermitage comme suit dans ses mémoires :
« Il occupe toute une aile du palais impérial et se compose d'une galerie d'art, de deux grandes salles pour un jeu de cartes et d'une autre, où l'on dîne sur deux tables« comme une famille », et à côté de ces pièces il y a jardin d'hiver, intérieur et bien éclairé. Là, ils se promènent parmi les arbres et de nombreux pots de fleurs. Une variété d'oiseaux, principalement des canaris, y volent et y chantent. Le jardin est chauffé par des fours enterrés ; malgré le climat rigoureux, une température agréable y règne toujours.
Ce charmant appartement est rendu encore meilleur par la liberté qui règne ici. Tout le monde se sent à l'aise : l'impératrice a banni toute étiquette d'ici. Ici, ils marchent, jouent, chantent ; chacun fait ce qu'il veut. La galerie d'art regorge de chefs-d'œuvre de première classe ".
Des jeux de toutes sortes ont été un immense succès lors de ces rencontres. Catherine y participe la première, suscite la gaieté en chacun et laisse toutes sortes de libertés.
A dix heures, la partie se termina et Catherine se retira dans les chambres intérieures. Le dîner n'était servi qu'à l'occasion des cérémonies, mais même alors Catherine s'asseyait à table juste pour le spectacle. De retour dans sa chambre, elle entra dans la chambre, but un grand verre d'eau bouillie et se coucha.
Telle était la vie privée de Catherine selon les mémoires des contemporains. Sa vie intime est moins connue, même si elle n'est pas non plus un secret. L'Impératrice était une femme amoureuse qui, jusqu'à sa mort, conserva la faculté de se laisser emporter par les jeunes.
Il y avait plus d'une douzaine de ses amants officiels. Avec tout cela, comme déjà mentionné, elle n'était pas du tout une beauté.
"Pour dire la vérité, - a écrit Catherine elle-même, - je ne me suis jamais considérée comme extrêmement belle, mais je m'aimais bien, et je pense que c'était ma force."
Tous les portraits qui nous sont parvenus confirment cette opinion. Mais il ne fait aucun doute qu'il y avait quelque chose d'extrêmement attirant chez cette femme, qui échappait au pinceau de tous les peintres et faisait sincèrement admirer son apparence. Avec l'âge, l'impératrice n'a pas perdu son attrait, bien qu'elle devienne de plus en plus grosse.
Catherine n'était pas du tout venteuse ou dépravée. Beaucoup de ses relations ont duré des années, et bien que l'impératrice soit loin d'être indifférente aux plaisirs sensuels, la communication spirituelle avec un homme proche est restée très importante pour elle aussi. Mais il est vrai aussi que Catherine, après les Orlov, n'a jamais violé son cœur. Si la favorite cessait de l'intéresser, elle démissionnait sans cérémonie.
A la réception du soir suivant, les courtisans remarquèrent que l'Impératrice regardait fixement quelque lieutenant inconnu, qui ne lui avait été présenté que la veille ou qui s'était auparavant perdu dans une foule brillante. Tout le monde a compris ce que cela signifiait. Dans l'après-midi, le jeune homme a été convoqué au palais par une courte commande et soumis à de multiples tests de conformité dans l'exercice des fonctions intimes directes du favori de l'impératrice.
A.M. Tourgueniev raconte ce rite par lequel sont passés tous les amants de Catherine :
« Ils envoyaient généralement le favori de Sa Majesté à Anna Stepanovna Protasova pour un test. Après examen de la concubine nommée à la plus haute dignité, Mère-Impératrice, le beau-médecin Rogerson, et selon le certificat présenté comme apte au service en matière de santé, la personne recrutée a été escortée jusqu'à Anna Stepanovna Protasova pour une période de trois -essai de nuit. Lorsque la fiancée a pleinement satisfait aux exigences de Protasova, elle a informé l'impératrice toute miséricordieuse de la fiabilité de la personne testée, puis la première réunion a été fixée selon l'étiquette établie du tribunal ou selon les règles du plus haut niveau pour la consécration. à la dignité d'une concubine confirmée.
Perekusikhina Marya Savvishna et le valet Zakhar Konstantinovich ont été obligés de dîner avec l'élu le même jour. A 10 heures du soir, alors que l'impératrice était déjà couchée, Perekusikhina introduisit la recrue dans la chambre à coucher de la pieuse, vêtue d'une robe de chambre chinoise, un livre à la main, et le laissa lire sur les chaises près de la lit de l'oint. Le lendemain, Perekusikhina sortit l'initié de la chambre à coucher et le livra à Zakhar Konstantinovich, qui conduisit la concubine nouvellement nommée dans les palais préparés pour lui ; ici Zakhar déjà servilement au favori que la toute miséricordieuse impératrice a daigné le nommer en présence de sa plus haute personne comme adjudant d'aile, lui a présenté un uniforme d'adjudant d'aile avec un agraphe de diamant et 100 000 roubles d'argent de poche.
Avant que l'impératrice ne parte, l'hiver à l'Hermitage, et l'été, à Tsarskoïe Selo, au jardin, pour se promener avec le nouvel aide de camp, à qui elle a donné la main pour la conduire, la salle de devant de le nouveau favori était rempli des premiers dignitaires de l'État, nobles, courtisans pour lui apporter les félicitations les plus zélées d'avoir reçu la plus haute faveur. Le pasteur métropolitain très éclairé venait généralement chez le favori le lendemain pour sa consécration et le bénissait avec de l'eau bénite. ».
Par la suite, la procédure s'est compliquée et, après Potemkine, les favoris ont été contrôlés non seulement par la demoiselle d'honneur Protasov, mais aussi par la comtesse Bruce, Perekusikhina et Utochkina.
En juin 1784, Lanskoy tomba gravement et dangereusement malade - on disait qu'il avait miné sa santé en abusant de médicaments aphrodisiaques. Catherine n'a pas quitté le malade pendant une heure, elle a presque cessé de manger, a abandonné toutes ses affaires et s'est occupée de lui, comme une mère pour son seul fils infiniment aimé. Puis elle a écrit :
"La fièvre maligne en conjonction avec un crapaud l'a amené à la tombe en cinq jours."
Le soir du 25 juin, Lanskoy mourut. Le chagrin de Catherine était sans fin.
"Quand j'ai commencé cette lettre, j'étais dans le bonheur et la joie, et mes pensées se sont précipitées si vite que je n'ai pas eu le temps de les suivre", a-t-elle écrit à Grimm. - Maintenant tout a changé : je souffre terriblement, et mon bonheur n'est plus ; Je pensais que je ne pouvais pas supporter la perte irréparable que j'ai subie il y a une semaine lorsque mon meilleur ami est décédé. J'espérais qu'il serait le pilier de ma vieillesse : il s'efforçait aussi d'y parvenir, essayait de s'inculquer tous mes goûts. C'était un jeune homme que j'ai élevé, qui était reconnaissant, doux, honnête, qui partageait mes peines quand je les avais, et se réjouissait de mes joies.
En un mot, j'ai, en sanglotant, le malheur de vous dire que le général Lansky est parti... et ma chambre, que j'aimais tant autrefois, est maintenant devenue une caverne vide ; Je peux à peine le parcourir comme une ombre : à la veille de sa mort, j'ai eu mal à la gorge et une forte fièvre a commencé ; Cependant, depuis hier, je suis debout, mais je suis faible et tellement déprimé que je ne peux pas voir un visage humain, pour ne pas fondre en larmes au premier mot. Je suis incapable de dormir ou de manger. Lire m'ennuie, écrire épuise mes forces. Je ne sais pas ce que je vais devenir maintenant ; Je ne sais qu'une chose, c'est que jamais de toute ma vie je n'ai été aussi malheureux que depuis que mon meilleur et plus cher ami m'a quitté. J'ai ouvert le tiroir, trouvé cette feuille que j'avais commencée, écrit ces lignes dessus, mais je n'en peux plus... »
« Je t'avoue que pendant tout ce temps je n'ai pas pu t'écrire, car je savais que cela nous ferait souffrir tous les deux. Une semaine après que je vous ai écrit ma dernière lettre en juillet, Fiodor Orlov et le prince Potemkine sont venus me voir. Jusqu'à ce moment, je ne voyais pas de visage humain, mais ces gens savaient quoi faire : ils rugissaient avec moi, et puis je me sentais à l'aise avec eux ; mais il me fallait encore beaucoup de temps pour récupérer, et à cause de ma sensibilité à mon chagrin, je devenais insensible à tout le reste ; ma douleur grandissait de plus en plus et se rappelait à chaque pas et à chaque mot.
Cependant, ne pensez pas qu'à cause de cet état terrible, je néglige même la plus petite chose qui requiert mon attention. Dans les moments les plus pénibles, ils venaient me demander des ordres, et je les leur donnais de manière sensée et rationnelle ; cela frappa particulièrement le général Saltykov. Deux mois passèrent sans aucun soulagement ; enfin vinrent les premières heures calmes, puis les jours. C'était déjà l'automne dans la cour, il devenait humide, le palais de Tsarskoïe Selo devait être noyé. Tous les miens sont entrés dans une frénésie et si forte que le 5 septembre, ne sachant pas où reposer la tête, j'ai ordonné de poser la voiture et suis arrivé à l'improviste et pour que personne ne s'en doute, dans la ville où je logeais à l'Hermitage ... "
Au Palais d'Hiver, toutes les portes étaient verrouillées. Catherine ordonna de frapper à la porte de l'Ermitage et se coucha. Mais se réveillant à une heure du matin, elle ordonna de tirer les canons, qui annonçaient généralement son arrivée, et alarma toute la ville. Toute la garnison se leva, tous les courtisans furent effrayés, et elle-même s'étonna d'avoir causé une telle agitation. Mais quelques jours plus tard, après avoir donné audience au corps diplomatique, ils se présentent avec leur visage habituel, calmes, sains et frais, accueillants comme avant le désastre et souriants comme toujours.
Bientôt, la vie est revenue à son ornière, et l'amour pour toujours est revenu à la vie. Mais dix mois s'écoulèrent avant qu'elle n'écrive à nouveau à Grimm :
« Je vous dirai en un mot, au lieu de cent, que j'ai un ami qui est très capable et digne de ce nom.
Cet ami était le brillant jeune officier Alexandre Ermolov, représenté par le même irremplaçable Potemkine. Il a déménagé dans les chambres longtemps vides des favoris. L'été de 1785 est l'un des plus joyeux de la vie de Catherine : un plaisir bruyant fait place à un autre. L'impératrice vieillissante ressentit un nouvel élan d'énergie législative. Cette année, deux lettres d'éloges célèbres sont apparues - à la noblesse et aux villes. Ces actes ont complété la réforme de l'administration locale commencée en 1775.
Au début de 1786, Catherine commença à se rafraîchir à Ermolov. La démission de ce dernier est accélérée par le fait qu'il décide d'intriguer contre Potemkine lui-même. En juin, l'impératrice a demandé à dire à son amant qu'elle lui permettrait de partir à l'étranger pendant trois ans.
Le successeur de Yermolov était le capitaine de la garde, âgé de 28 ans, Alexandre Dmitriev-Mamonov, un parent éloigné de Potemkine et de son adjudant. S'étant trompé sur le précédent favori, Potemkine a longuement regardé Mamonov de près avant de le recommander à Catherine. En août 1786, Mamonov fut présenté à l'impératrice et fut bientôt nommé aide de camp. Les contemporains ont noté qu'il ne pouvait pas être appelé beau.
Mamonov se distinguait par sa grande taille et sa force physique, avait un visage aux joues hautes, des yeux légèrement bridés, brillant d'intelligence, et les conversations avec lui donnaient à l'impératrice un plaisir considérable. Un mois plus tard, il devint adjudant des gardes de cavalerie et général de division dans l'armée, et en 1788 il fut accordé aux comtes. Les premiers honneurs n'ont pas fait tourner la tête du nouveau favori - il a fait preuve de retenue, de tact et a acquis une réputation de personne intelligente et prudente. Mamonov parlait bien l'allemand et l'anglais et connaissait parfaitement le français. De plus, il s'est montré comme un bon poète et dramaturge, ce qui a particulièrement séduit Catherine.
Grâce à toutes ces qualités, ainsi qu'au fait que Mamonov étudiait constamment, lisait beaucoup et essayait de se plonger sérieusement dans les affaires de l'État, il devint conseiller de l'impératrice.
Catherine écrit à Grimm :
« Le caftan rouge (comme elle appelait Mamonova) habille une créature au cœur magnifique et à l'âme très sincère. L'esprit à quatre, une gaieté intarissable, beaucoup d'originalité dans la compréhension et la transmission des choses, une excellente éducation, beaucoup de connaissances qui peuvent donner de l'éclat à l'esprit. Nous cachons comme un crime un penchant pour la poésie ; Nous aimons la musique passionnément, nous comprenons tout avec une facilité inhabituelle. Que ne savons-nous pas par cœur ! Nous récitons, bavardons sur le ton meilleure société; d'une politesse exquise; nous écrivons en russe et en français, aussi rarement que quiconque, autant dans le style que dans la beauté de l'écriture. Notre apparence est tout à fait conforme à nos qualités intérieures : nous avons de magnifiques yeux noirs avec des sourcils extrêmement profilés ; taille plus courte que la moyenne, aspect noble, démarche libre; en un mot, nous sommes aussi fiables dans notre âme qu'adroits, forts et brillants à l'extérieur. »
***
Voyage en Crimée
En 1787, Catherine fit l'un de ses voyages les plus longs et les plus célèbres - elle se rendit en Crimée, qui à partir de 17.83 fut annexée à la Russie. A peine Catherine est-elle revenue à Saint-Pétersbourg que la nouvelle éclate de la rupture des relations avec la Turquie et de l'arrestation de l'ambassadeur de Russie à Istanbul : la deuxième guerre turque commence. Pour couronner le tout, la situation des années 60 s'est répétée) lorsqu'une guerre en a entraîné une autre.
À peine rassemblé des forces pour repousser dans le sud, car il est devenu connu que le roi suédois Gustav III a l'intention d'attaquer sans défense Pétersbourg. Le roi vint en Finlande et envoya une demande au vice-chancelier Osterman de rendre à la Suède toutes les terres cédées par les mondes de Nystadt et d'Abov, et de rendre la Crimée au port.
En juillet 1788, la guerre de Suède commença. Potemkine était occupé dans le sud, et toutes les épreuves de la guerre tombaient entièrement sur les épaules de Catherine. Elle faisait partie de tout personnellement. affaires pour la direction du département maritime, ordonna, par exemple, de construire plusieurs nouvelles casernes et hôpitaux, de fixer et de mettre en ordre le port de Revel.
Quelques années plus tard, elle rappelle cette époque dans une lettre à Grimm : « Il y a une raison pour laquelle il semblait que je faisais tout si bien à cette époque : j'étais alors seul, presque sans aides, et, craignant de rater quelque chose par ignorance ou par oubli, je déployais une activité dont personne ne me croyait capable. de; Je suis intervenu dans des détails incroyables à tel point que je suis même devenu quartier-maître de l'armée, mais, comme tout le monde l'admet, les soldats n'ont jamais été mieux nourris dans un pays où il était impossible de se procurer de la nourriture..."
Le traité de Versailles fut conclu le 3 août 1790 ; les frontières des deux États sont restées les mêmes qu'avant la guerre.
Pour ces troubles en 1789, il y eut un autre changement de favoris. En juin, Catherine a appris que Mamonov avait une liaison avec la demoiselle d'honneur Daria Shcherbatovs. L'impératrice a réagi assez calmement à la trahison. Elle a récemment eu 60 ans, d'ailleurs, sa longue expérience des relations amoureuses lui a appris la condescendance. Elle a acheté plusieurs villages pour Mamontov, avec plus de 2 000 paysans, a présenté des bijoux à la mariée et les a fiancés elle-même. Au cours des années de sa faveur, Mamonov a reçu des cadeaux et de l'argent de Catherine pour environ 900 000 roubles. Les cent mille derniers, en plus des trois mille paysans, il les reçut en partant avec sa femme pour Moscou. A cette époque, il pouvait déjà voir son successeur.
Le 20 juin, Ekaterina a choisi le deuxième capitaine des Horse Guards Platon Zubov, âgé de 22 ans, comme favori. En juillet, Thot obtint un colonel et un aide de camp. Au début, l'entourage de l'impératrice ne le prend pas au sérieux.
Bezborodko a écrit à Vorontsov :
« Cet enfant est bien élevé, mais pas d'un esprit distant ; Je ne pense pas qu'il tiendra longtemps à sa place".
Cependant, Bezborodko s'est trompé. Zoubov était destiné à devenir le dernier favori de la grande impératrice - il a conservé son poste jusqu'à sa mort.
Catherine avoua à Potemkine en août de la même année :
« Je suis revenu à la vie comme une mouche après hibernation… Je suis à nouveau heureux et en bonne santé ».
Elle a été touchée par la jeunesse de Zoubov et par le fait qu'il pleurait alors qu'il n'était pas autorisé à entrer dans les appartements de l'impératrice. Malgré son apparence douce, Zubov s'est avéré être un amant calculateur et adroit. Au fil des années, son influence sur l'impératrice devint si grande qu'il parvint à réaliser l'impossible : il mit à néant le charme de Potemkine et l'expulsa complètement du cœur de Catherine. Ayant pris en main tous les fils de la gestion, dans les dernières années de la vie de Catherine, il acquit une énorme influence sur les affaires.
***
La guerre avec la Turquie a continué. En 1790, Souvorov s'empara d'Izmail et Potemkine s'empara de Vendors. Après cela, Porte n'a eu d'autre choix que de concéder. En décembre 1791, la paix est conclue à Iasi. La Russie reçut l'interfluve du Dniestr et du Bug, où Odessa fut bientôt construite ; La Crimée a été reconnue comme sa possession.
Potemkine n'a pas vécu assez longtemps pour voir ce jour joyeux. Il mourut le 5 octobre 1791 sur le chemin de Yassy à Nikolaev. La douleur de Catherine était très grande. Selon le plénipotentiaire français Genet, « à cette nouvelle, elle s'évanouit, le sang lui monta à la tête et elle fut forcée d'ouvrir la veine ». « Qui devrait remplacer une telle personne ? Elle a répété à son secrétaire Khrapovitsky. « Moi et nous tous sommes maintenant comme des escargots qui ont peur de sortir la tête de leur coquille. »
Elle écrit à Grimm :
« Hier, j'ai reçu un coup sur la tête... Mon élève, mon ami, pourrait-on dire, une idole, le prince Potemkine de Tauride est mort... Oh, mon Dieu ! Maintenant, je suis vraiment mon propre assistant. Encore une fois, j'ai besoin de former les gens pour moi-même ! .. "
Le dernier acte remarquable de Catherine fut le partage de la Pologne et l'annexion des terres russes occidentales à la Russie. Les deuxième et troisième sections, qui ont suivi en 1793 et 1795, étaient une suite logique de la première. L'anarchie à long terme et les événements de 1772 ont éclairé de nombreuses noblesses. Le Parti transformationnel à la Diète quadriennale de 1788-1791 a élaboré une nouvelle constitution, adoptée le 3 mai 1791. Elle établit le pouvoir royal héréditaire avec la Diète sans droit de veto, l'admission des députés des citadins, l'égalité complète des dissidents, l'abolition des confédérations. Tout cela s'est produit à la suite de soulèvements antirusses frénétiques et au mépris de tous les accords antérieurs, selon lesquels la Russie garantissait la constitution polonaise. Catherine est forcée d'endurer l'insolence pour le moment, mais écrit aux membres du conseil étranger :
"... Je n'accepterai rien de ce nouvel ordre des choses, quand il a été approuvé, non seulement ils n'ont pas prêté attention à la Russie, mais l'ont comblée d'insultes, l'intimidant à chaque minute..."
En effet, dès que la paix avec la Turquie fut conclue, la Pologne fut occupée par les troupes russes, et une garnison russe fut envoyée à Varsovie. Cela a servi de prologue à la section. En novembre, l'ambassadeur de Prusse à Saint-Pétersbourg, le comte Goltz, a présenté une carte de la Pologne, qui délimitait la zone souhaitée par la Prusse. En décembre, Catherine, après une étude détaillée de la carte, a approuvé la part russe de la section. La majeure partie de la Biélorussie est allée en Russie. Après l'effondrement définitif de la Constitution de mai, ses adhérents, aussi bien à l'étranger que ceux restés à Varsovie, n'avaient qu'un moyen d'agir en faveur de l'entreprise perdue : comploter, susciter le mécontentement et attendre l'occasion de soulever un soulèvement. Tout cela a été fait.
Varsovie allait devenir le centre du spectacle. Le soulèvement bien préparé a commencé tôt le matin du 6 (17 avril) 1794 et a surpris la garnison russe. La plupart des soldats ont été tués et seules quelques unités fortement endommagées ont pu sortir de la ville. Ne faisant pas confiance au roi, les patriotes ont proclamé le général Kosciuszko souverain suprême. En réponse, un troisième accord de partage a été conclu entre l'Autriche, la Prusse et la Russie en septembre. Les voïvodies de Cracovie et de Sendomierz devaient être reprises par l'Autriche. Le Bug et le Neman sont devenus les frontières de la Russie. De plus, la Courlande et la Lituanie s'y replient. Le reste de la Pologne avec Varsovie a été donné à la Prusse. Le 4 novembre, Souvorov prend Varsovie. Le gouvernement révolutionnaire fut détruit et le pouvoir rendu au roi. Stanislav-August a écrit à Catherine :
« Le sort de la Pologne est entre vos mains ; votre pouvoir et votre sagesse le résoudront ; quel que soit le sort que vous me désignerez personnellement, je ne puis oublier mon devoir envers mon peuple, en implorant la magnanimité de Votre Majesté pour lui. »
Catherine a répondu :
"Il n'était pas en mon pouvoir d'empêcher les conséquences désastreuses et de combler l'abîme sous les pieds du peuple polonais, creusé par ses débauchés et dans lequel il est finalement emporté..."
Le 13 octobre 1795, la troisième section est produite ; La Pologne a disparu de la carte de l'Europe. Cette division fut bientôt suivie de la mort de l'impératrice russe. Le déclin de la force morale et physique de Catherine a commencé en 1792. Elle a été brisée à la fois par la mort de Potemkine et par l'extraordinaire tension qu'elle a dû endurer lors de la dernière guerre. L'envoyé français Genet a écrit :
"Catherine vieillit clairement, elle-même le voit, et son âme est saisie de mélancolie."
Catherine se plaignait : « Les années font que tout le monde voit en noir. L'hydropisie accabla l'impératrice. Il lui devenait de plus en plus difficile de marcher. Elle luttait obstinément contre la vieillesse et les maladies, mais en septembre 1796, après que les fiançailles de sa petite-fille avec le roi Gustave IV de Suède n'aient pas eu lieu, Catherine se coucha. Les coliques ne l'ont pas quittée, des plaies se sont ouvertes sur ses jambes. Ce n'est qu'à la fin d'octobre que l'Impératrice se sentit mieux. Le soir du 4 novembre, Catherine a réuni un cercle intime à l'Ermitage, a été très joyeuse toute la soirée et a ri aux blagues de Narychkine. Cependant, elle est partie plus tôt que d'habitude, disant qu'elle avait des coliques de rire. Le lendemain, Catherine se leva à son heure habituelle, causa avec le favori, travailla avec la secrétaire et, après avoir libéré cette dernière, lui ordonna d'attendre dans le couloir. Il a attendu un temps inhabituellement long et a commencé à s'inquiéter. Une demi-heure plus tard, le fidèle Zoubov a décidé de regarder dans la chambre. L'Impératrice n'était pas là ; n'était pas non plus dans les toilettes. Zubov a alerté les gens ; ils coururent aux toilettes et là ils virent l'impératrice immobile, le visage rouge, écumant à la bouche et sifflant avec un râle d'agonie. Catherine a été portée dans la chambre et étendue sur le sol. Elle a résisté à la mort pendant environ un jour et demi, mais n'a jamais repris connaissance et est décédée le matin du 6 novembre.
Elle a été enterrée dans la cathédrale Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg. Ainsi se termina le règne de Catherine II la Grande, l'une des femmes politiques russes les plus célèbres.
Catherine a composé l'épitaphe suivante pour sa future pierre tombale :
Catherine II est enterrée ici. Elle arrive en Russie en 1744 pour épouser Pierre III. A quatorze ans, elle a pris une triple décision : faire plaisir à son mari, Elizabeth et au peuple. Elle n'a rien manqué pour réussir à cet égard. Dix-huit ans d'ennui et de solitude l'ont incitée à lire de nombreux livres. Montée sur le trône de Russie, elle s'est efforcée de donner à ses sujets bonheur, liberté et bien-être matériel. Elle pardonnait facilement et ne détestait personne. Elle était indulgente, aimait la vie, se distinguait par une disposition enjouée, était une vraie républicaine dans ses convictions et avait un cœur bon. Elle avait des amis. Le travail était facile pour elle. Elle aimait les divertissements et les arts laïques.
Médecin sciences historiques M.RAKHMATULLIN.
Au cours des longues décennies de l'ère soviétique, l'histoire du règne de Catherine II a été présentée avec un parti pris évident et l'image de l'impératrice elle-même a été délibérément déformée. Des pages de quelques publications, une princesse allemande rusée et vaniteuse apparaît, s'emparant astucieusement du trône russe et surtout soucieuse de satisfaire ses désirs sensuels. De tels jugements sont fondés soit sur un motif ouvertement politisé, soit sur des souvenirs purement émotionnels de ses contemporains, soit, enfin, sur une intention tendancieuse de ses ennemis (notamment parmi les opposants étrangers), qui ont tenté de discréditer la défense acharnée et constante de l'impératrice de la défense nationale de la Russie. intérêts. Mais Voltaire dans une de ses lettres à Catherine II l'appelait « Semiramis du Nord », assimilant l'héroïne mythologie grecque, dont le nom est associé à la création de l'une des sept merveilles du monde - les jardins suspendus. Ainsi, le grand philosophe a exprimé son admiration pour le travail de l'impératrice pour transformer la Russie, sa sage domination. Dans l'essai proposé, une tentative a été faite de raconter avec un esprit ouvert les affaires et la personnalité de Catherine II. "J'ai assez bien fait ma tâche."
Couronné Catherine II dans toute la splendeur de sa tenue de couronnement. Le couronnement a traditionnellement eu lieu à Moscou le 22 septembre 1762.
L'impératrice Elizaveta Petrovna, qui régna de 1741 à 1761. Portrait du milieu du XVIIIe siècle.
Pierre Ier a épousé sa fille aînée, la princesse héritière Anna Petrovna, au duc de Holstein Karl-Friedrich. Leur fils est devenu l'héritier du trône russe, Peter Fedorovich.
Matushka Catherine II Johann-Elizabeth d'Anhalt-Zerbst, qui secrètement de Russie a tenté d'intriguer en faveur du roi de Prusse.
Le roi de Prusse Frédéric II, que le jeune héritier russe a essayé d'imiter en tout.
Science et Vie // Illustrations
La Grande-Duchesse Ekaterina Alekseevna et le Grand-Duc Peter Fedorovich. Leur mariage a été extrêmement infructueux.
Le comte Grigory Orlov est l'un des organisateurs et exécuteurs actifs du coup d'État du palais, qui a élevé Catherine sur le trône.
La part la plus ardente du coup d'État de juin 1762 fut prise par la très jeune princesse Ekaterina Romanovna Dachkova.
Un portrait de famille d'un couple royal, pris peu après l'accession au trône de Pierre III. A côté de ses parents se trouve le jeune héritier Pavel en costume oriental.
Palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg, où les dignitaires et les nobles ont prêté serment à l'impératrice Catherine II.
La future impératrice russe Catherine II Alekseevna, née Sophia Frederica Augusta, princesse d'Anhaltzerbst, est née le 21 avril (2 mai 1729) dans la province provinciale de Stettin (Prusse) à cette époque. Son père, le banal prince Christian Auguste, fit une belle carrière au service dévoué du roi de Prusse : commandant de régiment, commandant de Stettin, gouverneur. En 1727 (il avait alors 42 ans), il épousa la princesse de Holstein-Gottorp, Johann Elizabeth, âgée de 16 ans.
Une princesse quelque peu excentrique, qui avait une dépendance irrépressible au divertissement et aux voyages à courte distance pour de nombreux et, contrairement à elle, de riches parents, ne faisait pas passer les préoccupations familiales en premier lieu. Parmi les cinq enfants, la fille aînée Fikkhen (c'était le nom de toute la famille Sophia Frederica) n'était pas sa préférée - ils attendaient un fils. "Ma naissance n'a pas été particulièrement bien accueillie", écrira Ekaterina plus tard dans ses Notes. Le parent avide de pouvoir et strict, par désir de "faire tomber la fierté", a souvent récompensé sa fille avec des gifles au visage pour des farces enfantines innocentes et pour la persévérance enfantine de caractère. La petite Fikkhen a trouvé du réconfort auprès de son père de bonne humeur. Constamment engagé dans le service et n'interférant pratiquement pas dans l'éducation des enfants, il est néanmoins devenu pour eux un exemple de service consciencieux dans l'arène de l'État. "Je n'ai jamais rencontré une personne plus honnête - à la fois dans le sens des principes et en termes d'actions -", dira Ekaterina à propos de son père à une époque où elle connaissait déjà bien les gens.
Le manque de ressources matérielles empêchait les parents d'embaucher des enseignants et des gouvernantes expérimentés et coûteux. Et ici, le destin souriait généreusement à Sophia Frederica. Après le changement de plusieurs gouvernantes insouciantes, l'émigrante française Elizabeth Kardel (surnommée Babet) est devenue son bon mentor. Comme Catherine II l'écrira plus tard à son sujet, elle « savait presque tout, sans rien apprendre ; elle connaissait comme sa poche toutes les comédies et tragédies et était très drôle ». La réponse sincère de l'élève dépeint Babet « comme un modèle de vertu et de prudence - elle avait une âme naturellement élevée, un esprit développé, un cœur excellent ; elle était patiente, douce, gaie, juste, constante ».
Peut-être que le principal mérite de l'intelligente Kardel, qui avait un caractère exceptionnellement équilibré, peut être appelé le fait qu'elle a inspiré au début le Fikkhen têtu et secret (le fruit de son éducation précédente) à lire, dans lequel la princesse capricieuse et capricieuse a trouvé vrai plaisir. Une conséquence naturelle de ce passe-temps est l'intérêt naissant d'une jeune fille précoce pour des œuvres sérieuses à contenu philosophique. Ce n'est pas un hasard si déjà en 1744 l'un des amis éclairés de la famille, le comte suédois Güllenborg, en plaisantant, mais non sans raison, appelait Fikchen « un philosophe de quinze ans ». Il est curieux que Catherine II elle-même ait admis que l'acquisition par sa mère de « l'intelligence et de la dignité » a été aidée par la croyance « que j'étais complètement laide », qui a empêché la princesse des divertissements laïques vides. Pendant ce temps, l'un de ses contemporains se souvient : « Elle était parfaitement bâtie, dès l'enfance elle se distinguait par une posture noble et était plus grande que son âge. Son expression n'était pas belle, mais très agréable, et un regard ouvert et un sourire bienveillant la faisaient toute la silhouette est très attrayante."
Cependant, le sort ultérieur de Sofia (comme de nombreuses princesses allemandes ultérieures) n'a pas été déterminé par ses mérites personnels, mais par la situation dynastique en Russie. L'impératrice sans enfant Elizabeth Petrovna immédiatement après l'adhésion a commencé à chercher un héritier digne du trône de Russie. Le choix s'est porté sur le seul successeur direct de la famille de Pierre le Grand, son petit-fils - Karl Peter Ulrich. Le fils de la fille aînée de Pierre le Grand Anna et duc de Holstein-Gottorp Karl Friedrich est devenu orphelin à l'âge de 11 ans. Le prince a été élevé par des professeurs allemands pédants, dirigés par le maréchal chevalier pathologiquement cruel, le comte Otto von Brummer. Le fils du duc, qui était maladif de naissance, était parfois tenu au corps à corps, et pour tout acte répréhensible, ils étaient obligés de s'agenouiller sur des petits pois pendant des heures, souvent et douloureusement fouettés. "Je vais ordonner que vous soyez fouetté", a crié Brummer, "que les chiens lèchent le sang." Le garçon a trouvé un exutoire dans sa passion pour la musique, accro à un violon au son pitoyable. Son autre passion était de jouer avec les soldats de plomb.
Les humiliations auxquelles il était soumis au jour le jour portaient leurs fruits : le prince, comme le notent ses contemporains, devint « colérique, faux, aimait à se vanter, apprit à mentir ». Il a grandi pour être un homme lâche, secret, capricieux sans mesure et a beaucoup pensé à lui-même. Voici un portrait laconique de Peter Ulrich, peint par notre brillant historien V.O. Klyuchevsky : "Sa façon de penser et d'agir donnait l'impression de quelque chose d'étonnant à moitié réfléchi et inachevé. Il ressemblait à un enfant s'imaginant être un adulte; en fait , c'était un adulte, pour toujours un enfant."
Un tel "digne" héritier du trône de Russie en janvier 1742 a été amené à la hâte (afin de ne pas être intercepté par les Suédois, dont il pourrait également devenir le roi, par son ascendance), à Saint-Pétersbourg. En novembre de la même année, le prince se convertit à l'orthodoxie contre son gré et se nomme Peter Fedorovich. Mais dans son cœur, il est toujours resté un fervent luthérien allemand qui ne montrait aucun désir de maîtriser la langue de sa nouvelle patrie avec la moindre tolérance. De plus, l'héritier n'a pas eu de chance avec ses études et son éducation à Saint-Pétersbourg. Son principal mentor, l'académicien Yakov Shtelin, manquait complètement de talents pédagogiques et, voyant l'incroyable incapacité et l'indifférence de l'étudiant, il a choisi de plaire aux caprices constants d'un stupide et de ne pas lui enseigner correctement.
Pendant ce temps, Pyotr Fedorovich, 14 ans, a déjà trouvé une épouse. Quel a été le facteur décisif dans le choix de la princesse Sophie par la cour russe ? La résidente saxonne Pezold a écrit à ce sujet : étant, bien que « d'une noblesse, mais d'une si petite famille », elle sera une épouse obéissante sans aucune prétention à participer à la grande politique. Les souvenirs élégiaques d'Elizaveta Petrovna sur son mariage raté avec le frère aîné de sa mère, Sophia, Karl August (peu avant le mariage, il est mort de la variole), et les portraits de la jolie princesse livrés à l'impératrice, qui même alors "aimait tout le monde à première vue, y a joué un rôle. » (donc sans fausse modestie Catherine II écrira dans ses « Notes »).
Fin 1743, la princesse Sophie est invitée (avec de l'argent russe) à Saint-Pétersbourg, où elle arrive accompagnée de sa mère en février de l'année suivante. De là, ils se rendirent à Moscou, où se trouvait à l'époque la cour royale, et à la veille de l'anniversaire (9 février) de Peter Fedorovich, une mariée très jolie et habillée (pour le même prix) comparut devant l'impératrice et le grand-duc. J. Shtelin écrit sur la joie sincère d'Elizaveta Petrovna à la vue de Sophia. Et la beauté mature, le devenir et la grandeur de la tsarine russe ont fait une impression indélébile sur la jeune princesse provinciale. Comme s'ils s'aimaient et s'aimaient les fiancés. En tout cas, la mère de la future mariée a écrit à son mari que "le Grand-Duc l'aime". Fikkhen elle-même évaluait de plus en plus sobrement : « À vrai dire, j'aimais plus la couronne russe que lui (le marié. - MONSIEUR.) personne ".
En effet, l'idylle, même si elle est née au début, n'a pas duré longtemps. Une communication ultérieure entre le grand-duc et la princesse a montré une complète dissemblance des caractères et des intérêts, et extérieurement ils étaient étonnamment différents les uns des autres: le marié dégingandé, aux épaules étroites et frêle a perdu encore plus dans le contexte d'une mariée exceptionnellement attrayante. Lorsque le grand-duc souffrit de la variole, son visage était tellement défiguré par de nouvelles cicatrices que Sofia, voyant l'héritier, ne put se retenir et fut franchement horrifiée. Cependant, l'essentiel était différent: l'infantilisme étonnant de Piotr Fedorovich était opposé à la nature active, déterminée et ambitieuse de la princesse Sophia Frederica, qui connaît sa valeur, qui a été nommée en Russie en l'honneur de la mère de l'impératrice Elizabeth, Ekaterina ( Alekseevna). Cela s'est produit avec son adoption de l'orthodoxie le 28 juin 1744. L'impératrice a offert au nouveau converti des cadeaux nobles - un bouton de manchette en diamant et un collier d'une valeur de 150 000 roubles. Le lendemain, les fiançailles officielles ont eu lieu, qui ont valu à Catherine les titres de grande-duchesse et d'altesse impériale.
Évaluer plus tard la situation qui s'est présentée au printemps 1744, lorsque l'impératrice Elizabeth, ayant appris les tentatives frivoles de l'intrigante mère Sophie, la princesse Johannes Elizabeth, d'agir (secrètement de la cour russe) dans l'intérêt du roi de Prusse Frédéric II , faillit la renvoyer, elle et sa fille, « chez lui » (ce dont le marié, avec quelle sensibilité la mariée, peut-être, se serait réjoui), Catherine exprima ses sentiments comme suit : « Il m'était presque indifférent, mais le Russe couronne ne m'était pas indifférent.
Le 21 août 1745, une cérémonie de mariage de dix jours commença. Bals luxuriants, mascarades, feux d'artifice, une mer de vin et des montagnes de friandises pour gens ordinaires sur la place Admiralteyskaya à Saint-Pétersbourg a dépassé toutes les attentes. Cependant, la vie de famille des jeunes mariés a commencé par des déceptions. Comme Catherine l'écrit elle-même, son mari, qui a dîné copieusement ce soir-là, « s'est allongé à côté de moi, s'est assoupi et a dormi en toute sécurité jusqu'au matin ». Et ainsi de suite, de nuit en nuit, de mois en mois, d'année en année. Piotr Fiodorovitch, comme avant le mariage, jouait avec altruisme avec des poupées, dressait (ou plutôt torturait) une meute de ses chiens, organisait des revues quotidiennes pour une compagnie comique de messieurs de la cour de son âge, et la nuit avec passion enseignait à sa femme " exercice", l'amenant à l'épuisement complet. C'est alors qu'il découvre pour la première fois une dépendance excessive au vin et au tabac.
Il n'est pas surprenant que Catherine ait commencé à ressentir du dégoût physique pour son mari nominal, trouvant du réconfort dans la lecture d'une grande variété de livres sérieux et dans l'équitation (elle passait à cheval jusqu'à 13 heures par jour). Les célèbres Annales de Tacite ont eu une forte influence sur la formation de sa personnalité, comme elle l'a rappelé, et le dernier ouvrage de l'éclaireur français Charles Louis Montesquieu, Sur l'esprit des lois, est devenu son livre de référence. Elle est absorbée par l'étude des travaux des encyclopédistes français et déjà à cette époque intellectuellement elle était trop grande pour tout le monde autour d'elle.
Pendant ce temps, l'impératrice vieillissante Elizaveta Petrovna attendait l'héritier et qu'il ne se soit pas présenté, elle a blâmé Catherine. Finalement, l'impératrice, à l'instigation de ses confidents, fit procéder à un examen médical des époux, dont nous apprenons les résultats des rapports de diplomates étrangers : " grand Ducétait incapable d'avoir des enfants de l'obstacle enlevé chez les peuples de l'Est par la circoncision, mais qu'il considérait comme incurable. "La nouvelle de cela a plongé Elizaveta Petrovna en état de choc." Frappée par cette nouvelle, comme un coup de tonnerre ", écrit l'un des témoins oculaires « Elisabeth parut sans voix, pendant longtemps je n'ai pas pu prononcer un mot, enfin, j'ai sangloté. »
Cependant, les larmes n'empêchèrent pas l'impératrice d'accepter une opération immédiate, et en cas d'échec, elle ordonna de trouver un « gentleman » approprié pour le rôle du père de l'enfant à naître. C'était "le beau Serge", le chambellan de 26 ans Sergei Vasilyevich Saltykov. Après deux fausses couches (en 1752 et 1753) le 20 septembre 1754, Catherine donne naissance à l'héritier du trône, nommé Pavel Petrovitch. Certes, les mauvaises langues à la cour disaient presque à haute voix que l'enfant aurait dû s'appeler Sergeevich. Doutant de sa paternité, et à ce moment-là il s'était débarrassé de sa maladie en toute sécurité, Piotr Fedorovich : "Dieu sait d'où ma femme tire sa grossesse, je ne sais pas vraiment s'il s'agit de mon enfant et dois-je le prendre personnellement ? "
Pendant ce temps, le temps a montré l'inanité des soupçons. Pavel a hérité non seulement des caractéristiques spécifiques de l'apparence de Peter Fedorovich, mais, plus important encore, des caractéristiques de son personnage - notamment l'instabilité mentale, l'irritabilité, une tendance aux actions imprévisibles et un amour irrépressible pour l'exercice insensé des soldats.
L'héritier, immédiatement après sa naissance, a été excommunié de sa mère et placé sous la surveillance de nounous, et Sergei Saltykov a été envoyé par Catherine, qui était amoureuse de lui, en Suède pour une mission diplomatique inventée. Quant au couple grand-ducal, Elizaveta Petrovna, ayant reçu l'héritier tant attendu, a perdu son intérêt antérieur pour elle. À cause de ses tours insupportables* et de ses bouffonneries insensées, elle ne pouvait pas rester avec son neveu « même un quart d'heure pour ne pas ressentir de dégoût, de colère ou de chagrin ». Par exemple, il a percé des trous dans le mur de la pièce où la tante-impératrice a reçu le favori Alexei Razumovsky, et a non seulement regardé ce qui s'y passait, mais a également invité des "amis" de son entourage à regarder à travers le judas. On peut imaginer la puissance de la colère d'Elizaveta Petrovna lorsqu'elle a découvert le truc. Désormais, la tante-impératrice le traite souvent d'idiot, de monstre et même de "maudit neveu" dans son cœur. Dans une telle situation, Ekaterina Alekseevna, qui a assuré l'héritier du trône, pourrait réfléchir calmement à son destin futur.
Le 30 août 1756, la grande-duchesse de vingt ans informe l'ambassadeur d'Angleterre en Russie, Sir Charles Herbert Williams, avec qui elle entretient une correspondance secrète, qu'elle a décidé de « périr ou de régner ». Les attitudes de vie de la jeune Catherine en Russie sont simples : plaire au Grand-Duc, plaire à l'Impératrice, plaire au peuple. Rappelant cette époque, elle écrit : « Vraiment, je n'ai rien négligé pour y parvenir : obséquiosité, obéissance, respect, désir de plaire, désir de faire ce qui doit être fait, affection sincère - tout de ma part a été constamment utilisé de 1744 à 1761. J'avoue que lorsque j'ai perdu l'espoir de réussir dans le premier paragraphe, j'ai redoublé d'efforts pour terminer les deux derniers ; il m'a semblé que j'ai fait plus d'une fois dans le second, mais le troisième a été pour moi une réussite dans tout son volume, sans aucune limitation de temps, et donc je pense que j'ai assez bien fait ma tâche.
Les méthodes d'acquisition de «la procuration des Russes» par Catherine ne contenaient rien d'original et, dans leur simplicité, correspondaient parfaitement à l'attitude mentale et au niveau d'illumination de la haute société de Saint-Pétersbourg. Écoutons-la elle-même : « Ils attribuent cela à un esprit profond et à une longue étude de ma position. Pas du tout ! Je le dois aux vieilles femmes russes.<...>Et dans les réunions solennelles, et lors de simples rassemblements et fêtes, j'ai approché les vieilles femmes, je me suis assis à côté d'elles, je les ai interrogées sur leur santé, leur ai conseillé les remèdes à utiliser en cas de maladie, j'ai patiemment écouté leurs histoires sans fin sur leur jeunes années, sur l'ennui actuel, sur la frivolité des jeunes ; elle-même leur demandait conseil sur diverses questions et les remerciait ensuite sincèrement. Je connaissais le nom de leurs mosek, lapdogs, perroquets, idiots ; savait quand laquelle de ces dames avait un anniversaire. Ce jour-là, mon valet est venu la voir, l'a félicitée de ma part et a apporté des fleurs et des fruits des serres d'Oranienbaum. Moins de deux ans plus tard, les louanges les plus chaleureuses adressées à mon esprit et à mon cœur ont été entendues de toutes parts et se sont répandues dans toute la Russie. De la manière la plus simple et la plus innocente, je me suis fait une gloire retentissante, et lorsqu'il s'est agi d'occuper le trône de Russie, une importante majorité s'est retrouvée à mes côtés."
Le 25 décembre 1761, après une longue maladie, l'impératrice Elizabeth Petrovna est décédée. Le sénateur Troubetskoy, qui a annoncé cette nouvelle tant attendue, a immédiatement proclamé l'accession au trône de l'empereur Pierre III. Comme l'écrit le remarquable historien S.M. Soloviev, « la réponse était des sanglots et des gémissements pour tout le palais<...>La majorité saluait sombrement le nouveau règne : ils connaissaient le caractère du nouveau souverain et n'attendaient rien de bon de lui. événements.
C'était peut-être mieux pour elle - pendant les six mois de son règne, Pierre III a réussi à retourner contre lui la société de la capitale et la noblesse dans son ensemble à tel point qu'il a pratiquement ouvert la voie à sa femme au pouvoir. D'ailleurs, l'attitude à son égard n'a pas été modifiée non plus par l'abolition de la Chancellerie Secrète détestée avec ses cachots remplis de prisonniers au cri infâme : « La parole et l'acte du souverain ! lieu de résidence, de travail et le droit de voyager à l'étranger. Le dernier acte suscita un tel enthousiasme dans la noblesse que le Sénat entreprit même d'ériger un monument d'or pur au tsar bienfaiteur. Cependant, l'euphorie n'a pas duré longtemps - tout l'a emporté sur les actions extrêmement impopulaires de l'empereur dans la société, qui ont gravement porté atteinte à la dignité nationale du peuple russe.
L'adoration du roi de Prusse Frédéric II, délibérément annoncée par Pierre III, a fait l'objet d'une condamnation furieuse. Il s'est proclamé haut et fort son vassal, pour lequel il a reçu le surnom de "Frédéric le singe" parmi le peuple. Le degré de mécontentement public augmenta particulièrement lorsque Pierre III fit la paix avec la Prusse et lui rendit les terres gagnées par le sang des soldats russes sans aucune compensation. Cette étape a pratiquement annulé tous les succès de la guerre de Sept Ans pour la Russie.
Pierre III a pu retourner le clergé contre lui-même, car, selon son décret du 21 mars 1762, ils ont commencé à mettre en œuvre à la hâte la décision prise même sous Elizabeth Petrovna de séculariser les terres de l'église : le trésor, dévasté par une guerre de longue durée , a demandé un réapprovisionnement. De plus, le nouveau tsar menaça de priver le clergé de ses magnifiques vêtements habituels, de les remplacer par des robes de bureau noires, et de raser la barbe des prêtres.
La dépendance au vin n'ajouta pas de gloire au nouvel empereur. Il n'est pas passé inaperçu à quel point il s'est comporté d'une manière extrêmement cynique à l'époque des adieux lugubres de l'impératrice décédée, autorisant des bouffonneries obscènes, des blagues, des rires bruyants de son cercueil ... Selon les contemporains, Pierre III n'avait pas ces jours "un ennemi que lui-même, car il ne néglige rien qui pourrait lui nuire. » Ceci est confirmé par Catherine : son mari « dans tout l'empire n'avait pas d'ennemi plus farouche que lui ». Comme vous pouvez le voir, Pierre III a soigneusement préparé le terrain pour le coup d'État.
Il est difficile de dire exactement quand les contours concrets du complot ont émergé. Avec un degré élevé de probabilité, son apparition peut être attribuée à avril 1762, lorsque Catherine, après avoir accouché, a reçu l'opportunité physique d'une action réelle. La décision finale sur le complot, apparemment, a été confirmée après le scandale familial qui s'est produit début juin. Lors de l'un des dîners solennels, Pierre III, en présence d'ambassadeurs étrangers et d'environ 500 invités, a publiquement qualifié sa femme d'imbécile plusieurs fois de suite. Ensuite, l'adjudant a reçu l'ordre d'arrêter sa femme. Et seule la persuasion persistante du prince George Ludwig Holstein (il était l'oncle du couple impérial) a éteint le conflit. Mais ils n'ont en aucun cas changé l'intention de Pierre III de se débarrasser de sa femme et de réaliser son désir de longue date - épouser sa préférée, Elizaveta Romanovna Vorontsova. Selon les opinions de personnes proches de Peter, elle « jura comme un soldat, tondait, sentait le mal et crachait en parlant ». Grêlée, grosse, avec un buste exorbitant, elle était exactement le genre de femme qui aimait Piotr Fedorovich, qui appelait bruyamment sa petite amie "Romanov" en buvant. Catherine a été menacée d'une tonsure imminente en tant que religieuse.
Il n'y avait plus de temps pour organiser une conspiration classique avec une longue préparation et une réflexion approfondie sur tous les détails. Tout s'est décidé selon la situation, presque au niveau de l'improvisation, cependant, compensée par les actions décisives des partisans d'Ekaterina Alekseevna. Parmi eux se trouvait son admirateur secret, l'hetman ukrainien K. G. Razumovsky, en même temps le commandant du régiment Izmailovsky, un favori des gardes. Une sympathie explicite lui a été témoignée ainsi qu'à ses proches de Peter III, du procureur en chef A.I. Glebov, du général Feldzheikhmeister A.N. Vilboa, du directeur de la police, le baron N.A. La princesse E.R. Dashkova, âgée de 18 ans (la préférée de Pierre III était sa sœur), qui avait de nombreuses relations dans le monde en raison de sa proximité avec le chancelier de N.I. MI Vorontsov était son oncle.
C'est par l'intermédiaire de la sœur du favori, qui n'a éveillé aucun soupçon, que les officiers du régiment Preobrazhensky - P. B. Passek, S. A. Bredikhin, les frères Alexander et Nikolai Roslavlev, ont été attirés pour participer au coup d'État. Par d'autres canaux fiables, des contacts ont été établis avec d'autres jeunes officiers énergiques de la garde. Tous ont ouvert la voie à Catherine un chemin relativement facile vers le trône. Parmi eux, le plus actif et actif - "qui se démarquait de la foule des camarades par la beauté, la force, le courage, la sociabilité", Grigory Grigorievich Orlov, 27 ans (qui était amoureux de Catherine depuis longtemps - le garçon qui lui est né en avril 1762 était leur fils Alexei). Catherine préférée dans tout était soutenue par deux de ses frères-gardes courageux - Alexei et Fyodor. Ce sont les trois frères Orlov qui sont en fait le moteur du complot.
Dans les Horse Guards, "tout était dirigé prudemment, hardiment et activement" la future favorite de Catherine II, le sous-officier G.A. Potemkin de 22 ans et son pair F.A. Khitrovo. À la fin du mois de juin, selon Catherine, ses "complices" dans la garde étaient jusqu'à 40 officiers et environ 10 000 soldats. L'un des principaux inspirateurs du complot était le tuteur du tsarévitch Pavel N.I. Panin. Certes, il poursuivait des objectifs différents de ceux de Catherine : la destitution de Piotr Fedorovich du pouvoir et l'établissement d'une régence sous la direction de son élève, le jeune tsar Pavel Petrovich. Catherine le sait et, bien qu'un tel plan soit absolument inacceptable pour elle, elle, ne voulant pas diviser ses forces, en discutant avec Panin, se cantonne à la phrase non contraignante : « Il est plus agréable pour moi d'être un mère que la femme du souverain."
Le hasard rapprocha la chute de Pierre III : la décision imprudente de déclencher une guerre avec le Danemark (avec un trésor complètement vide) et de commander lui-même les troupes, bien que l'incapacité de l'empereur à s'engager dans des affaires militaires fût le sujet de conversation de la ville. Ses intérêts ici se limitaient à l'amour des uniformes colorés, à l'exercice sans fin et à l'assimilation des manières brutales des soldats, qu'il considérait comme un indicateur de masculinité. Même le conseil insistant de son idole Frédéric II - de ne pas se rendre sur le théâtre des opérations militaires avant le couronnement - n'a eu aucun effet sur Pierre. Et maintenant, la garde, gâtée sous l'impératrice Elizabeth Petrovna par la vie libre de la capitale, et maintenant au gré du tsar, vêtue des uniformes détestés du modèle prussien, reçoit l'ordre de se préparer d'urgence pour une campagne qui n'a pas à répondent tous aux intérêts de la Russie.
Le signal immédiat du début des actions des conspirateurs fut l'arrestation accidentelle dans la soirée du 27 juin de l'un des conspirateurs, le capitaine Passek. Le danger était grand. Alexei Orlov et le lieutenant des gardes Vasily Bibikov dans la nuit du 28 juin se sont précipités au galop vers Peterhof, où se trouvait Catherine. Les frères Grégoire et Fiodor qui sont restés à Saint-Pétersbourg ont tout préparé pour une rencontre « royale » appropriée pour elle dans la capitale. À six heures du matin le 28 juin, Alexei Orlov a réveillé Catherine avec les mots : « Il est temps de se lever : tout est prêt pour votre proclamation. "Comme quoi?" - dit Catherine endormie. « Passek a été arrêté », répondit A. Orlov.
Et maintenant que les hésitations étaient écartées, Catherine avec la femme de chambre d'honneur monta dans la voiture où arriva Orlov. V.I.Bibikov et le caméra-laquais Shkurin sont logés sur les talons, Alexei Orlov est sur le box à côté du cocher. Grigory Orlov les rencontre cinq milles avant la capitale. Catherine est transférée dans sa voiture avec des chevaux frais. Devant la caserne du régiment Izmailovsky, les gardes prêtent avec enthousiasme le serment d'allégeance à la nouvelle impératrice. Ensuite, la voiture avec Catherine et une foule de soldats, dirigée par un prêtre avec une croix, se dirigent vers le régiment Semyonovsky, qui a rencontré Catherine avec un tonnerre "Hurray!" Accompagnée des troupes, elle se rend à la cathédrale de Kazan, où commence immédiatement un service de prière et aux litanies "l'impératrice autocratique Ekaterina Alekseevna et l'héritier du grand-duc Pavel Petrovitch ont été proclamés". De la cathédrale, Catherine, déjà impératrice, part pour le Palais d'Hiver. Ici, les deux régiments de la garde ont été rejoints par les gardes du régiment Preobrazhensky, qui étaient un peu en retard et terriblement bouleversés par cela. Vers midi, les unités de l'armée sont arrivées.
Pendant ce temps, les membres du Sénat et du Synode, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires de l'État se pressent déjà au Palais d'Hiver. Ils prêtèrent sans délai le serment à l'impératrice selon le texte rédigé à la hâte par la future secrétaire d'État de Catherine II G.N. Teplov. Le Manifeste sur l'accession au trône de Catherine « à la demande de tous nos sujets » fut également promulgué. Les habitants de la capitale du nord jubilent, le vin des caves des cavistes privés coule comme une rivière aux frais de l'État. Ivre à chaud, les gens du commun se réjouissent de bon cœur et attendent les bénédictions de la nouvelle reine. Mais elle n'a pas encore le temps pour eux. Aux exclamations de « Hourra ! la campagne danoise a été annulée. Pour attirer la flotte à ses côtés, un homme fiable a été envoyé à Kronstadt - l'amiral I. L. Talyzin. Les décrets sur le changement de pouvoir ont été prudemment envoyés à la partie de l'armée russe située en Poméranie.
Et qu'en est-il de Pierre III ? Se doutait-il de la menace d'un coup d'État et de ce qui se passait dans son entourage le jour malheureux du 28 juin ? Les preuves documentaires survivantes montrent sans équivoque qu'il n'a même pas pensé à la possibilité d'un coup d'État, confiant dans l'amour de ses sujets. D'où son mépris pour les avertissements reçus précédemment, bien que vagues.
Après s'être assis pour un dîner tardif la veille, Peter arrive à Peterhof le 28 juin à midi pour célébrer ses prochains jours de fête. Et il découvre que Catherine n'est pas à Monplaisir - elle est partie à l'improviste pour Saint-Pétersbourg. Des messagers ont été envoyés d'urgence dans la ville - N. Yu. Trubetskoy et A. I. Shuvalov (l'un - le colonel Semenovsky, l'autre - le régiment Preobrazhensky). Cependant, ni l'un ni l'autre n'est revenu, sans hésiter prêter allégeance à Catherine. Mais la disparition des messagers n'a pas donné de décision à Pierre, qui dès le début a été moralement écrasé par le désespoir complet, à son avis, de la situation. Finalement, il fut décidé de déménager à Cronstadt : selon le rapport du commandant de la forteresse P.A.Devier, ils étaient soi-disant prêts à recevoir l'empereur. Mais tandis que Pierre et son peuple naviguaient vers Cronstadt, Talyzine y était déjà arrivé et, à la joie de la garnison, a conduit tout le monde à un serment d'allégeance à l'impératrice Catherine II. Par conséquent, la flottille de l'empereur déchu (une galère et un yacht) qui s'est approchée de la forteresse dans la première heure de la nuit a dû rebrousser chemin vers Oranienbaum. Pierre n'a pas accepté le conseil du vieux comte B. Kh. Minikh, revenu d'exil, d'agir « comme un roi », sans hésiter pendant une heure, d'aller rejoindre les troupes à Revel et de se déplacer avec elles à Saint-Pétersbourg. Pétersbourg.
Pendant ce temps, Catherine démontre une fois de plus sa détermination, ordonnant de tirer jusqu'à Peterhof jusqu'à 14 000 soldats avec de l'artillerie. La tâche des conspirateurs qui se sont emparés du trône est complexe et en même temps simple : obtenir une abdication "volontaire" décente de Pierre du trône. Et le 29 juin, le général M.L. Izmailov remet à Catherine un pitoyable message de Pierre III lui demandant pardon et renonçant à ses droits au trône. Il a également exprimé sa volonté (si autorisé), avec E.R. Vorontsova, l'adjudant A.V. Gudovich, un violon et son carlin bien-aimé, d'aller vivre à Holstein, si seulement il lui était alloué une pension suffisante pour une existence confortable. De Pierre a demandé "un certificat écrit et manuscrit" de renonciation au trône "volontairement et naturellement". Pierre accepta tout et par écrit docilement déclaré "solennellement au monde entier": "Je renonce au gouvernement de l'État russe pour tout mon siècle."
À midi, Peter a été arrêté, emmené à Peterhof, puis transféré à Ropsha - un petit palais de campagne à 27 miles de Petersburg. Ici, il a été placé "sous une forte garde" jusqu'à ce que les locaux de Shlisselburg soient prêts. Alexei Orlov a été nommé le principal "gardien". Ainsi, tout le coup, qui n'a pas fait couler une seule goutte de sang, a duré moins de deux jours - les 28 et 29 juin. Frédéric II plus tard, dans une conversation avec l'envoyé français à Saint-Pétersbourg, le comte L.-F. Ségur a fait le bilan suivant des événements en Russie : « Le manque de courage de Pierre III l'a ruiné : il s'est laissé renverser comme un enfant endormi".
Dans cette situation, l'élimination physique de Peter était la solution la plus sûre et la plus simple au problème. Comme commandé, c'est exactement ce qui s'est passé. Le septième jour après le coup d'État, dans des circonstances encore mal élucidées, Pierre III fut tué. Il a été officiellement annoncé au peuple que Piotr Fedorovich est mort de coliques hémorroïdaires, survenues "par la volonté de la Providence divine".
Naturellement, les contemporains, comme les historiens ultérieurs, s'intéressaient ardemment à la question de l'implication de Catherine dans cette tragédie. Il existe différentes opinions sur cette question, mais elles sont toutes basées sur des suppositions et des hypothèses, et il n'y a tout simplement aucun fait qui incrimine Catherine dans ce crime. Apparemment, l'envoyé français Béranger avait raison quand, dans la foulée des événements, il écrivit : « Je ne soupçonne pas une âme si terrible dans cette princesse pour penser qu'elle a participé à la mort du roi, mais depuis le plus profond sera probablement toujours caché de informations générales le véritable auteur de ce terrible meurtre, les soupçons et la bassesse resteront avec l'Impératrice."
AI Herzen parla plus clairement : « Il est très probable que Catherine n'ait pas donné l'ordre de tuer Pierre III. Nous savons par Shakespeare comment ces ordres sont donnés - avec un regard, un indice, un silence. Il est important de noter ici que tous les participants au "accidentel" (comme A. Orlov l'a expliqué dans sa note de pénitence à l'Impératrice) les meurtres de l'empereur déchu non seulement n'ont subi aucune punition, mais ont ensuite été superbement récompensés par de l'argent. et serfs. Ainsi, Catherine, volontairement ou non, a pris sur elle ce grave péché. C'est peut-être pourquoi l'impératrice n'a pas montré moins de pitié à l'égard de ses ennemis récents: pratiquement aucun d'entre eux n'a été non seulement envoyé en exil selon la tradition russe établie, mais n'a pas été puni du tout. Même les mètres de Peter, Elizaveta Vorontsova, ont été discrètement amenés dans la maison de son père. De plus, plus tard, Catherine II est devenue la marraine de son premier enfant. La vraie générosité et le pardon sont les armes fidèles des forts, leur apportant toujours gloire et loyaux admirateurs.
Le 6 juillet 1762, le Manifeste sur l'accession au trône, signé par Catherine, est proclamé au Sénat. Le 22 septembre, un couronnement solennel a eu lieu à Moscou, qui l'a accueillie froidement. C'est ainsi que commença le règne de 34 ans de Catherine II.
Venant caractériser le long règne de Catherine II et sa personnalité, remarquons un fait paradoxal : l'illégalité de l'accession au trône de Catherine avait ses avantages incontestables, surtout dans les premières années de son règne, lorsqu'elle « dut racheter avec un travail acharné, de grands services et des dons. que les rois légitimes n'ont aucune difficulté. Cette même nécessité était en partie le ressort de ses grands et brillants actes. " Ce n'était pas seulement l'opinion du célèbre écrivain et mémorialiste N.I. Grech, qui détient le jugement ci-dessus. Dans ce cas, il ne reflétait que l'opinion de la partie instruite de la société. VO Klyuchevsky, parlant des tâches auxquelles était confrontée Catherine, qui a pris et n'a pas reçu le pouvoir par la loi, et notant l'extrême complexité de la situation en Russie après le coup d'État, a souligné le même point : « Le pouvoir saisi a toujours le caractère d'un projet de loi. d'échange, selon laquelle en attente de paiement, et selon l'humeur de la société russe, Catherine devait justifier des attentes diverses et dissidentes. » Pour l'avenir, nous dirons que ce billet à ordre a été remboursé par elle à temps.
La littérature historique a longtemps relevé la principale contradiction du « Siècle des Lumières » de Catherine (mais pas partagée par tous les spécialistes) : l'Impératrice « voulait tant de lumières et de lumière pour ne pas avoir peur de sa « conséquence inévitable ». , Catherine II était confrontée à un dilemme explosif : illumination ou esclavage ? Et comme elle n'a jamais résolu ce problème, laissant le servage intact, cela a semblé susciter une nouvelle perplexité quant à la raison pour laquelle elle ne l'a pas fait. Mais la formule ci-dessus ("illumination - esclavage") pose des questions naturelles : y avait-il à cette époque en Russie les conditions appropriées pour l'abolition de « l'esclavage » et si la société d'alors réalisait la nécessité changement radical relations sociales dans le pays ? Essayons d'y répondre.
Déterminer le cours de sa politique intérieure, Catherine s'est appuyée principalement sur la connaissance du livre qu'elle avait acquise. Mais pas seulement. Dans un premier temps, l'ardeur transformatrice de l'impératrice a été alimentée par son évaluation initiale de la Russie comme un « pays non labouré » où il serait préférable de mener toutes sortes de réformes. C'est pourquoi le 8 août 1762, juste la sixième semaine de son règne, Catherine II, par un décret spécial, confirma le décret de mars de Pierre III interdisant l'achat de serfs par les industriels. Les propriétaires d'usines et de mines doivent désormais se contenter du travail des ouvriers civils, payés en vertu du contrat. Il semble qu'elle ait généralement eu l'intention d'abolir le travail forcé et de le faire pour débarrasser le pays de la « honte de l'esclavage », comme l'exige l'esprit des enseignements de Montesquieu. Mais cette intention n'est pas encore assez forte pour qu'elle décide d'une telle démarche révolutionnaire. De plus, Catherine n'avait pas encore une compréhension complète de la réalité russe. D'autre part, comme l'a noté l'une des personnes les plus intelligentes de l'ère Pouchkine, le prince PA Vyazemsky, lorsque les actes de Catherine II n'étaient pas encore devenus une « tradition profonde », elle « aimait les réformes, mais les transformations progressives, mais pas brusque", sans casser.
Vers 1765, Catherine II en vient à l'idée de la nécessité de convoquer la Commission législative pour mettre "en meilleur ordre" la législation existante et afin de connaître de manière fiable "les besoins et les lacunes sensibles de notre peuple". Rappelons que des tentatives de convocation de l'organe législatif actuel - la Commission législative - ont été entreprises plus d'une fois auparavant, mais toutes, pour diverses raisons, se sont soldées par un échec. Tenant compte de cela, Catherine, dotée d'un esprit remarquable, a recouru à un acte sans précédent dans l'histoire de la Russie : elle a personnellement rédigé un "Ordre" spécial, qui est un programme détaillé d'actions de la Commission.
Comme il ressort d'une lettre à Voltaire, elle croyait que le peuple russe est « un excellent sol sur lequel une bonne graine pousse rapidement ; mais nous avons aussi besoin d'axiomes qui sont indéniablement reconnus comme vrais ». Et ces axiomes sont bien connus - les idées des Lumières, qui ont servi de base à la nouvelle législation russe. Même V.O. Klyuchevsky a spécialement souligné la condition principale de la mise en œuvre des plans de transformation de Catherine, qu'elle a résumés dans son "Instruction": "La Russie est une puissance européenne; Pierre Ier, introduisant les coutumes européennes et je ne m'y attendais pas moi-même. La conclusion suivie par lui-même : les axiomes, qui sont le dernier et le meilleur fruit de la pensée européenne, trouveront le même réconfort dans ce peuple. »
Depuis longtemps dans la littérature sur l'« Ordre », il y a eu une opinion sur la nature purement compilation de l'œuvre politique principale de Catherine. Justifiant de tels jugements, ils se réfèrent généralement à ses propres paroles prononcées au philosophe et éclaireur français D " Alambert : " Vous verrez comment j'ai volé le président Montesquieu au profit de mon empire, sans le nommer. " Divisé en 20 chapitres, 294 aller retour aux travaux du célèbre éducateur français Montesquieu "Sur l'esprit des lois", et 108 - aux travaux du juriste italien Cesare Beccaria "Sur les crimes et les châtiments". Une simple traduction en russe des œuvres d'auteurs éminents, et leur refonte créative, une tentative d'appliquer les idées qui leur sont inhérentes à la réalité russe.
(À suivre.)
Sans exagération, l'impératrice russe la plus influente et la plus célèbre est Catherine II. De 1762 à 1796, elle a dirigé un puissant empire - grâce à ses efforts, le pays a prospéré. Je me demande quelle a été la vie personnelle de Catherine la Grande ? Découvrons-le.
La future impératrice de Russie est née le 21 avril 1729 en Prusse. A sa naissance, elle a reçu le nom de Sophia Frederica Auguste. Son père était le prince de la ville de Stettin, dans laquelle l'impératrice est née.
Malheureusement, les parents n'ont pas prêté beaucoup d'attention à la fille. Ils aimaient davantage leur fils Wilhelm. Mais Sofia avait une relation chaleureuse avec sa gouvernante.
Son impératrice de Russie se souvenait souvent de son accession au trône. La sage nourrice enseignait à la jeune fille la religion (le luthéranisme), l'histoire, le français et l'allemand. De plus, depuis son enfance, Sofia connaissait le russe et aimait la musique.
Mariage avec l'héritier du trône
A la maison, la future impératrice de Russie s'ennuyait beaucoup. La petite ville dans laquelle elle vivait n'était pas du tout intéressante pour une fille aux grandes ambitions. Mais dès qu'elle a grandi, la mère de Sofia a décidé de lui trouver un marié riche et ainsi d'améliorer le statut social de la famille.
Lorsque la jeune fille a eu quinze ans, elle a été invitée de la capitale de l'Empire russe par l'impératrice Elizabeth Petrovna elle-même. Elle l'a fait pour que Sophia épouse l'héritier du trône russe - le grand-duc Pierre. Arrivée dans un pays étranger, Sofia est tombée malade d'une pleurésie et a failli mourir. Mais, grâce à l'aide de l'impératrice Elizabeth Petrovna, elle a rapidement réussi à surmonter une grave maladie.
Immédiatement après sa guérison, en 1745, Sophie épousa un prince, devint orthodoxe et reçut un nouveau nom. Elle est donc devenue Catherine.

Le mariage politique n'était pas du tout heureux pour la jeune princesse. Le mari ne voulait pas lui consacrer son temps et aimait s'amuser davantage. Catherine à cette époque, lisait des livres, étudiait le droit et l'histoire.
Vous ne pouvez pas parler brièvement de la vie personnelle de Catherine la Grande. Il est plein d'événements fascinants. Il y a des informations selon lesquelles l'épouse de la future maîtresse de l'Empire russe avait une petite amie sur le côté. À son tour, la princesse a été vue en contact étroit avec Sergei Saltykov, Grigory Orlov ... Elle avait de nombreux favoris.
En 1754, Catherine a un fils, Pavel. Bien sûr, les courtisans répandent des rumeurs selon lesquelles on ne sait pas qui est le vrai père de cet enfant. Bientôt, l'enfant a été confié à Elizaveta Petrovna pour qu'elle s'occupe de lui. Catherine n'était pratiquement pas autorisée à voir son fils. Bien sûr, elle n'aimait pas du tout cette circonstance. Puis la pensée apparut dans la tête de la princesse qu'il serait bon de monter elle-même sur le trône. De plus, c'était une personne énergique et intéressante. Catherine lisait toujours des livres avec enthousiasme, surtout en français. De plus, elle s'intéressait activement à la politique.
Bientôt, la fille de l'impératrice Anna est née, qui est décédée en bas âge. Le mari de Catherine ne s'intéressait pas aux enfants, il croyait qu'ils ne venaient peut-être pas du tout de lui.
Bien sûr, la princesse a essayé d'en dissuader son mari, mais elle a essayé de ne pas attirer son attention - elle a passé presque tout son temps dans son boudoir.

En 1761, Elizaveta Petrovna partit pour un autre monde, puis le mari de Catherine devint empereur et Catherine elle-même devint impératrice. Les affaires d'État n'ont pas rapproché le couple. En matière politique, Pierre III préférait consulter ses favoris et non sa femme. Mais Catherine la Grande rêvait qu'elle dirigerait un jour une grande puissance.
La jeune impératrice a essayé de toutes les manières possibles de prouver au peuple qu'elle était dévouée à lui et à la foi orthodoxe. Grâce à la ruse et à l'intelligence, la fille a atteint son objectif - les gens ont commencé à la soutenir en tout. Et une fois, quand elle a proposé de renverser son mari du trône, les sujets l'ont fait.
Souverain de l'empire
Pour mettre en œuvre son plan, Catherine a lancé un appel aux soldats du régiment Izmailovsky. Elle leur a demandé de la protéger de son mari - un tyran. Puis les gardes forcèrent l'empereur à abdiquer le trône.
Peu de temps après que Pierre a abdiqué le trône, il a été étranglé. Il n'y a aucune preuve de la culpabilité de Catherine dans ce qui s'est passé, mais beaucoup soupçonnent ouvertement l'Impératrice de cet acte audacieux.

Photos du film "Super"
Dans les premières années de son règne, Catherine la Grande a essayé par tous les moyens de prouver qu'elle était une souveraine sage et juste. Elle rêvait de recevoir un soutien universel. De plus, Catherine a décidé de prêter une attention particulière à la politique intérieure, pas à la conquête. Il fallait résoudre les problèmes qui s'étaient accumulés dans le pays. Dès le début, la reine savait exactement ce qu'elle voulait et a commencé à mettre activement en œuvre les tâches politiques auxquelles elle était confrontée.
Vie personnelle de l'impératrice
Catherine la Grande, après la mort de son mari, ne put se remarier. Cela pourrait affecter négativement son pouvoir. Mais de nombreux chercheurs écrivent que la séduisante Ekaterina Alekseevna avait de nombreux favoris. Elle a donné à ses confidents la richesse, généreusement distribué des titres honorifiques. Même après la fin de la relation, Catherine a continué à aider les favoris, à assurer leur avenir.
La vie personnelle orageuse de Catherine la Grande a conduit au fait qu'elle a eu des enfants de sa bien-aimée. Lorsque Pierre III vient de monter sur le trône, sa femme porte l'enfant de Grigori Orlov sous son cœur. Ce bébé est né en secret de tout le monde le 11 avril 1762.
Le mariage de Catherine à cette époque était presque complètement ruiné, l'empereur n'avait pas honte d'apparaître avec ses filles en public. L'enfant que Catherine a confié à son chambellan Vasily Shkurin et à sa femme pour l'éducation. Mais lorsque l'impératrice monta sur le trône, l'enfant fut ramené au palais.
Catherine et Grégoire ont pris soin de leur fils, qui s'appelait Alexei. Et Orlov a même décidé avec l'aide de cet enfant de devenir le mari de l'impératrice. Catherine a longuement réfléchi à la proposition de Grégoire, mais l'État lui était plus cher. Elle ne s'est jamais mariée.

Photos du film "Super"
Lire sur la vie personnelle de Catherine la Grande est vraiment intéressant. Lorsque le fils de Catherine et Grigory Orlov a grandi, il est parti à l'étranger. Le jeune homme resta à l'étranger une dizaine d'années, et à son retour, il s'installa dans un domaine offert par la grande impératrice.
Les favoris de l'impératrice ont réussi à devenir des politiciens exceptionnels. Par exemple, en 1764, son bien-aimé Stanislav Poniatowski devint roi de Pologne. Mais aucun de ces hommes ne pouvait influencer la politique de l'État de la Russie. L'impératrice préféra s'occuper elle-même de ces affaires. Une exception à cette règle était Grigori Potemkine, que l'impératrice aimait beaucoup. Ils disent qu'en 1774 un mariage a été conclu entre eux, en secret de tout le monde.
Catherine consacre presque tout son temps libre aux affaires gouvernementales. Elle a travaillé dur pour enlever l'accent de son discours, a lu avec plaisir des livres sur la culture russe, a écouté les coutumes et, bien sûr, a soigneusement étudié les ouvrages historiques.
Catherine la Grande était une souveraine très instruite. Les frontières du pays, pendant son règne, se sont étendues au sud et à l'ouest. Dans la partie sud-est de l'Europe, l'Empire russe est devenu un véritable leader. Ce n'est pas un hasard si de nombreux films et séries télévisées sont tournés sur l'impératrice Catherine la Grande et sa vie personnelle.

Grâce à de nombreuses victoires, le pays s'étend jusqu'à la côte de la mer Noire. En 1768, le gouvernement de l'Empire a commencé à émettre du papier-monnaie pour la première fois.
L'impératrice n'était pas seulement engagée dans son éducation. Elle a aussi fait beaucoup pour que les hommes et les femmes du pays puissent étudier. En outre, l'impératrice a procédé à de nombreuses réformes éducatives, en adoptant l'expérience d'autres pays. Des écoles ont également été ouvertes dans les provinces russes.
Pendant longtemps, l'impératrice Catherine la Grande a gouverné seule le pays, réfutant la théorie selon laquelle les femmes ne peuvent pas occuper de postes politiques importants.
Quand est venu le temps de transférer le pouvoir entre les mains de son fils Paul, elle n'a pas voulu le faire. L'impératrice avait une relation tendue avec Paul. Elle a plutôt décidé de faire du petit-fils d'Alexandre l'héritier du trône. Depuis l'enfance, Catherine prépare l'enfant à l'accession au trône et veille à ce qu'il consacre beaucoup de temps à ses études. De plus, elle a trouvé une épouse pour son petit-fils bien-aimé afin qu'il puisse devenir empereur avant d'avoir atteint l'âge de la majorité.
Mais après la mort de Catherine, son fils Pavel monta sur le trône. Il a régné après Catherine la Grande pendant cinq ans.